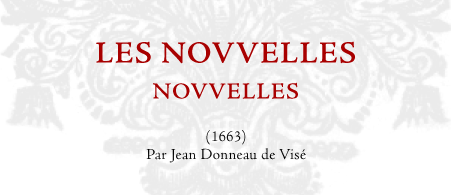TROISIÈME PARTIE Le texte de cette troisième
partie a été établi sur l'édition originale.
Le texte de cette troisième
partie a été établi sur l'édition originale.
Détail de la première gravure du tome III (p. 3). © BNF
Le Jaloux par force Le tome III des
Nouvelles Nouvelles débute, sans indication
autre que l’énoncé du titre, par la nouvelle du « Jaloux
par force ». Pour
connaître les circonstances d’énonciation de ce texte, le
lecteur doit se reporter à la fin du tome II. .
Nouvelle.
Le tome III des
Nouvelles Nouvelles débute, sans indication
autre que l’énoncé du titre, par la nouvelle du « Jaloux
par force ». Pour
connaître les circonstances d’énonciation de ce texte, le
lecteur doit se reporter à la fin du tome II. .
Nouvelle.
Timandre et Clidamire, après s’être quelque temps fait l’amour sans qu’il leur fût arrivé aucun accident digne d’être raconté, furent enfin mariés au grand contentement de l’un et de l’autre. Les fiançailles se firent en la maison de Clidamire où, après un superbe souper qui dura jus-44que bien avant dans la nuit, toute la compagnie se divertit agréablement en attendant le point du jour, qui ne se fut pas plus tôt montré que l’on les fut conduire au temple pour la cérémonie des épousailles. Ensuite de quoi, le marié et la mariée se séparèrent et chacun s'en retourna chez soi, tant pour se reposer que pour se préparer à venir le soir au souper, qui se devait faire chez un des plus fameux traiteurs de Paris, les plus riches de cette ville suivant presque tous cette coutume lorsqu'ils marient leurs enfants.
L'après-dînée de ce même jour, comme Timandre se préparait pour aller où se devait faire le souper, il reçut ce billet d'une femme qu'il estimait beaucoup et en laquelle il avait une confiance toute particulière.55
MÉLASIE A TIMANDRE.
Je vous prie de me venir trouver dès que vous aurez reçu ce billet, et de croire que, si l'on ne m'avait persuadée qu'il y va de votre honneur et de votre vie, je ne vous ferais pas cette prière un jour où vous ne devez pas manquer d'occupation et que vous devez avoir destiné tout entier à l'amour.
Timandre n'eut pas plus tôt lu ce billet qu'il se résolut d'aller trouver Mélasie, s'imaginant qu'il serait bientôt de retour et que l'excuse qu'il avait serait plus que valable pour lui faire 66 quitter sans incivilité la meilleure compagnie du monde. Mais comme l'on l'avait autrefois soupçonné d'avoir plus que de l'estime pour cette dame, il ne voulut point donner sujet à sa femme et à ses parents de se plaindre de lui, ce qui l'obligea de sortir seul, par la porte de son jardin, et de prendre une chaise au premier carrefour, ce qu'il fit sans rencontrer personne qui le connût.
Il trouva Mélasie dans une salle basse, qui lui dit que Thersandre, un de ses voisins, lui était venu dire que, puisqu'elle connaissait particulièrement Timandre, il la priait de lui permettre qu'il lui pût parler chez elle, et qu'il la conjurait de l'envoyer quérir de sa part ; que d'abord elle s'en était défendue et qu'elle lui avait dit qu'elle 77 passerait pour ridicule si elle envoyait quérir un homme pour lui parler d'affaires le jour de ses noces, mais qu'après qu'il eut dit qu'il ne pouvait tarder davantage à lui parler en secret et qu'il y allait de la vie et de l'honneur de l'un et de l'autre, elle avait cru, pour leur rendre service à tous deux, être obligée de l'envoyer chercher. Elle ajouta que Thersandre était dans sa chambre et qu'il y pouvait monter, afin de l'entretenir sans témoins.
Quoique Timandre se doutât bien de ce que Thersandre lui voulait, il n'en témoigna rien à Mélasie. Il la remercia seulement de la peine qu'elle avait prise et monta ensuite à la chambre où l'on l'attendait. Thersandre, l'ayant aperçu, le salua d'un 88air qui faisait assez voir ce qu'il avait dans l'âme et, s'étant approché près de lui, lui dit, d'un ton à ne pouvoir être entendu hors de la chambre :
— J'ai cru devoir user de cet artifice pour tirer aujourd'hui raison de ce
que je veux de vous ; car enfin, quelque généreux que je vous connaisse, vous
n'auriez eu que trop de sujet de ne me pas satisfaire aujourd'hui, si je vous
eusse envoyé un cartel. C'est pourquoi j'ai cru que je vous devais parler
moi-même. Sachez donc, ajouta-t-il, qu'il y a longtemps que j'ai de l'amour pour
Clidamire, comme vous avez pu apprendre par le bruit qui a couru que je n'en
étais pas haï. Cependant, quelques affaires domestiques m'ayant appelé à la
campagne, vous vous êtes servi de 99 ce temps pour presser votre
mariage, et Clidamire, se voyant pressée par son père, y a consenti, plutôt
par obéissance que par inclination La situation est proche
de celle qui caractérise la Sophonisbe de Corneille
: une femme (Sophonisbe) promise à un amant agréé (Massinisse), un rival
(Syphax) qui en profite pour épouser la jeune fille grâce au soutien du
père de cette dernière. . Ce procédé m'a tellement irrité
que j'ai résolu d'en tirer vengeance et de vous ôter la vie avant que vous ayez
l'avantage de voir Clidamire entre vos bras. Car enfin, si ce bonheur vous était
arrivé, la satisfaction que je pourrais demain tirer en vous immolant à mon
ressentiment ne serait qu'imparfaite : vous mourriez avec trop de satisfaction
et, jusqu'au fond des enfers, le souvenir d'avoir possédé Clidamire vous
rendrait heureux au milieu des supplices. C'est pourquoi j'ai résolu de ne vous
point quitter aujourd'hui que
vous ne m'ayez satisfait.
La situation est proche
de celle qui caractérise la Sophonisbe de Corneille
: une femme (Sophonisbe) promise à un amant agréé (Massinisse), un rival
(Syphax) qui en profite pour épouser la jeune fille grâce au soutien du
père de cette dernière. . Ce procédé m'a tellement irrité
que j'ai résolu d'en tirer vengeance et de vous ôter la vie avant que vous ayez
l'avantage de voir Clidamire entre vos bras. Car enfin, si ce bonheur vous était
arrivé, la satisfaction que je pourrais demain tirer en vous immolant à mon
ressentiment ne serait qu'imparfaite : vous mourriez avec trop de satisfaction
et, jusqu'au fond des enfers, le souvenir d'avoir possédé Clidamire vous
rendrait heureux au milieu des supplices. C'est pourquoi j'ai résolu de ne vous
point quitter aujourd'hui que
vous ne m'ayez satisfait.
— Si je croyais, lui 1010 répondit froidement Timandre, devoir mourir dans ce combat, j'attendrais encore quelques jours à le faire, tant pour emporter le doux souvenir d'avoir vu Clidamire entre mes bras que pour avoir le temps de faire un héritier de son sang et du mien qui pût un jour venger ma mort.
— Vous dites vrai, répliqua Thersandre, ce fils me ferait périr, mais ce serait avant que d'avoir assez de force pour m'attaquer, puisque le dépit que j'aurais de voir caresser ce fils à Clidamire et de voir tous les jours votre sang entre ses bras, me ferait mourir avant qu'il pût concevoir le dessein de venger la mort de son père.
— Puisqu'il est ainsi, repartit Timandre, d'un air encore plus froid et plus dédaigneux qu'auparavant, j'ai donc encore 1111 envie d'attendre quelques jours. Je crois aussi bien que j'aurais aujourd'hui trop bon marché de vous, puisque la pensée que j'aurais d'aller posséder Clidamire au sortir du combat me ferait sans doute avancer l'heure de votre trépas.
— Le dépit d'avoir perdu Clidamire, répliqua fièrement Thersandre, ne me donnera pas moins de courage que vous donnera la pensée que vous devez aujourd'hui être maître de toutes les beautés de cette illustre personne. C'est pourquoi sortons promptement, pour voir si le sort continuera de vous favoriser.
— Je doute encore, répondit Timandre, si je vous dois satisfaire avant que d'avoir vu Clidamire entre mes bras, parce que cette possession donnera de la force à votre dépit et que, ce 1212 dépit étant beaucoup plus grand, il vous rendra plus hardi et vous donnera plus de courage, ce qui relèvera l'éclat de ma victoire, parce que j'aurai plus d'honneur à vaincre un rival qu'un juste et violent dépit rendra le plus furieux de tous les hommes, qu'à présent qu'il espère encore m'empêcher de posséder l'objet de notre dispute et de notre amour. Puisque toutefois, continua-t-il, après avoir rêvé quelque temps, vous m'assurez que vous êtes en état de vous bien défendre, je veux bien vous satisfaire présentement.
— Non, non ! repartit Thersandre, ce ne sera point moi qui me défendrai : je prétends t'y contraindre toi-même, je serai l'attaquant et tu seras le défenseur.
Timandre ne répondit rien à ce 1313discours audacieux, mais il sortit le premier en le regardant d'un air qui faisait voir qu'il n'appréhendait point ces menaces. Avant que de sortir de ce logis, ils prièrent tous deux Mélasie de ne point dire qu'ils y fussent venus. Ensuite ils entrèrent chacun dans leur chaise, sans être accompagnés de personne, parce qu'ils n'avaient point mené de valets. Ils se firent mener jusqu'au bout du faubourg le plus proche, où ils feignirent d'entrer dans une maison et renvoyèrent leurs chaises. Quand elles furent parties, ils sortirent du lieu où ils étaient entrés et furent dans la campagne, où ils firent plusieurs tours jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé un lieu commode pour exécuter leur dessein. Après en avoir choisi un, ils mirent l'épée 1414 à la main, se battirent fort longtemps sans emporter l'avantage l'un sur l'autre. Mais le sort voulut que Thersandre, après s'être battu aussi vaillamment qu'il avait audacieusement parlé, reçut un coup dont il mourut un moment après. Laissons-le expirer en repos, et donnons le temps à Timandre de se sauver, pendant que nous retournerons voir ce qui se passe à la ville.
La prière que ces deux rivaux avaient faite à Mélasie de ne point dire qu'ils étaient venus chez elle, et l'air dont ils en étaient sortis, lui firent soupçonner quelque chose de leur dessein et, après avoir bien rêvé d'où pourrait venir leur querelle, elle se ressouvint que Thersandre avait été amoureux de Clidamire, ce qui la confirma dans la pensée 1515 qu'elle avait qu'ils étaient allés se battre, et ce qui la fit résoudre, connaissant la faute qu'elle avait faite, de ne dire à personne qu'ils étaient venus chez elle.
Pendant que ces choses se passaient, tous ceux qui étaient conviés au festin se préparaient pour y paraître avec éclat. Ce n'était que joie dans la maison de Clidamire, chacun était autour d'elle pour l'ajuster et l'on n'oubliait rien de ce qui pouvait lui donner de nouveaux agréments. Étant achevée d'habiller, elle attendit longtemps son époux, qu'elle croyait qui la devait venir prendre pour la conduire au lieu où se devait trouver l'assemblée. Mais Clidaris, père de Clidamire, se lassant d'attendre et croyant que son gendre ne viendrait point, parce qu'il demeu- 1616rait proche du lieu où l'on se devait trouver, se résolut d'y mener sa fille.
Il n'y fut pas plus tôt entré qu'il demanda à la compagnie, qui était déjà fort grande, s'il n'était point venu, et l'on lui répondit que non. Il attendit encore quelque temps, après lequel il fut lui-même le chercher à son logis. Mais il fut bien surpris d'apprendre que l'on ne savait ce qu'il était devenu, ce qui l'obligea à revenir sur ses pas trouver la compagnie, qui l'attendait toujours. Il se passa encore quelque temps, pendant lequel on l'attendit avec espérance qu'il viendrait, mais non pas sans chagrin ; à ce chagrin succéda un peu de dépit et de colère ; à cette colère, la crainte qu'il ne lui fût arrivé quelque malheur ; et à cette crainte, la perte de l'espérance que l'on 1717 avait toujours eue qu'il viendrait.
Ensuite (la vue des choses qui peuvent réjouir augmentant la douleur plutôt que de la soulager) l'on congédia les violons, qui murmurèrent fort, quoique bien payés, et qui pestèrent contre la noce, dont toutefois ils sortirent plus légers, plus droits et plus sages qu'ils n'avaient jamais fait de ce lieu. Après que les violons furent partis, le traiteur dit que, si l'on ne se mettait pas au plus tôt à table, les viandes ne vaudraient plus rien, et qu'il avait déjà usé plus d'un muid de charbon à les faire réchauffer.
Pendant ce temps, la mariée fondait en pleurs, ses parents et ses plus
particuliers amis étaient
auprès d'elle, qui tâchaient de la consoler Cette scène
est représentée sur la gravure placée à l’orée de la
nouvelle (p. 3), et ceux qui n'étaient pas si familiers,
aussi bien que 1818 ceux que le hasard avait fait trouver en ce lieu
(car, en de pareilles rencontres, il se trouve toujours plus de personnes qu'il n'y
en a de conviées), ne savaient quelle posture tenir, beaucoup prenant autant
d'intérêt au souper qu'à la perte
du marié. La plupart des enfants s'endormaient auprès de leur mère, et les
autres leur demandaient sans cesse si l'on souperait bientôt. D'un autre côté,
les valets s'entretenaient ensemble : les uns disaient qu'ils en auraient
meilleure part, si leurs maîtres et leurs maîtresses ne mangeaient point, et les
autres, que leurs maîtres les emmèneraient sans souper.
Cette scène
est représentée sur la gravure placée à l’orée de la
nouvelle (p. 3), et ceux qui n'étaient pas si familiers,
aussi bien que 1818 ceux que le hasard avait fait trouver en ce lieu
(car, en de pareilles rencontres, il se trouve toujours plus de personnes qu'il n'y
en a de conviées), ne savaient quelle posture tenir, beaucoup prenant autant
d'intérêt au souper qu'à la perte
du marié. La plupart des enfants s'endormaient auprès de leur mère, et les
autres leur demandaient sans cesse si l'on souperait bientôt. D'un autre côté,
les valets s'entretenaient ensemble : les uns disaient qu'ils en auraient
meilleure part, si leurs maîtres et leurs maîtresses ne mangeaient point, et les
autres, que leurs maîtres les emmèneraient sans souper.
Enfin, après qu'une heure fut sonnée, quelques-uns mangèrent un morceau à la
hâte et l'on laissa presque tout aux valets, mais l'on ne leur 1919
donna pas le temps de le manger. Ensuite, l'on ramena la mariée à son logis, et
le traiteur et ses gens restèrent bien étonnés, n'ayant
jamais vu chez eux de pareilles noces L’épisode est
également inédit dans la nouvelle et le roman français du XVIIe siècle.
En représentant, sous l’angle de l’intimité domestique, un événement de
la vie familiale, Donneau s’aventure sur un terrain inexploré. Il
reprendra la formule à l’occasion des comédies qu’il donnera à la scène
quelques années plus tard : La Veuve à la mode (1667),
L’Accouchée (1667)..
L’épisode est
également inédit dans la nouvelle et le roman français du XVIIe siècle.
En représentant, sous l’angle de l’intimité domestique, un événement de
la vie familiale, Donneau s’aventure sur un terrain inexploré. Il
reprendra la formule à l’occasion des comédies qu’il donnera à la scène
quelques années plus tard : La Veuve à la mode (1667),
L’Accouchée (1667)..
Quand Clidamire fut arrivée chez elle, l'on la déshabilla, mais non pas avec les cérémonies que l'on a coutume de faire en de semblables jours : il n'y eut point de confitures à ce coucher, personne ne parut enjoué et ne se cacha dans la chambre de l'épousée. Au contraire, ceux qui n'étaient pas assez tristes tâchaient de le paraître ; car il y en avait qui ne pouvaient s'empêcher de rire, quand ils se représentaient que cette pauvre fille, après avoir cru coucher ce soir-là en compagnie, devait passer la nuit toute seule. Tous ceux qui 2020 s'en retournèrent, qui étaient en grand nombre et qui avaient voulu venir jusque chez Clidamire, espérant toujours que Timandre pourrait revenir, raisonnèrent sur cette aventure et tâchèrent d'en trouver le sujet, qu'ils croyaient ne point venir du mouvement de Timandre, parce que rien ne l'avait contraint à épouser Clidamire et qu'il avait toujours recherché ce mariage avec empressement.
Pendant que Clidamire soupire seule dans son lit, retournons à celui qui en devait occuper la moitié et que nous avons laissé auprès d'un rival expirant.
Timandre n'eut pas plus tôt vu tomber son rival qu'il cessa de le combattre. Thersandre lui fit connaître qu'il lui voulait parler, mais il ne put proférer une 2121 seule parole et mourut un moment après avoir reçu le coup. Ce vainqueur, après avoir vu son rival sans vie, ne songea plus qu'à venir goûter les plaisirs que l'hymen lui préparait. Mais, comme il commençait à se faire tard et que, pour chercher un lieu propre à se battre sans être vus, ils avaient été fort avant dans la campagne par des routes qui leur étaient inconnues, il eut de la peine à reconnaître son chemin et en prit un tout contraire à celui de la ville. Il fut à peine entré dans ce chemin qu'il fut attaqué par cinq voleurs.
Quoiqu'il fût un des plus vaillants et des plus adroits hommes de son siècle, il ne ressembla point à ces héros qui donnent la mort, ou du moins qui font fuir tous ceux qui les attaquent, quelque grand 2222 qu'en puisse être le nombre. Tout ce qu'il put faire, ce fut de combattre en vaillant homme et non comme ces demi-dieux. Il se défendit longtemps, il en tua un, il en blessa un autre, mais il reçut aussi une blessure qui le mit hors de combat, ce qui fut cause que ces voleurs le dépouillèrent, aussi bien que leur compagnon, afin que l'on les prît pour des gens qui avaient été volés. Ensuite de quoi ils s'en allèrent et les laissèrent tous deux pour morts, bien que Timandre ne le fût pas.
Quand il fut revenu un peu de son évanouissement : « Ô Ciel ! dit-il d'une voix languissante, est-il possible que je sois ce Timandre qui s'estimait ce matin le plus heureux des hommes et qui a eu le bonheur de vaincre après-dînée un rival des plus redouta- 2323bles ? Que l'on cherche tant que l'on voudra, l'on ne trouvera jamais d'aventure pareille à la mienne : j'étais hier, à l'heure qu'il est, au milieu des divertissements et le sort semblait encore m'en préparer de plus grands pour aujourd'hui ; cependant, par un caprice dont il est seul capable, à l'heure qu'il me promettait ces plaisirs, il me met au milieu d'une campagne nu, sans clarté, blessé, peut-être sur le point d'expirer, sans secours, sans espérance d'en avoir, et sans savoir même le chemin pour en aller chercher, et tout cela dans un temps où l'Amour et l'Hymen, accompagnés des Plaisirs, me devraient conduire au lit nuptial. »
Cet infortuné, au lieu d'entendre chanter son épithalame, déclamait ainsi contre
son malheur 2424 et contre les caprices du sort, sans être entendu ni
secouru de personne. Ses ennemis ne vinrent point le secourir, il ne s'en trouva
point si tard dans la campagne, ni si à propos ; il ne vint point non plus
d'inconnu le faire porter chez lui « Arside [...] fit
bander les plaies de son maître et le fit porter par deux valets dans
une maison qui n’était guère éloignée de ce funeste lieu » (Ancelin,
Le Portrait funeste, 1661, p. 10). L’épisode est topique dans la fiction narrative
d’inspiration « cavalière » des années 1660. pour le faire
panser et lui faire ensuite conter son histoire, qui n'eût pas été longue. Il
reçut néanmoins un plus grand secours, puisqu'il en reçut un du ciel, qui ne fut
pourtant qu'un petit clair de lune, à la faveur duquel il découvrit la maison
d'un paysan, dont il n'était pas fort éloigné, où il se traîna du mieux qu'il
put. Après avoir heurté à la porte et fait connaître à ceux qui lui parlèrent
qu'il avait été attaqué par des voleurs et qu'il avait été blessé, il promit
beaucoup à ces bonnes 2525gens, s'ils voulaient le secourir. L'espérance
du gain leur fit ouvrir la porte, après avoir toutefois regardé par la fenêtre
quel homme c'était, s'il était vrai qu'il fût blessé et s'il était seul.
« Arside [...] fit
bander les plaies de son maître et le fit porter par deux valets dans
une maison qui n’était guère éloignée de ce funeste lieu » (Ancelin,
Le Portrait funeste, 1661, p. 10). L’épisode est topique dans la fiction narrative
d’inspiration « cavalière » des années 1660. pour le faire
panser et lui faire ensuite conter son histoire, qui n'eût pas été longue. Il
reçut néanmoins un plus grand secours, puisqu'il en reçut un du ciel, qui ne fut
pourtant qu'un petit clair de lune, à la faveur duquel il découvrit la maison
d'un paysan, dont il n'était pas fort éloigné, où il se traîna du mieux qu'il
put. Après avoir heurté à la porte et fait connaître à ceux qui lui parlèrent
qu'il avait été attaqué par des voleurs et qu'il avait été blessé, il promit
beaucoup à ces bonnes 2525gens, s'ils voulaient le secourir. L'espérance
du gain leur fit ouvrir la porte, après avoir toutefois regardé par la fenêtre
quel homme c'était, s'il était vrai qu'il fût blessé et s'il était seul.
Timandre ne fut pas plus tôt entré qu'il pria que l'on lui allât quérir le chirurgien le plus proche, ce que le fils du paysan fit avec toute la diligence imaginable, ayant eu l'esprit d'en aller quérir un qui était chez un gentilhomme qui était malade dans une maison qu'il avait proche de ce lieu.
Le chirurgien, ayant visité sa blessure, trouva qu'elle n'était pas mortelle et qu'il n'était faible qu'à cause du sang qu'il avait perdu.
Ce triste et malheureux héros, après avoir été pansé, se reposa 2626 le
reste de la nuit et, quand le jour fut venu, il écrivit à son beau-père le lieu
où il était, et le conjura d'amener Clidamire, que je ne puis nommer autrement,
n'étant plus fille et n'étant pas encore femme Clidamire, décrétée épouse par le sacrement célébré du mariage, n’est
donc plus fille (p. 5). Mais, n’ayant pas encore consommé le mariage,
elle ne peut être considérée comme femme. . Il le pria
aussi de ne dire à qui que ce fût qu'il eût eu de ses nouvelles, jusqu'à ce
qu'il l'eût entretenu. Il envoya cette lettre par son hôte, à qui il commanda de
ne rien dire, quelques questions qu'on lui fît. Le père de Clidamire ne l'eut
pas plus tôt reçue qu'il la montra à sa fille. Ils résolurent ensemble de partir
et avisèrent aux moyens de le faire sans que personne n’en sût rien, ce qui ne
leur fut pas fort difficile, parce qu'ils devaient revenir le même jour.
Clidamire, décrétée épouse par le sacrement célébré du mariage, n’est
donc plus fille (p. 5). Mais, n’ayant pas encore consommé le mariage,
elle ne peut être considérée comme femme. . Il le pria
aussi de ne dire à qui que ce fût qu'il eût eu de ses nouvelles, jusqu'à ce
qu'il l'eût entretenu. Il envoya cette lettre par son hôte, à qui il commanda de
ne rien dire, quelques questions qu'on lui fît. Le père de Clidamire ne l'eut
pas plus tôt reçue qu'il la montra à sa fille. Ils résolurent ensemble de partir
et avisèrent aux moyens de le faire sans que personne n’en sût rien, ce qui ne
leur fut pas fort difficile, parce qu'ils devaient revenir le même jour.
Ce bon homme, après les avoir menés dans la chambre de son 2727 nouvel hôte, en sortit pour les laisser parler en liberté. Timandre leur dit d'abord qu'ils ne s'effrayassent point et que sa blessure n'était pas dangereuse. Il leur dit ensuite que, comme ils lui touchaient de si près, il ne leur voulait rien déguiser et que, quand il le voudrait faire, il lui serait impossible, ne trouvant rien qui lui pût servir d'excuse et le mettre à couvert du blâme que l'on pourrait lui donner. Ensuite il leur raconta tout ce qui lui était arrivé et comme il lui eût été impossible de s'en défendre, de la manière dont il avait été engagé. Il leur demanda si l'on ne se doutait de rien et ce que l'on disait de Thersandre. Clidaris lui dit que ses parents croyaient que le dépit qu'il avait eu d'avoir trouvé 2828 sa maîtresse mariée l'avait fait quitter Paris, et qu'ils ne s'en mettaient pas beaucoup en peine; que Mélasie n'avait point dit qu'elle les eût vus ni l'un ni l'autre, d'où ils conjecturèrent que, quand même elle se douterait de la chose, elle était trop prudente pour la divulguer, après avoir été cause qu'ils s'étaient battus.
Ils s’entretinrent encore quelque temps ensemble et puis ils tombèrent d’accord de ce qu’ils devaient faire pour cacher ce qui était arrivé à notre héros et pour rendre raison de son absence, ce qui n’était pas peu difficile, ne trouvant rien qui pût justement engager un homme à s’absenter le jour de ses noces, à moins que d’avoir été marié par force, ce qui n’était pas. Ils se résolurent néanmoins de laisser croire ce 2929 que l’on voudrait, après en avoir donné quelques raisons apparentes. Et voici ce qu’ils firent.
Clidaris et sa fille, après avoir demeuré quelques heures en ce lieu, partirent pour s’en revenir à Paris, avec une lettre écrite de la main de Timandre et cachetée de son cachet. Le lendemain, ils laissèrent entrer chez eux quantité de parents, d’amis et de voisins, qui leur venaient faire des compliments de condoléance. Leur chambre étant ainsi remplie, ils se firent apporter la lettre de Timandre par un homme supposé. D’abord ils témoignèrent leur surprise et leur joie en reconnaissant l’écriture et, après l’avoir lue bas, ils la lurent haut, afin que la compagnie prît part à leur joie.
Avant que de vous apprendre3030 ce que cette lettre contenait, il est à propos que vous sachiez que Timandre avait encore sa mère, qui demeurait à une maison de campagne, à quinze lieues de Paris, et qui n’en pouvait sortir à cause de son extrême vieillesse. Timandre mandait que, bien qu’il fût plus digne de pitié que de blâme d’avoir été obligé de quitter, le jour de ses noces, la personne du monde qu’il aimait le mieux, il ne laissait pas de croire que l’on attribuerait ce qui était arrivé à un manque d’amour et que l’on ne laisserait pas que de lui faire des reproches ; qu’après être sorti du temple il avait trouvé une lettre chez lui, qui lui avait appris que sa mère était à l’extrémité et qu’elle le mandait pour 3131lui dire des choses de grande conséquence, qui le regardaient et qu’elle ne voulait confier à personne ; et qu’un peu de temps après avoir lu cette lettre, il aperçut dans un carrosse un de ses amis qui allait à la campagne et qui devait passer par le lieu où sa mère était, et qu’il avait pris cette commodité, crainte de la trouver morte s’il tardait davantage, ce qui avait été cause qu’il n’avait eu le temps que d’écrire à son beau-père un mot sur-le-champ, pour lui faire savoir son voyage, et de le lui envoyer par son valet. À la fin de la lettre, il le conjurait de le venir trouver et de lui amener sa femme.
Cet artifice réussit d’autant plus facilement que les intéressés savaient la vérité et que 3232 ceux qui ne le sont point ne pénètrent pas si avant que les autres. C’est pourquoi la compagnie trouva cette excuse raisonnable, et l’on rejeta toute la faute sur le valet, qui n’avait point apporté la lettre.
Clidaris et sa fille, qui ne devaient pas aller si loin que l’on s’imaginait, partirent dès le lendemain, et, au lieu d’aller à la maison de la mère de Timandre, ils le furent trouver au lieu où il était, comme ils en étaient demeurés d’accord. Ils y demeurèrent jusqu’à ce qu’il fût parfaitement guéri. Pendant le séjour qu’ils y firent, ils apprirent que l’on avait trouvé dans les champs un homme mort et dont on ne pouvait reconnaître les traits, ce qui faisait croire qu’il y avait longtemps qu’il y était. 3333 Ils surent, de plus, que l’on croyait qu’il avait été assassiné, parce que l’on avait trouvé son épée dans son fourreau et que l’on ne l’avait point volé, ce qui avait été cause que l’on l’avait porté au temple le plus proche. Ils se doutèrent bien que c’était Thersandre, car Timandre dit qu’il lui avait à dessein remis ainsi son épée.
Après la guérison de ce malheureux époux, qui depuis son mariage n’avait point couché avec sa femme, ils revinrent à Paris, où personne ne se doutait de ce qui était arrivé.
Puisque leur mariage est présentement consommé, il est temps de vous dire un mot de leurs personnes. Clidamire était une fille unique, elle avait la taille petite et ne pouvait point passer pour 3434belle, bien qu’elle eût beaucoup d’agrément et ce je ne sais quoi qui charme et qui se rencontre souvent dans les beautés médiocres, et jamais dans les grandes et parfaites beautés. Son esprit ressemblait à sa beauté et, bien qu’il ne fût pas tout à fait grand, il ne laissait pas que d’avoir des brillants qui la faisaient quelquefois admirer dans la conversation. Toutes ces choses étaient accompagnées d’un grand bien, ce qui fut cause que Timandre soupira pour elle, car il en avait fort peu. Mais, en récompense, il passait pour être un des mieux faits et des plus beaux hommes de son siècle, ce qui fit que Clidamire consentit facilement à l’épouser. Vous apprendrez bientôt l’humeur de l’un et de l’autre.
Six mois après que Timandre 3535 fut marié, un de ses parents, qui
demeurait ordinairement à la campagne, le vint voir et, comme c’était un homme
fort enjoué, après lui avoir fait cent plaisantes questions sur son mariage, il
lui demanda de quelle humeur était sa femme. Timandre, au lieu de répondre à ce
qu’il lui demandait, lui dit que, puisqu’il aimait les nouveautés Timandre se comporte comme un nouvelliste. Donneau reprend,
à l’intérieur de sa nouvelle, le procédé d’insertion par lequel celle-ci
elle-même été introduite., il fallait qu’il lui montrât une
pièce nouvelle que l’on lui avait donnée ce jour-là. En disant cela, il tira un
papier de sa poche, qu’il lui donna et, comme il était vrai que ce parent se
plaisait à voir tout ce qui se faisait de nouveau, il le prit et le lut
aussitôt. 3636
Timandre se comporte comme un nouvelliste. Donneau reprend,
à l’intérieur de sa nouvelle, le procédé d’insertion par lequel celle-ci
elle-même été introduite., il fallait qu’il lui montrât une
pièce nouvelle que l’on lui avait donnée ce jour-là. En disant cela, il tira un
papier de sa poche, qu’il lui donna et, comme il était vrai que ce parent se
plaisait à voir tout ce qui se faisait de nouveau, il le prit et le lut
aussitôt. 3636

DE LA JALOUSIE DES FEMMES Le texte qui débute
ici et qui s’étend jusqu’à la p. 43 constitue la
première des pièces insérées de la nouvelle du « Jaloux par
force »..
Le texte qui débute
ici et qui s’étend jusqu’à la p. 43 constitue la
première des pièces insérées de la nouvelle du « Jaloux par
force »..
Quoique la jalousie soit plus ordinaire aux hommes qu’aux femmes, il est néanmoins constant qu’il y a des femmes jalouses et, bien qu’elles n’aient pas le même pouvoir sur leurs maris que leurs maris ont sur elles, elles ne laissent pas que de leur donner bien de la peine quand elles sont travaillées de ce mal. Il semble que la Nature, ne voulant pas que l’on donnât des louanges au beau sexe pour être plus ordinairement exempt de cette passion, ait donné de la jalousie à de certaines femmes pour toutes celles qui n’en ont point, ce qui rend celles-là tellement insupportables que la plus 3737 forte jalousie des hommes ne paraît point incommode en comparaison de la leur. Quand un homme est si malheureux que de rencontrer une maîtresse de cette humeur, elle lui fait souffrir des peines qui ne sont pas imaginables. Quelques affaires qu’il ait et quelques excuses légitimes qu’il lui puisse donner, il faut qu’il soit toujours auprès d’elle. Elle ne saurait se persuader qu’il ait d’affaires plus pressantes que celle de la venir voir et, quand elle est convaincue qu’en perdant son temps auprès d’elle il perd sa fortune, elle est si jalouse qu’elle le devient même de la fortune. Elle a peur que cette déesse ne le favorise trop et qu’il ne l’abandonne pour se donner entièrement à elle.
S’ils se rencontrent ensemble en une compagnie, il 3838 faut qu’il l’entretienne toujours et que, pour l’empêcher de gronder, il passe pour le plus incivil des hommes. Elle rompt en un mois vingt fois avec lui et proteste qu’elle ne veut jamais en entendre parler. Cependant elle se raccommode toujours, dès qu’il la vient voir et, bien qu’elle rompe souvent avec lui, qu’elle le gronde sans cesse, qu’elle lui fasse mauvaise mine et qu’elle paraisse toujours irritée, elle ne perd néanmoins rien de son ardeur, ce qui confirme que la jalousie est un grand témoignage d’amour et que l’on se doit plus fier sur l’amour d’une femme jalouse que sur celle des autres.
Voilà ce qu’une jalouse fait devant son mariage. Voyons si elle devient plus raisonnable après.
Le mariage guérit quelquefois la 3939 jalousie des hommes, qui avaient sujet de craindre que l’on ne leur enlevât un bien qui n’était pas encore à eux, et qui par ce moyen avaient sujet de paraître jaloux, tout homme devant craindre que ses rivaux ne soient plus heureux que lui. Mais il n’en va pas de même à l’égard de la femme : le mariage augmente toujours sa jalousie, et elle croit avoir d’autant plus de lieu d’en avoir que l’on doit plus appréhender de perdre une chose qui est à soi qu’une que l’on prétend et l’on n’a pas encore. C’est pourquoi si, devant que d’être mariée, elle voulait toujours avoir un amant auprès d’elle, elle veut à peine laisser sortir son mari pour aller à ses affaires domestiques. Elle s’imagine toujours qu’il y met plus de temps qu’il ne de-4040vrait et que, loin de revenir avec elle, il se va divertir avec des personnes qu’il aime mieux, ce qui, arrivant tous les jours, la rend insupportable par ses plaintes souvent réitérées, ses discours piquants et ses redites continuelles.
Elle veut qu’il lui fasse la cour comme s’il n’était pas marié, qu’il n’entretienne jamais qu’elle en compagnie et, s’il arrive par hasard qu’il s’attache des yeux à quelque autre ou qu’il lui parle, elle lui fait une mine effroyable et fait connaître par là sa jalousie à tout le monde. Elle en est souvent raillée et sert souvent, sans qu’elle s’en aperçoive, de divertissement à toute la compagnie. Elle n’épargne rien pour découvrir toutes les intrigues de son mari, ce qu’elle fait facilement, puisque, outre l’artifi-4141ce commun à toutes les femmes, la jalousie ne lui inspire que trop de moyens pour en venir à bout, et cette connaissance, loin de soulager son mal, ne faisant que l’irriter, chacun connaît assez, la sachant en cet état,
Jusques où peut aller la fureur d’une femme Ce vers traduit le « Notumque
furens quid foemina possit » de L’Enéide (V,
v. 6), cité dans l’essai « Des vers de Virgile » (III, 5; éd.
de 1649, p. 875) de Montaigne (voir également p. 41sic la note
sur « le sénat de Marseille »). Il n’est pas attesté ailleurs
que dans cette occurrence..
Ce vers traduit le « Notumque
furens quid foemina possit » de L’Enéide (V,
v. 6), cité dans l’essai « Des vers de Virgile » (III, 5; éd.
de 1649, p. 875) de Montaigne (voir également p. 41sic la note
sur « le sénat de Marseille »). Il n’est pas attesté ailleurs
que dans cette occurrence..
C’est pourquoi je n’en parlerai point et me contenterai de dire qu’il n’y a rien de plus terrible qu’une femme en cet état : ses yeux, sa voix, ses actions, tout marque de la fureur en elle et, quand même elle ne parlerait pas, ses regards sont capables de faire trembler les plus assurés. Qu’est devenue, me dira-t-on, cette douceur si naturelle au sexe ? Dès que la jalousie s’empare du 40, sic, pour 4240, sic, pour 42 cœur d’une femme, elle l’en bannit pour jamais et, si elle la pouvait une fois rappeler, elle serait en bonne intelligence avec son mari. Mais, par une bizarrerie inconcevable, leur jalousie abhorre le seul remède qui la peut guérir.
Si une femme pouvait quitter la fureur qu’elle lui inspire et se plaindre une
fois de bonne grâce, si elle pouvait se résoudre à pousser des soupirs qui ne
fussent entendus que de son mari, au lieu de ces soupirs qui se font entendre de
tout le monde, qui n’exhalent que de la fureur et que l’on prend partout plutôt
pour enfants de la rage que pour fils de la douleur, il n’y a point de cœur si
dur qui ne se rendît ; mais, la femme voulant tout obtenir par la force, il
n’est pas juste que le mari se rende son 41, sic41, sic esclave. Ce qui fait
voir que toutes les querelles domestiques Le
Cocu imaginaire (1660) de Molière
avait remis à la mode le thème des querelles conjugales. Donneau avait
subrepticement édité ce texte en 1660. viennent de ce que
jamais femme ne s’est plainte avec douceur.
Le
Cocu imaginaire (1660) de Molière
avait remis à la mode le thème des querelles conjugales. Donneau avait
subrepticement édité ce texte en 1660. viennent de ce que
jamais femme ne s’est plainte avec douceur.
Elle ne cesse point de crier, quand elle en a une fois pris l’habitude, et ces
cris ne cessent pas même quand elle a tort, parce que sa jalousie l’aveugle
tellement qu’elle est incapable d’avoir d’autres sentiments que ceux qu’elle lui
inspire. C’est pourquoi le sénat de Marseille La phrase qui débute par
ces termes est tirée de l’essai « Sur des vers de Virgile »
(III, 5 ; éd. de 1649, p. 880) (voir également note précédente p. 41 et note
p. 81). L’oeuvre de Montaigne connaît un regain d’intérêt
dans les années 1660. On en retrouve, par exemple,
d’abondantes traces chez Molière. eut raison d’entériner la requête de celui
qui demandait permission de se tuer pour s’exempter de la tempête de sa femme.
Que ce mot de tempête exprime bien le bruit que fait une femme jalouse quand
elle se plaint, et montre bien que l’on n’en peut souffrir rien de pis que la
jalousie. Je veux bien
néanmoins que ce soit une preuve 4242 d’amour. Mais c’est une preuve
dont on ne se doit point servir et qui nuit plus qu’elle ne sert.
La phrase qui débute par
ces termes est tirée de l’essai « Sur des vers de Virgile »
(III, 5 ; éd. de 1649, p. 880) (voir également note précédente p. 41 et note
p. 81). L’oeuvre de Montaigne connaît un regain d’intérêt
dans les années 1660. On en retrouve, par exemple,
d’abondantes traces chez Molière. eut raison d’entériner la requête de celui
qui demandait permission de se tuer pour s’exempter de la tempête de sa femme.
Que ce mot de tempête exprime bien le bruit que fait une femme jalouse quand
elle se plaint, et montre bien que l’on n’en peut souffrir rien de pis que la
jalousie. Je veux bien
néanmoins que ce soit une preuve 4242 d’amour. Mais c’est une preuve
dont on ne se doit point servir et qui nuit plus qu’elle ne sert.
Un homme raisonnable ne se devrait toutefois point fâcher de la jalousie de sa femme, quand elle ne va pas jusque dans l’excès, la jalousie des femmes marquant d’ordinaire bien plus d’amour que celle des hommes, puisque la plupart des hommes ne sont jaloux que de leur réputation, et que les femmes ne sont jalouses que de leurs maris.
Comme j’ai fait voir dans le commencement de cette pièce qu’il y a peu de ces femmes jalouses dont je viens de parler, le beau sexe, loin d’en paraître fâché, doit me prêter sa voix pour m’aider à faire la guerre à ces furieuses, afin que, leur humeur étant changée, l’on ne trou-4343ve plus rien que de parfait parmi les dames.

Après avoir lu cette pièce, qui le fit rire en quelques endroits, il en relut ces lignes, qu’il trouva le plus à son goût : "La jalousie des femmes marquant d’ordinaire bien plus d’amour que celle des hommes, puisque la plupart des hommes ne sont jaloux que de leur réputation et que les femmes ne sont jalouses que de leurs maris."
Quand il eut achevé de lire cet endroit :
— Il me souvient, dit-il à Timandre, qu’avant que vous me donnassiez cette pièce, je vous avais demandé de quelle humeur était votre femme, et que vous ne m’aviez point fait de réponse.
— Vous auriez tort de vous plaindre, répondit Timandre et, depuis que vous m’avez parlé, je vous ai tant fait savoir de cho-4444ses sur ce sujet que je n’ai plus rien à vous dire. Je vois bien, continua-t-il en le regardant, que ce discours vous surprend. Mais sachez que cette pièce qui m’est tombée entre les mains et que vous venez de lire décrit entièrement l’humeur de ma femme, et que je crois qu’elle a servi de modèle à celui qui l’a composée. Six mois sont à peine passés depuis que je suis marié et depuis ce temps sa jalousie m’a pensé faire désespérer.
Il en eût dit davantage, s’il n’eût été interrompu par une personne qui avait des affaires avec lui, ce qui fut cause que ce parent sortit afin de les laisser seuls. Mais comme nous ne devons raconter que les affaires qu’il eut avec sa femme, laissons-les en repos, pour passer à quelque chose de plus divertissant. 4545
Comme Timandre avait épousé Clidamire plutôt pour l’amour de son bien que pour celui qu’il lui portait, il ne faut point s’étonner s’il n’eut point une grande attache pour sa femme et s’il ne fut pas de ceux qui font l’amour à leurs femmes aussi bien après que devant le mariage. Mais en revanche, il eut toute la reconnaissance qu’un honnête homme doit avoir : il lui fit tous les bons traitements imaginables, il ne lui refusa rien et la laissa vivre à sa fantaisie, afin de lui montrer par là qu’elle devait le laisser vivre à la sienne. Mais il se trompa bien, car sa trop grande complaisance donna trop de hardiesse à Clidamire et, comme peu à peu elle devint sans crainte pour lui, elle donna des marques publiques de sa ja-4646lousie et se plaignit hautement de son mari sans en appréhender la colère.
Timandre, de son côté, malgré l’humeur jalouse de sa femme, ne laissait pas que d’être souvent en compagnie et, comme il était aussi galant qu’il était bien fait, il se plaignait partout d’un mal qu’il ne ressentait pas toujours et parlait d’amour à toutes celles qui lui plaisaient.
Peu de temps après son mariage, Almaziane, qui était une parfaitement belle
fille, se rencontra
près de lui en une fête publique. Chacun peut s’imaginer ce que fait un galant
homme en une semblable rencontre, et le temps qu’il a de faire briller son
esprit dans la conversation jusqu’à ce que la fête 4747 commence.
Timandre employa bien ce temps et charma tellement Almaziane et sa mère qu’il
eut permission de les aller voir chez elles ; et, après quelques assiduités, il
surprit toute
l’estime de l’une et toute la tendresse de l’autre. Cela l’embarrassa,
parce qu’il avait fait croire qu’il n’était point marié, et que la mère
d’Almaziane lui dit que, puisqu’il témoignait tant d’ardeur pour sa fille, elle
consentait qu’il l’épousât. Sa bonne fortune le surprit et lui donna quelque
chagrin ; car il
n’osait faire savoir qu’il était marié, de crainte que l’on ne lui défendît de
voir Almaziane, pour laquelle il commençait à avoir plus que de l’estime, ce qui
le fit résoudre à promettre qu’il l’épouserait et à chercher en même 4848 temps des moyens pour différer toujours son mariage. Le premier qu’il trouva
fut de dire qu’il en avait écrit à un de ses plus proches parents, qui était en
Italie, et que, bien qu’il fût maître de lui-même Argante a donc plus de trente
ans, âge de la majorité matrimoniale en France au XVIIe siècle., il était bien aise d’en avoir la réponse
avant que de rien avancer.
Argante a donc plus de trente
ans, âge de la majorité matrimoniale en France au XVIIe siècle., il était bien aise d’en avoir la réponse
avant que de rien avancer.
Comme le hasard se mêle quelquefois dans les affaires sans en être prié, il arriva que Clidamire sut tout ce qui se passait d’un marchand qui allait souvent chez Almaziane et qui venait pareillement chez elle. La fureur la saisit tellement, lorsqu’elle apprit cette nouvelle, que, ne pouvant pas aller chez Almaziane, parce qu’elle était indisposée, elle écrivit dès le même moment à la mère et à la fille tout ce que l’on pouvait dire con-4949tre son mari et blâma même la mère d’Almaziane de ce qu’elle permettait trop facilement qu’on entretînt sa fille.
Quand Timandre retourna chez Almaziane, il fut bien étonné de voir la froideur avec laquelle on le reçut. La mère de cette belle demanda si, quand il aurait eu réponse de la lettre qu’il avait écrite en Italie, rien ne l’empêcherait de se marier et s’il n’avait point à Paris quelque autre inclination que sa fille. Almaziane, voyant qu’il restait interdit, prit la parole et dit qu’on lui faisait tort de croire que c’était l’amour qui l’empêchait de lui donner la main, puisqu’il n’avait que de la haine pour la personne qui s’opposait à son mariage. Il connut aussitôt qu’elle voulait parler de sa femme et 5050 se douta bien que quelqu’un avait dit qu’il était marié. Mais, comme il ne croyait pas qu’ils en fussent pleinement informés, il s’en défendit jusqu’à ce que l’on lui montrât la lettre de sa femme. Il ne l’eut pas plus tôt vue qu’il changea ses défenses en excuses et dit cent jolies choses sur la violence que faisait sur les cœurs la beauté d’Almaziane. Mais tout cela n’empêcha pas que l’on ne lui donnât son congé.
Au sortir de chez Almaziane, il s’en retourna chez lui et, loin de quereller sa femme de la lettre qu’elle avait écrite, il souffrit sans répondre un seul mot tous les discours que la plus forte colère et la plus forte jalousie peuvent faire dire à une femme.
Clidamire, connaissant par là 5151 que ses soupçons étaient bien fondés, veilla si bien sur les actions de son mari qu’elle en découvrit la meilleure partie. Elle troubla la plupart de ses divertissements et l’alla même souvent chercher jusque dans les compagnies où il était, pour faire éclater ses plaintes aux yeux de tout le monde. Mais, comme elle vit que cela ne lui servait de rien et que la plus grande partie du blâme retombait sur elle, elle se persuada que le véritable moyen de le faire changer était de le rendre jaloux, ce qu’elle résolut de faire, sans toutefois blesser sa vertu.
Quelque temps après avoir pris cette résolution, elle se trouva chez une de ses voisines, où il y avait compagnie et, en s’entretenant de diverses choses, l’on 5252 vint à parler de la jalousie. Clidamire combattit le sentiment de tous ceux qui la blâmèrent et se fit admirer en soutenant qu’une femme qui avait un mari jaloux était parfaitement heureuse. Chacun soutint le contraire, mais surtout Argante, qui était un des plus galants hommes de ce quartier, lequel toutefois, après avoir défendu longtemps le parti qu’il avait pris, dit à Clidamire qu’il lui cédait la victoire et qu’il ne s’était opposé à ses sentiments que pour avoir l’honneur d’être vaincu d’un si charmant adversaire.
Après cette dispute, on changea le sujet de la conversation. Argante et Clidamire ne s’y mêlèrent point et s’entretinrent ensemble. Dans cet entretien particulier, il lui promit de 5353 faire une pièce à l’avantage des femmes qui avaient des maris jaloux et d’y mettre la plupart des raisons qu’elle avait dites en leur faveur. Il lui demanda ensuite permission de l’aller voir chez elle, ce qu’elle lui permit. Il la fut voir deux jours après et elle ne l’eut pas plus tôt aperçu qu’elle lui demanda s’il lui avait tenu parole. Il lui répondit qu’oui en lui donnant la pièce qu’il avait faite. Elle l’ouvrit aussitôt et lut ce qui suit. 5454

Le bonheur des femmes qui ont des maris jaloux, ou l’apologie de la jalousie.
Tous ceux qui savent que les passions des femmes ne sont point médiocres, qu’elles haïssent avec excès, qu’elles aiment avec violence et qu’elles veulent être aimées de même, ne trouveront pas étrange qu’elles se tiennent heureuses d’avoir des maris jaloux, puisque leur jalousie est une preuve de leur amour, et que tout ce qui marque de l’amour ne peut déplaire à des personnes qui souhaitent d’être aimées comme elles ai-5555ment, c’est-à-dire avec beaucoup d’ardeur. Cependant la plus grande partie du monde se persuade que la jalousie est moins supportable que la haine et qu’elle ne peut donner que du chagrin à la personne aimée, ce qui m’a poussé à faire voir tous les plaisirs et tous les avantages qu’elle lui peut apporter.
Les jaloux ont de tout temps été si malheureux que, par une bizarrerie inconcevable, ils ont été blâmés de la plupart du monde, sans qu’il se soit jamais trouvé personne qui ait entrepris leur défense. Au contraire, l’on s’est toujours emporté et l’on a toujours déclamé contre eux. Ils n’osent montrer qu’ils craignent de perdre la personne qu’ils aiment, sans passer pour bizarres, importuns et ridicu-5656les, comme si la crainte de perdre une chose que l’on aime était un crime pour eux, lorsqu’elle est une marque d’amour et de raison pour tout le reste des hommes.
Comme cette crainte qu’ils ont de perdre la personne aimée vient de la beauté qu’ils y trouvent et de la pensée qu’ils ont que la beauté peut être aimée, l’on lui ôte tous les avantages qu’elle a eus jusqu’ici, afin d’avoir lieu de blâmer toutes leurs pensées et toutes leurs actions, et l’on veut qu’il y ait des hommes qui croient que la beauté (qui doit être adorée et à qui l’on a autrefois élevé des temples) ne soit pas seulement digne d’être aimée. Pourquoi veut-on ôter les avantages de la beauté, pour avoir lieu de blâmer les ja-5757loux ? Pourquoi ne veut-on pas qu’ils aient des sentiments si justes et si naturels, qui ont été de tout temps autorisés par la coutume et par la raison, et qui sont permis au reste des hommes, non seulement pour toutes les belles choses, mais encore pour toutes les belles personnes ?
Il y a plus de femmes que l’on ne s’imagine qui se plaignent de ce que l’on tâche à persuader à leurs maris qu’ils sont incommodes lorsqu’ils donnent de visibles preuves de leur amour et qu’ils sont souvent avec elles. Mais elles ont beau se plaindre, l’on a tellement ajouté foi à ceux qui ont blâmé et qui blâment tous les jours les jaloux, que présentement toutes les assiduités des maris auprès de leurs femmes passent pour des crimes. 5858La vertu des maris n’est pas seulement méprisée, mais elle passe pour ridicule : l’on n’ose faire son devoir sans s’exposer à la raillerie publique. Il semble que les hommes ne soient mariés que pour n’être plus avec leurs femmes, et les femmes que pour ne voir plus leurs maris. Du moins passent-ils pour importuns s’ils viennent chez eux avant que la nuit soit venue. Et s’ils demeurent quelques heures à leur logis pendant le jour, l’on plaint les femmes à qui cela arrive et l’on leur veut persuader qu’elles sont malheureuses. Elles ont beau témoigner le contraire et dire qu’elles sont ravies de voir ce qu’elles aiment près d’elles, l’on n’en veut rien croire et l’on dit que leur vertu les fait parler de la sorte. L’on veut enfin qu’elles 5959 vivent avec joie et avec plaisir, étant séparées d’une moitié sans laquelle elles ne peuvent goûter de vrais ni de légitimes plaisirs.
Puisque les femmes trouvent de la satisfaction dans ce que l’on dit que la
jalousie a de plus fâcheux, c’est-à-dire dans la compagnie de leurs maris,
voyons si elles en trouveront moins dans les autres effets que produit cette
passion. Si montrer la crainte que l’on a de perdre ce que l’on aime, si croire
que la beauté peut être aimée de la plupart de ceux qui la voient, et si
l’assiduité des maris auprès de leurs femmes passent pour trois grands crimes
chez ceux qui condamnent la jalousie, jugez des peines qu’ils disent que font
les soupçons Cf. la « Conversation des
soupçons » du tome II.
, bien qu’ils n’alarment jamais une 6060 honnête femme,
qu’ils ne servent qu’à faire connaître sa vertu et qu’ils lui causent bien des
plaisirs et des avantages, que je prétends faire voir, après avoir examiné ce
que ces critiques d’amour veulent qu’un amant et qu’un mari fassent pour faire
connaître leur passion.
Cf. la « Conversation des
soupçons » du tome II.
, bien qu’ils n’alarment jamais une 6060 honnête femme,
qu’ils ne servent qu’à faire connaître sa vertu et qu’ils lui causent bien des
plaisirs et des avantages, que je prétends faire voir, après avoir examiné ce
que ces critiques d’amour veulent qu’un amant et qu’un mari fassent pour faire
connaître leur passion.
Quoiqu’il n’y ait point d’amant qui ne doive craindre qu’un bien qui n’est pas
encore à lui ne lui échappe, et qui par cette raison ne doive
justement être
jaloux, puisque la jalousie d’un amant n’est autre chose que cette crainte, il
ne faut pas, s’il ne veut attirer sur lui la haine de sa maîtresse, qu’il
témoigne le moindre dépit, ni
qu’il fasse éclater le moindre ressentiment contre ses rivaux. Il faut qu’il
fasse bonne mine à ceux qui lui 6161 veulent ravir son bien et qui sont
quelquefois sur le point de venir à bout de leurs desseins. Est-il quelque chose
à quoi l’on impose de si dures lois qu’à la jalousie ? Quoi ! pour ne point
passer pour jaloux, il faut ne donner nulle preuve de son amour ? Il faut être,
ou du moins il faut paraître, insensible ? Il faut caresser ses ennemis ? Il
faut trouver le moyen de gagner une victoire sans combattre et sans montrer que
l’on a du courage ? C’est-à-dire qu’il faut attaquer un cœur sans se servir
d’amour pour le gagner, bien qu’il n’y ait que lui qui ait des armes assez fortes pour
l’obliger à se
rendre. Et si l’on ne fait toutes ces choses, l’on passe pour un importun et
pour un fâcheux, et le cœur que l’on poursuit, qui devrait être le
prix
6262 de celui qui a le plus d’amour, est souvent le prix de celui
qui paraît le plus insensible « Faut-il qu’un amant
soit jaloux ? » La question d’amour à laquelle s’efforce de répondre
tout ce passage compte parmi les plus fréquemment traitées à l’époque
des Nouvelles Nouvelles..
« Faut-il qu’un amant
soit jaloux ? » La question d’amour à laquelle s’efforce de répondre
tout ce passage compte parmi les plus fréquemment traitées à l’époque
des Nouvelles Nouvelles..
Si les preuves de l’amour d’un amant sont incommodes et lui doivent attirer la haine de sa maîtresse, au sentiment de ces aveugles critiques, celles d’un mari sont insupportables et le doivent faire haïr. Tout ce qui vient de lui déplaît, si l’on les en veut croire. Ils blâment son amour, ils en blâment les preuves ! Ils blâment sa jalousie, ils en blâment les effets ! Qu’appellerons-nous donc présentement amour, puisqu’ils condamnent ce qu’il produit et qu’ils ne le veulent plus reconnaître ? Ils veulent sans doute qu’il vive dans l’indifférence, puisque, lorsqu’un mari veut donner à sa femme des preuves de sa passion et lui mon-6363trer qu’il n’est pas indifférent pour elle, ils disent aussitôt qu’il est ennemi de son repos et de celui de sa femme. Ils veulent que l’on aime sans ardeur et sans en témoigner. Ils condamnent les soupçons et disent que tous ceux qui en ont haïssent en aimant et que toutes leurs actions marquent plus de haine que d’amour.
Mais, s’ils veulent que l’amour produise la haine, sera-ce la haine qui produira l’amour ? Les passions produiront-elles leur contraire pour autoriser leurs caprices et pour rendre leur cause meilleure ? Ou s’ils avouent, avec quelques-uns de leur parti qui ne sont pas si sévères qu’eux, que parmi cette haine on voit briller un peu d’amour, comment accorderont-ils ces deux grandes passions ? Deux choses si op-6464posées peuvent-elles subsister ensemble ? Peut-on haïr ce que l’on aime et que l’on ne cesse point d’aimer ?
Je veux toutefois que la
jalousie et les soupçons fassent quelque peine à la personne aimée. Cette peine
ne sert qu’à lui faire mieux goûter le plaisir qui la suit, de même que les
rigueurs de l’hiver font mieux goûter les douceurs du printemps. Que ces petites
querelles causées par la jalousie sont agréables en amour, qu’elles causent de
plaisirs, qu’elles causent de joie, qu’elles causent de doux ravissements ! Que
le plaisir de se faire la guerre et de se gronder quand on s’aime divertit
agréablement ! Que cette guerre plaît, que ce jeu d’amour est
charmant, qu’il est doux de se
raccommoder C’est le principe du « dépit amoureux », qui avait fait le
thème de la comédie homonyme de Molière, parue sous forme imprimée le 24
novembre 1662, quelques semaines avant la publication des
Nouvelles Nouvelles. après une querelle
que l’amour a fait naître ! Que 6565 le moment où l’on se raccommode
cause d’extases et qu’il fait bien avouer qu’un siècle de peines ne suffit pas
pour le bien payer ! Les plaisirs qu’il donne sont enfin si grands que, si l’on
les pouvait bien exprimer, ils paraîtraient incroyables pour la joie qu’ils font
ressentir. C’est pourquoi je me contenterai de dire que, si le plaisir que l’on
ressent pendant que dure la guerre que cause une querelle amoureuse est bien
grand, celui que l’on goûte lorsque l’on se raccommode n’est pas moindre.
C’est le principe du « dépit amoureux », qui avait fait le
thème de la comédie homonyme de Molière, parue sous forme imprimée le 24
novembre 1662, quelques semaines avant la publication des
Nouvelles Nouvelles. après une querelle
que l’amour a fait naître ! Que 6565 le moment où l’on se raccommode
cause d’extases et qu’il fait bien avouer qu’un siècle de peines ne suffit pas
pour le bien payer ! Les plaisirs qu’il donne sont enfin si grands que, si l’on
les pouvait bien exprimer, ils paraîtraient incroyables pour la joie qu’ils font
ressentir. C’est pourquoi je me contenterai de dire que, si le plaisir que l’on
ressent pendant que dure la guerre que cause une querelle amoureuse est bien
grand, celui que l’on goûte lorsque l’on se raccommode n’est pas moindre.
Mais nous voyons tous les jours, disent ces censeurs de la jalousie, que parmi ces petites querelles qui naissent des soupçons et qui causent tant de plaisirs, il en naît souvent quelqu’une qui dure longtemps, qui ne cause que de 6666 la haine, du chagrin et de la peine, à celui qui aime aussi bien qu’à la personne aimée, et qui, bien qu’elle finisse et qu’elle cause du plaisir en finissant, ne laisse pas que d’avoir causé toutes ces peines ; ce qui nous fait dire avec raison que la jalousie cause une infinité de maux, puisqu’elle les cause un temps.
Voilà l’une des plus fortes raisons qu’ils allèguent pour prouver tout ce qu’ils imputent à la jalousie et, quoiqu’ils disent que rien ne la peut détruire, je vais faire voir le contraire, en montrant ce que c’est que la haine d’un jaloux.
Si l’on jugeait de tout par l’apparence, sans doute que j’aurais bien de la peine à venir à bout de mon dessein, puisqu’à bien examiner certaines actions des 6767 jaloux, il semble qu’ils aient quelquefois plus de haine que d’amour pour celles qu’ils aiment. Cependant il est vrai de dire que, lorsqu’ils se plaignent le plus,
La haine est dans leur bouche et l’amour dans leur cœur. Vers de provenance non identifiée.
Vers de provenance non identifiée.
Voyons ce que c’est que cette haine qui ne pénètre pas jusqu’au cœur, et si elle peut faire souffrir quelque peine à l’objet aimé.
Les femmes qui ont quelquefois été les objets de cette sorte de haine connaissent que l’amour l’accompagne et qu’il tâche de s’en couvrir pour se cacher quelque temps. Mais, quoi qu’il fasse, il en paraît toujours quelque chose, elle n’est pas assez grande pour le couvrir tout à 6868 fait et, bien qu’il veuille que cette haine lui serve de voile, ce voile est trop petit et trop délié pour le cacher, son éclat le perce et le fait reconnaître au travers, et l’on peut dire que l’amour est derrière la haine que causent la jalousie et les soupçons, comme le soleil, qui ne laisse pas que d’éclairer quand il est couvert de quelques nuages. La personne aimée, qui sait les effets qu’elle a coutume de produire, ne s’alarme point et demeure seule sans crainte, pendant que tout le monde la plaint et craint pour elle. Elle sait que la fin ne lui en peut être qu’avantageuse et que cette haine ressemble à ces orages passagers qui ne servent qu’à rendre, après qu’ils sont passés, le jour plus beau et le calme plus agréable, ce qui lui donne de la 6969 joie même pendant que l’orage dure.
Comme ce que je viens de dire de cette haine, qui ne peut empêcher l’amour de paraître et qui n’est causée que par la jalousie et les soupçons, ne la fait pas assez connaître, je crois qu’il ne sera pas hors de propos d’en dire encore un mot.
Ce que l’on appelle haine est une passion qui ne peut souffrir les objets qui la font naître, ni même en entendre parler sans fureur, qui ne souhaite que du mal, qui ne veut point que l’on l’apaise, qui n’a que des transports furieux, qui n’aime que la guerre et la trahison, qui menace sans cesse et qui fait gloire de paraître invincible. Au contraire, celle dont j’ai déjà commencé à parler n’a rien qui lui ressemble, elle aime 7070 avec une ardeur démesurée ceux qui la font naître, elle n’en entend parler qu’avec joie, elle ne leur souhaite que du bien, elle n’a que des transports d’amour. Aussi peut-on justement l’appeler une haine d’amour, puisqu’elle n’est engendrée que d’un excès de cette passion et qu’elle n’aime et ne recherche que la paix. Elle ne veut point être éternelle, elle ne naît qu’afin que l’on la fasse mourir, elle ne crie qu’afin que l’on l’apaise et, si l’autre veut perdre les objets qui la font naître et ne les hait que parce qu’ils lui sont insupportables, celle-ci les veut gagner et ne les hait que parce qu’elle les aime. Ce n’est enfin qu’un amour en colère, qui demande à être caressé. Il a beau se déguiser et prendre le nom, le visage et la parole de la haine, 7171 l’on le reconnaît toujours et l’on ne le craint point, parce que l’on sait qu’il ne saurait qu’aimer, quand même il aurait la volonté de haïr. Celle qui disait à son amant
Oui, ma haine pour toi va jusques à l’extrême Vers de
provenance non identifiée. ,
Vers de
provenance non identifiée. ,
Si l’on peut toutefois
haïr ce que l’on aime,
prouve bien cette vérité et fait voir qu’encore que la haine soit quelquefois dans la volonté d’une personne qui aime, elle n’est jamais en son pouvoir.
Voilà la différence qu’il y a de la haine à la haine, c’est-à-dire de la haine ordinaire à celle que la jalousie et les soupçons font naître dans un cœur. La dernière y peut régner avec l’amour, et l’au-7272tre ne le peut, parce que (comme j’ai déjà dit) il est impossible d’aimer et de haïr dans un même temps.
Je veux toutefois, pour convaincre entièrement ceux qui blâment la jalousie et pour leur montrer qu’elle ne cause pas tant de maux, qu’ils assurent qu’il ne soit rien de tout ce que j’ai dit, qu’un homme ait des soupçons qu’il croit légitimes, que toutes les apparences ne semblent point trompeuses et que cela lui fasse concevoir une haine si forte pour la personne qu’il aime qu’il soit impossible de l’exprimer : qu’est-ce que la haine d’un amant ? qu’est-ce que la haine d’un mari ? ceux qui s’y sont fiés n’ont-ils pas toujours été déçus ? que faut-il pour l’étouffer et pour la détruire entièrement ? que faut-il pour rallumer un feu qu’ils n’é-7373teignent que malgré eux et qu’ils souhaitent de rallumer ? Un regard mêlé de douceur, un soupir, une larme, un mot de justification apaisent bientôt leur haine, bien qu’elle paraisse implacable, et font avouer qu’il est vrai
Qu’un dépit éclairci rallume un fort amour Ce vers sera repris dans La Mère coquette
(1665) de Donneau, à la scène III, de l’acte 1. .
Ce vers sera repris dans La Mère coquette
(1665) de Donneau, à la scène III, de l’acte 1. .
Jamais deux personnes ne sont mieux unies et ne font voir plus d’ardeur qu’après une semblable querelle. Celle qui semble avoir le plus souffert parce que l’on lui faisait injustice reçoit un plaisir beaucoup plus grand que n’a été sa peine : elle voit un homme à ses pieds qui s’excuse, qui lui demande pardon, qui craint de n’être pas aimé, après 7474 avoir osé la soupçonner d’infidélité, qui la caresse, qui la prie, qui paraît honteux et confus de son crime, et qui est enfin plus soumis et plus passionné que jamais.
Outre le plaisir et la joie que causent à une femme ce dépit éclairci et cette ardeur renouvelée, elle en reçoit encore de grands avantages, puisqu’elle se peut servir de ce temps où l’on ne lui peut rien refuser pour demander ce qu’elle n’obtiendrait peut-être pas en un autre, et puisqu’un pareil accommodement ne se peut faire sans que l’on reconnaisse sa vertu : c’est pourquoi, quand la jalousie d’un homme ne servirait qu’à lui faire connaître la vertu de celle qu’il aime, c’est toujours beaucoup, et pour l’un et pour l’autre, et ils en doivent tous deux être ravis, puisqu’il y a bien 7575 des choses que l’on ne connaît pas faute de les avoir éprouvées, et qu’un jaloux peut répondre de la vertu de sa femme, ce que ne peut un indifférent, qui ne s’est jamais mis en peine de savoir si elle en avait ou non.
J’ai déjà fait voir que les femmes se réjouissaient plus que l’on ne s’imaginait d’avoir souvent leurs maris auprès d’elles. Mais, comme je n’en ai point fait voir les raisons et que c’est une chose que les ennemis de la jalousie ne peuvent croire, je me persuade qu’il ne sera pas hors de propos d’en parler.
Puisqu’il n’y a point de plaisir égal à celui d’être avec ce que l’on aime, l’on ne doit pas s’étonner si les femmes qui aiment leurs maris souhaitent qu’ils soient souvent chez eux. Elles se 7676 plaignent quand ils n’y demeurent guère ; elles deviennent jalouses, elles se figurent qu’ils les haïssent et qu’ils les fuient ; elles croient qu’ils se plaisent partout où elles ne sont pas et qu’ils ne se souviennent pas même s’ils sont mariés. Elles s’imaginent qu’ils font de grandes dépenses, comme il n’est souvent que trop vrai ; elles pleurent, elles se tourmentent, elles se plaignent et souffrent les peines du monde les plus cruelles, sans que leurs chagrins, leurs larmes et leurs plaintes les puissent soulager. Ce sont des maux auxquels elles ne peuvent trouver de remèdes, il n’y a que la jalousie de leurs maris qui les en puisse guérir, puisque les maris jaloux sont presque toujours chez eux, qu’ils sont assidus auprès de leurs femmes, 7777 qu’ils ne leur donnent point de soupçons, qu’ils leur donnent lieu de voir ce qu’elles aiment, en les voyant, et de croire qu’elles sont aimées. Ce qui fait voir qu’il y a des femmes qui voudraient que leurs maris fussent toujours auprès d’elles.
S’il se trouve des femmes qui souhaitent que leurs maris soient presque toujours au logis, il se trouve des maris jaloux qui ne permettent pas souvent à leurs femmes d’en sortir. Mais, comme ils en ont de tous temps été blâmés et que l’on veut faire passer leurs femmes pour des malheureuses et pour des captives, voyons si elles sont si malheureuses que l’on le veut faire croire.
Les maris qui voient que leurs femmes leur obéissent sans ré-7878pugnance et qui connaissent que cette obéissance est une marque de l’amour qu’elles ont pour eux, redoublent celui qu’ils ont pour elles et les caressent extraordinairement, ce qu’elles souhaitent fort. Cette obéissance leur est encore avantageuse, en ce qu’elle fait voir le pouvoir qu’elles ont sur elles, chose très rare et qui n’apporte pas aux femmes une médiocre gloire. Quoiqu’elles soient presque toujours chez elles, elles n’en travaillent pas plus, si elles ne veulent. Leurs maris, qui ne souhaitent que leur embonpoint et qui ne souhaitent pas qu’elles se donnent de la peine, prennent eux-mêmes le soin du dedans aussi bien que du dehors. Ils ne les laissent manquer de rien, ils cherchent tout ce qui les peut contenter, ils leur 7979 apportent tous les jours des hardes les plus nouvelles et les plus belles qu’ils puissent trouver. Il n’est point de femmes, enfin, qui soient plus ajustées que celles qui ont des maris jaloux, ce qui ne les satisfait pas peu, puisque l’ambition de paraître est du moins aussi forte en elles que l’amour.
Si toutes les femmes étaient de même humeur, si elles aimaient toutes leurs maris, s’il n’y en avait point de coquettes et qui aimassent à avoir des galants et à être courtisées, peut-être aurais-je assez bien prouvé que la jalousie n’est pas si incommode que l’on s’est jusqu’ici persuadé. Mais, comme il paraît impossible de faire voir qu’elle ne gêne pas de semblables femmes, l’on dira sans doute que je ne puis venir à bout de mon dessein.
Je souhai-8080terais qu’il fût vrai et que la jalousie leur causât de si gênantes inquiétudes et de si cruelles peines qu’elle les obligeât à vivre d’une autre manière. Mais elles ont tant d’esprit et tant d’adresse qu’elles savent tout tourner à leur avantage. De plus, pour ce qui regarde la jalousie de leurs amants, l’on sait assez que quand elles ne sont encore que filles, elles ne les tourmentent qu’autant qu’il leur plaît, puisqu’ils n’ont aucun pouvoir sur elles.
Il n’en va pas de même de leurs maris, qu’elles doivent craindre et à qui elles doivent obéir. Leur jalousie les incommode et les captive, du moins à ce que l’on se persuade. Cependant il est vrai qu’elles en tirent de grands avantages, comme nous allons voir.
L’ambition de ces sortes de 8181 femmes étant d’être adorées et d’avoir
bien des galants, la jalousie de leurs maris, loin d’empêcher qu’elles en aient,
leur en attire beaucoup Le paradoxe du comportement
masculin jaloux, qui produit l’effet contraire à celui souhaité, avait
fait le sujet de L’Ecole des maris et L’Ecole des
femmes de Molière, qui tenaient l’affiche au Palais-Royal à
l’époque de la composition des Nouvelles Nouvelles.
L’idée était également formulée dans l’essai « Sur des vers de Virgile »
(III, 5, éd. de 1649, p. 881) (voir également notes p. 41 et 41sic). . Les
uns leur font la cour, parce qu’ils s’imaginent que la haine qu’elles doivent
avoir pour leurs tyrans (car c’est ainsi qu’ils appellent leurs maris) les fera
venir plus facilement à bout de leurs desseins ; les autres, parce qu’ils se
persuadent que, si une femme qui peut causer de la jalousie n’est pas
parfaitement belle, elle doit du moins avoir quelque chose de beau ; les autres,
parce qu’ils se figurent qu’il y a beaucoup de plaisir à tromper un jaloux ; et
les derniers, enfin, parce qu’ils croient qu’il y a beaucoup de gloire et que
c’est une marque d’esprit. Ainsi la jalousie de leurs 8282 maris est
cause qu’elles ont ce qu’elles souhaitent, c’est-à-dire une foule extraordinaire
d’amants.
Le paradoxe du comportement
masculin jaloux, qui produit l’effet contraire à celui souhaité, avait
fait le sujet de L’Ecole des maris et L’Ecole des
femmes de Molière, qui tenaient l’affiche au Palais-Royal à
l’époque de la composition des Nouvelles Nouvelles.
L’idée était également formulée dans l’essai « Sur des vers de Virgile »
(III, 5, éd. de 1649, p. 881) (voir également notes p. 41 et 41sic). . Les
uns leur font la cour, parce qu’ils s’imaginent que la haine qu’elles doivent
avoir pour leurs tyrans (car c’est ainsi qu’ils appellent leurs maris) les fera
venir plus facilement à bout de leurs desseins ; les autres, parce qu’ils se
persuadent que, si une femme qui peut causer de la jalousie n’est pas
parfaitement belle, elle doit du moins avoir quelque chose de beau ; les autres,
parce qu’ils se figurent qu’il y a beaucoup de plaisir à tromper un jaloux ; et
les derniers, enfin, parce qu’ils croient qu’il y a beaucoup de gloire et que
c’est une marque d’esprit. Ainsi la jalousie de leurs 8282 maris est
cause qu’elles ont ce qu’elles souhaitent, c’est-à-dire une foule extraordinaire
d’amants.
Si cette jalousie, me dira-t-on, est cause qu’elles ont beaucoup d’amants, ces amants ne les garantissent pas de la mauvaise humeur de leurs maris, puisqu’au contraire elle l’excite. Elle l’excite, il est vrai, et c’est toutefois de là qu’elles tirent de grands avantages ; car, comme elles sont adroites, elles savent bien se déguiser et, pour peu qu’elles les caressent , elles les apaisent quand il leur plaît.
Cependant, elles veulent bien que l’on croie qu’elles en sont maltraitées, parce qu’elles se servent de cette mauvaise humeur de leurs maris pour donner congé à ceux qu’elles n’aiment pas, ainsi que pour faire 8383 croire à ceux qu’elles aiment qu’elles souffrent beaucoup pour l’amour d’eux et qu’elles courent risque d’éprouver ce que peut la fureur d’un jaloux irrité, ce qui fait que les amants qui s’en voient bien traités ressentent une joie qui n’est pas imaginable. Ils croient que l’on les aime éperdument, ils prennent les moindres marques d’amitié pour de grandes et signalées faveurs, à cause du danger où ils s’imaginent que s’exposent celles qui les leur donnent. Ils ne savent comment les en remercier, ils leur font de grands présents, qu’elles reçoivent avec plaisir, ce qui me donne lieu de dire, avec beaucoup de raison, que la jalousie de leurs maris ne leur nuit pas, comme l’on s’imagine, puisqu’elle leur fait avoir tout ce qu’elles dé-8484sirent, qu’elle leur fait augmenter le nombre de leurs adorateurs, qu’elle leur donne sujet de bannir d’auprès d’elles ceux qu’elles haïssent, sans qu’ils s’en doutent, qu’elle les fait passer pour belles et qu’elle leur fait enfin avoir des présents considérables.
Voilà tout ce que je vous puis dire touchant le bonheur des femmes qui ont des maris jaloux. Je vous ai fait voir du plaisir, de la joie et d’autres avantages considérables dans tout ce que l’on dit que la jalousie a de plus fâcheux, et je crois n’avoir rien oublié pour vous montrer que ces maux causent de grands biens. Vous avez vu qu’elle sert à faire connaître la beauté, la vertu, l’esprit, les mérites et toutes les autres belles qualités d’une femme ; qu’elle est égale-8585ment avantageuse à celles qui ne sont pas mariées et à celles qui le sont, aux vertueuses et aux coquettes ; que sans elle l’amour perdrait peu à peu toute sa chaleur, puisqu’il n’y a qu’elle qui la réveille, qui lui serve de nourriture et qui lui fasse trouver de nouveaux plaisirs, et que tous ses effets ne sont que des marques d’amour et ne causent que des peines que l’on doit plutôt souhaiter que craindre.
Tout cela étant, comme je vous ai montré, l’on peut dire que l’amour qui n’est point accompagné de la jalousie est imparfait, qu’il ne cause point de plaisir, qu’il est languissant, qu’il est assoupi, qu’il ne se sent pas lui-même, qu’il ne saurait qu’à peine connaître s’il est en vie, et qu’enfin il ne peut vivre longtemps en cet état.

8686
Clidamire, après avoir lu cette pièce avec une joie qui paraissait assez sur son visage, dit en souriant à Argante qu’elle se persuadait qu’il ne croyait pas qu’elle fût du nombre de celles qu’il décrivait dans la fin de sa pièce, encore qu’elle souhaitât d’avoir un mari jaloux. Il lui répondit qu’il n’avait jamais eu cette pensée et que ce qu’il en avait fait était afin que l’on ne lui pût dire qu’il eût rien oublié, et qu’il croyait ne faire tort à personne, puisque c’était une vérité généralement reçue que tout le monde n’était pas d’une même humeur et n’avait pas les mêmes inclinations.
Ensuite ils s’entretinrent de diverses choses et, bien que Clidamire eût beaucoup d’esprit, elle ne ressemblait pas néanmoins à celles qui aiment mieux 8787 dire ce qu’elles devraient cacher que de garder le silence, ce qui fut cause qu’elle dit à Argante tout ce qu’elle put s’imaginer contre son mari et le peu d’amour qu’elle croyait qu’il eût pour elle. Argante, qui était de ces gens qui ne cherchent qu’à se divertir et qui se flattent facilement, tira de ce discours des conséquences avantageuses pour lui, bien qu’elle ne l’eût fait que pour fournir à la conversation. Il crut qu’elle ne le haïssait pas et que, pour peu qu’il se mît en devoir d’attaquer cette place, la conquête lui en serait facile. Mais il se trompa, car la vertu de Clidamire fit voir que celles qui disent librement leurs sentiments sont d’ordinaire les plus farouches lorsque l’on en veut tirer quelque avantage, ce que l’expérience 8888 confirme tous les jours.
Argante commençait déjà à songer à ce qu’il devait faire pour ne pas laisser
échapper le bonheur que la fortune semblait lui présenter, lorsque Clidamire lui
dit qu’elle était persuadée que, pour faire changer son mari, elle devait le
rendre jaloux, qu’elle en trouverait bien les moyens et que, pour cet effet,
elle avait résolu de se servir de lui en cas qu’il y consentît. Ce fut à ce coup
qu’il crut que la fortune voulait tout faire pour lui Comme les héros des nouvelles narrées au tome I, Argante
s’interroge sur le rôle de la fortune dans les événements humains et la
manière dont l’individu doit en tirer parti. et qu’elle
voulait le rendre heureux, sans que de lui-même il contribuât en rien à son
bonheur. Il s’offrit de la servir en tout ce qui lui plairait et, comme il était
de ceux qui n’examinent jamais à quoi ils s’engagent et qui ne craignent jamais
rien, il se mit peu en peine 8989 de ce que le mari de Clidamire
pourrait faire, pourvu qu’il vînt à bout de ses desseins.
Comme les héros des nouvelles narrées au tome I, Argante
s’interroge sur le rôle de la fortune dans les événements humains et la
manière dont l’individu doit en tirer parti. et qu’elle
voulait le rendre heureux, sans que de lui-même il contribuât en rien à son
bonheur. Il s’offrit de la servir en tout ce qui lui plairait et, comme il était
de ceux qui n’examinent jamais à quoi ils s’engagent et qui ne craignent jamais
rien, il se mit peu en peine 8989 de ce que le mari de Clidamire
pourrait faire, pourvu qu’il vînt à bout de ses desseins.
Voici par où ils commencèrent à donner de la jalousie à Timandre. Clidamire, qui avait gagné les gens de son mari, sut qu’il avait un jour fait partie pour aller promener autour de Paris avec quelques dames. Elle apprit même l’endroit où cette compagnie devait aller faire la collation et, comme c’était en un lieu où la bourse fait bien recevoir tous ceux qui y viennent, elle résolut de se servir de cette occasion pour commencer ce qu’elle avait entrepris. Et, pour cet effet, elle choisit trois ou quatre personnes avec Argante et fit partie pour s’aller promener et pour aller faire collation au même lieu où devait aller son mari.
Elle joua 9090 si bien son rôle qu’elle se rencontra dans une chambre proche de celle où il était, d’où elle pouvait voir ce qu’il faisait et en être vue pareillement. Elle se mit à table auprès d’Argante, elle l’entretint presque toujours et lui parla plusieurs fois à l’oreille, et le fit même dans le temps où elle voyait que l’on la regardait. Ceux qui étaient avec Timandre feignirent de ne connaître pas que ce fût sa femme et ne lui en témoignèrent rien. Cela n’empêcha pas néanmoins qu’il n’aperçût que la prudence leur faisait fermer les yeux et qu’ils la connaissaient fort bien. Il n’en parut toutefois pas plus triste et fut aussi enjoué qu’à son ordinaire, tellement que la joie parut dans ces deux compagnies, bien que Timandre et Clidamire 9191 ressentissent dans leurs cœurs des mouvements bien contraires à ceux que la joie a coutume d’inspirer.
Timandre, étant le soir de retour chez lui, au lieu d’être de mauvaise humeur et de se plaindre, parut plus gai qu’il n’avait accoutumé et crut que c’était le véritable moyen d’empêcher sa jalouse de le suivre partout ; car il crut bien qu’elle n’était venue au lieu où il était qu’à ce dessein, ce qui l’empêcha de tirer aucune conjecture du fréquent entretien qu’elle avait eu avec Argante. Clidamire n’en usa pas de même : elle lui fit tout à fait mauvaise mine et eut toutes les peines du monde à ne le pas quereller, et son dépit était d’autant plus grand que Timandre montrait de la joie, loin de montrer de la jalousie. C’est pourquoi elle se ré-9292solut de poursuivre ce qu’elle avait commencé, quoique sans effet, pour voir s’il était incapable d’en recevoir.
Quelques jours après, sachant que Timandre était aux Tuileries, accompagné des mêmes dames avec qui il avait été promener, elle s’y rendit en diligence avec Argante et une femme de chambre seulement et, l’y ayant aperçu de loin, après avoir fait deux ou trois tours, elle donna exprès une commission à cette femme de chambre, afin d’avoir lieu de passer devant lui accompagnée seulement d’Argante, ce qu’elle fit deux ou trois fois.
Pendant le temps qu’elle passait, Timandre et ceux avec qui il était s’entretenaient d’une femme de leur compagnie qui avait l’humeur tout à fait enjouée et qui 9393 avait le privilège de dire tout ce qu’elle voulait sans que personne s’en offensât. Cette belle se servit de cette occasion pour railler Timandre, à qui elle dit que, puisqu’il lui était permis de dire librement toutes ses pensées, elle n’avait jamais vu d’homme mieux fait, ni plus galant, que celui qui venait de passer avec sa femme et qu’elles avaient déjà trouvé à la campagne. Bien que Timandre connût que l’on le voulait railler, il n’en parut aucunement fâché et répondit à cette dame qu’il avait toujours dit à sa femme qu’elle ne prît jamais de galant qu’il ne fût également spirituel et bien fait, et qu’il était bien aise d’apprendre qu’elle eût eu assez d’esprit pour faire un bon choix.
Il dit cent jolies choses le reste du temps qu’il fut avec cette 9494 belle compagnie. Il rendit le change à celle qui l’avait voulu railler et se railla lui-même le plus agréablement du monde. Mais il n’en eut pas plus tôt pris congé qu’il fit réflexion sur tout ce qui s’était passé les deux fois qu’il avait trouvé Argante avec sa femme et, se ressouvenant qu’il l’avait vu plusieurs fois lui parler à l’oreille, et qu’elle ne se plaignait plus de lui, bien qu’elle en eût plus de sujet qu’à l’ordinaire, il crut qu’elle l’aimait effectivement, et ce fut pour lors qu’il connut (bien qu’il eût fait dessein de n’être jamais jaloux) que l’on le peut être malgré soi et que, bien que l’on se soucie peu d’une femme, le dépit qu’on a de se voir raillé peut inspirer une plus forte jalousie que celle que cause la crainte que l’on a de perdre un objet que l’on 9595 aime et de voir que d’autres aient part à un bien que l’on doit posséder seul.
Quand il fut de retour chez lui, il ne put s’empêcher de témoigner son ressentiment à sa femme, qui ne manqua pas d’éclater de son côté et de faire plus de bruit que lui. Ils se raccommodèrent toutefois et promirent de ne se donner plus l’un l’autre aucun sujet de jalousie. Les caresses et les nouvelles protestations d’amour qui ont coutume de suivre de pareils accommodements ne manquèrent point dans celui-ci et Timandre demeura plus souvent auprès de sa femme qu’il n’avait jamais fait.
Ainsi Clidamire obtint ce qu’elle souhaitait. Elle ne se repentit point d’avoir rendu son mari jaloux et résolut de le faire encore, sitôt qu’il 9696 recommencerait à vivre comme il avait déjà fait.
Mais, comme ce n’est pas une chose peu difficile de changer des inclinations que l’on a longtemps gardées et que, quelque résolution que l’on prenne de les abandonner, l’on n’est jamais assez maître de soi-même pour en pouvoir venir à bout, Timandre cessa bientôt de se gêner et reprit sa manière de vivre accoutumée ; ce que connaissant Clidamire, elle résolut de ne se point plaindre et de se servir, pour le ramener, du même moyen dont elle s’était déjà si bien trouvée.
Elle était dans cette résolution, lorsque Timandre lui dit qu’il avait affaire pour quelques jours à la campagne et qu’il était obligé d’y faire un voyage. Dans un autre temps, Clidamire n’aurait 9797 pu retenir ses larmes, ni s’empêcher de prier mille fois son époux de ne point faire ce voyage, ou du moins de faire en sorte de n’y être pas longtemps. Mais la résolution qu’elle avait prise fut cause qu’elle empêcha sa tristesse de paraître et qu’elle poussa Timandre à partir.
À peine fut-il hors de la ville qu’elle fut chez une de ses parente, qui l’aimait fort. Et, comme elle s’était efforcée de cacher sa tristesse aux yeux de son mari, elle n’y fut pas plus tôt entrée que ses larmes, qui depuis longtemps cherchaient un passage, sortirent avec d’autant plus de précipitation qu’elles avaient été retenues et firent paraître sur son visage toutes les marques d’une vive douleur, qui n’était causée que par la crainte qu’elle avait 9898 que Timandre ne fût allé à la campagne que pour se divertir. Cette parente, la voyant en cet état, l’obligea de demeurer chez elle jusqu’au retour de son mari, ce qu’elle fit volontiers.
Comme ce n’était en effet qu’un voyage pour se divertir, Timandre revint au bout de huit jours, ce qu’ayant appris Clidamire, elle se fit ramener chez elle par Argante, afin de donner derechef de la jalousie à son mari, ce qui réussit comme elle se l’était imaginé. Il se mit en colère, elle en fit de même et, bien qu’il eût fait secrètement sa partie et qu’il n’eût mené aucun de ses gens avec lui, feignant d’aller en poste, afin que Clidamire n’en pût rien apprendre, elle ne laissa pas néanmoins de parler comme si elle eût tout su, ce qui l’embarrassa fort et l’obligea à 9999 faire la paix avec elle, paix qui se conclut aussi facilement entre le mari et la femme qu’elle est difficile entre les grands princes.
Quoique vouloir donner des sujets de jalousie à son mari soit une entreprise qui doive être funeste à celle qui l’entreprend, Clidamire en avait néanmoins si bien usé jusque là qu’elle n’avait jamais donné aucun sujet à Timandre d’être jaloux d’elle que lorsqu’elle en avait un plus grand et un plus visible de l’être de lui, ce qui l’empêcha d’éclater, comme il aurait peut-être fait en un autre temps. Mais comme les choses ont souvent des suites que l’on ne prévoit pas toujours, voyons si les moyens dont Clidamire s’est toujours servie pour faire changer son mari continueront de lui être avantageux.
Après l’ac-100100commodement dont nous venons de parler, Timandre sembla encore avoir changé sa première manière de vivre : il demeura souvent au logis, mais il ne caressa pas tant sa femme que la première fois, ce qui fit croire qu’il commençait tout de bon à être jaloux et qu’il ne demeurait chez lui que pour l’observer. Cela ne laissa pas que de satisfaire beaucoup Clidamire, qui en un besoin eût mieux aimé être maltraitée de son mari que de le voir sortir de chez lui. Il se lassa toutefois bientôt d’y demeurer et, comme il agissait contre son naturel, il ne se put résoudre à être si longtemps le geôlier de sa femme.
Pendant tout le bon ménage de Timandre, Clidamire avait prié Argante de ne le point venir voir, 101101 et même de ne lui point parler, en quelque lieu qu’il la pût rencontrer, ce qui fut cause que, sitôt que son mari eut repris ses premières habitudes, elle lui écrivit de la venir trouver. Argante ne manqua pas de faire ce qu’elle lui ordonnait et le fit même plus souvent qu’il n’avait point accoutumé et, comme il avait ses desseins aussi bien que Clidamire, il prit soin d’éviter la vue de Timandre, ce que cette vertueuse personne ayant remarqué, elle lui dit un jour qu’elle connaissait bien ses desseins et que, s’il voulait davantage l’obliger, il le fît sans intérêt et sans espérer tirer aucun profit de la mésintelligence qui était quelquefois entre son mari et elle, ou bien qu’il ne la vît jamais.
Argante connut bien que le soin qu’il avait d’éviter la pré-102102sence de Timandre et les marques d’amour qu’il avait commencé de lui donner lui avaient fait découvrir ses desseins. C’est pourquoi il se résolut d’abandonner tout au hasard et vint souvent chez Clidamire sans prendre aucun soin de se cacher de son mari. Il se résolut toutefois, afin de n’avoir point le regret de n’avoir pas fait tout ce qu’il pouvait pour obliger la fortune à le favoriser, de faire quelque présent considérable à Clidamire et, pour cet effet, il prit quelques diamants qu’il avait et les porta chez un orfèvre de ses amis, qu’il pria de lui faire une paire de bracelets de diamants et d’en ajouter aux siens ce qu’il en faudrait, car il n’en avait pas assez pour cela.
Pendant que l’on travaillait à ces bracelets, il continua de voir 103103
Clidamire aussi souvent qu’à l’ordinaire, et même sans se cacher de Timandre,
qui jouait un personnage qui étonnait tout le monde ; car plus
Argante venait chez lui, moins il paraissait s’en soucier : il lui faisait
bonne mine Timandre se comporte comme un de ces « maris
bénins », sur lesquels Arnolphe déverse ses moqueries (L’Ecole
des femmes, I, 1, v. 27-34), se divertissait
comme il avait de coutume et n’en parlait à sa femme non plus que si Argante
n’eût jamais été au monde, ce qui mettait Clidamire au désespoir, parce qu’elle
ne savait plus que faire pour rendre son mari jaloux (car elle ne savait pas
qu’il l’était plus que jamais et que tout ce qu’il faisait n’était que pour
examiner tout ce qui se passerait). Elle faisait venir Argante à toute heure,
elle le voyait le soir, elle le voyait le matin, elle lui parlait à l’oreille en
présence de Timandre, sans qu’il en témoignât rien 104104 et qu’il fît
même semblant de s’en apercevoir. Et si les choses eussent demeuré plus
longtemps en même état, elle eût puissamment querellé son mari de ce qu’il ne la
querellait pas. Il avait toutefois bien résolu de le faire, mais il attendait
pour éclater qu’il eût de plus visibles preuves de son amour, et capables de
servir au dessein qu’il avait de les produire quand il en serait temps.
Timandre se comporte comme un de ces « maris
bénins », sur lesquels Arnolphe déverse ses moqueries (L’Ecole
des femmes, I, 1, v. 27-34), se divertissait
comme il avait de coutume et n’en parlait à sa femme non plus que si Argante
n’eût jamais été au monde, ce qui mettait Clidamire au désespoir, parce qu’elle
ne savait plus que faire pour rendre son mari jaloux (car elle ne savait pas
qu’il l’était plus que jamais et que tout ce qu’il faisait n’était que pour
examiner tout ce qui se passerait). Elle faisait venir Argante à toute heure,
elle le voyait le soir, elle le voyait le matin, elle lui parlait à l’oreille en
présence de Timandre, sans qu’il en témoignât rien 104104 et qu’il fît
même semblant de s’en apercevoir. Et si les choses eussent demeuré plus
longtemps en même état, elle eût puissamment querellé son mari de ce qu’il ne la
querellait pas. Il avait toutefois bien résolu de le faire, mais il attendait
pour éclater qu’il eût de plus visibles preuves de son amour, et capables de
servir au dessein qu’il avait de les produire quand il en serait temps.
Mais si le hasard, qui est quelquefois bien perfide et bien méchant, ne lui eût donné le moyen d’en avoir, il eût sans doute attendu longtemps, Clidamire ayant trop de vertu pour rien faire contre son honneur. Voici donc comme le hasard la rendit la plus malheureuse personne du monde et, bien que l’on puisse dire qu’elle fût en quelque façon cause de son mal-105105heur, il est néanmoins certain qu’elle ne contribua en rien à la fin de cette histoire, comme nous allons voir.
Comme Timandre promenait un jour son chagrin, un orfèvre qui lui avait autrefois vendu quantité de pièces curieuses le pria d’entrer chez lui, l’assurant qu’il avait eu depuis peu bien des curiosités qu’il serait bien aise de voir. Timandre y entra et, après avoir considéré tout ce qu’il y avait de beau, il jeta les yeux sur un des gens de l’orfèvre, qui travaillait à de fort beaux bracelets. Il demanda pour qui c’était. On lui dit que c’était pour un gentilhomme de son quartier nommé Argante. Il demanda quand ils seraient achevés et on lui répondit que l’on les devait rendre le lendemain. 106106 Il ne demanda rien davantage, mais il se douta aussitôt qu’ils étaient destinés à sa femme, et crut qu’en s’éclaircissant là-dessus il découvrirait tout ce qu’il voulait savoir.
Argante, ayant eu le lendemain ses bracelets, rêva quelque temps à ce qu’il devait faire et se résolut enfin d’écrire tout de bon à Clidamire ce qu’il n’avait fait que lui faire pressentir, c’est-à-dire qu’il était amoureux d’elle. Les raisons qui le poussèrent d’agir de la sorte furent en grand nombre : il voyait que Timandre le souffrait tous les jours chez lui sans donner le moindre signe de jalousie, qu’il continuait de vivre comme il avait toujours fait, et Clidamire en montrait plus de ressentiment que jamais et commençait même à avoir quel-107107que sorte d’aversion pour cet infidèle. D’ailleurs il crut que le présent qu’il voulait faire était assez considérable pour faire ouvrir les yeux et le cœur à une femme et que, s’il en avait été maltraité lorsqu’il lui avait fait pressentir son amour, c’était peut-être parce qu’il avait parlé les mains vides.
Toutes ces choses le firent résoudre à écrire à Clidamire qu’il l’aimait et il n’accompagna cette déclaration d’un présent si considérable qu’afin que, si Clidamire refusait absolument d’écouter son amour, ce présent empêchât qu’elle ne lui donnât d’abord son congé ; car il ne se mettait en peine de rien, pourvu qu’il déclarât son amour sans être chassé, et il espérait le reste du temps de sa personne et de son esprit, comme font la plupart des jeunes 108108 gens de ce siècle, qui se persuadent qu’il n’est point de beautés qui puissent résister à leurs charmes et qui puissent se défendre de tomber dans les pièges que tend leur esprit. C’était là sur quoi toute l’espérance d’Argante était fondée, qui tenait pour certain que les places qui témoignaient se vouloir bien défendre et qui faisaient d’abord grand feu, étaient souvent obligées de se rendre plus tôt qu’elles n’auraient cru.
Toutes ces choses l’ayant fortifié dans la résolution qu’il avait, il écrivit aussitôt un billet, dont il avait résolu d’être le porteur aussi bien que de ses bracelets. Après quoi il fut voir Clidamire, chez qui il avait remarqué, deux ou trois jours auparavant, une cassette où la clef tenait, dans laquelle109109 il lui avait vu mettre des bracelets qu’elle avait elle-même faits de ses cheveux, qu’il avait résolu de changer avec les siens de diamants, ce qui lui était fort facile, parce que Clidamire, qu’il voyait fort souvent, ne se gênait point pour lui et passait souvent pour quelques moments d’une chambre à une autre selon qu’elle y avait affaire. Il ne laissa pas que d’être ce jour-là longtemps chez elle sans pouvoir exécuter son dessein. Mais enfin, Clidamire étant sortie jusque sur le degré pour parler à quelqu’un qui la demandait, il fit ce qu’il avait projeté et mit ses bracelets de diamants, enveloppés dans le billet qu’il avait écrit, à la place de ceux de cheveux, qu’il prit et enveloppa dans le premier papier qu’il trouva dans sa poche. Quel-110110que temps après, il sortit aussi satisfait que s’il eût gagné de grands trésors, quoique pour des pierreries il ne remportât que des cheveux, ce qui prouve plus que toutes choses l’extravagance des amants.
Argante, qui était le plus content du monde parce qu’il s’était déchargé de ses pierreries, ne fut pas plus tôt sorti que Timandre, qui avait exprès demeuré dans son cabinet, entra dans la chambre de sa femme, à dessein de découvrir ce qu’il ne savait pas absolument et lui demanda d’un ton impérieux, et d’un air qui marquait du mépris et de la colère tout ensemble, où était le présent qu’Argante lui venait de faire. Elle répondit fièrement qu’elle ne savait ce qu’il voulait dire et qu’Argante ne lui avait jamais 111111 rien donné. En disant cela, elle voulut prendre dans sa cassette les bracelets de cheveux qu’elle n’avait faits que pour elle en se divertissant, de crainte que, s’il les eût trouvés, il crût qu’elle les eût faits pour quelque autre. Mais elle ne put ouvrir cette cassette sans qu’il s’en aperçût et, s’étant tout d’un coup retourné devers elle, il lui prit ce qu’elle en venait d’ôter, comme elle s’apprêtait à le mettre dans sa poche, et développa aussitôt le papier. Clidamire fit paraître beaucoup de surprise de voir des bracelets de diamants au lieu de ceux de cheveux qu’elle y avait mis et Timandre, outré au dernier point, lut bas la lettre d’Argante dans quoi ils étaient enveloppés, avant que de faire éclater son courroux. 112112
À LA BELLE CLIDAMIRE.
Quoique pour des bracelets que vous avez faits de vos cheveux, je vous en donne
de diamants, ne vous imaginez pas, belle Clidamire, que je croie vous donner
plus que ne valent les vôtres. Je sais trop bien que les ouvrages qui partent de
votre main sont sans prix et qu’il n’est rien au monde qui pût payer un seul de
vos cheveux, et si j’osais me servir de ce que l’on a souvent dit en semblables
rencontres à des
personnes qui étaient mille fois au-dessous de vous, je dirais que ces diamants
ont bien moins d’éclat que vos yeux. Mais hélas ! que cet éclat coûte cher à
ceux qui les regardent. Si celui des diamants se fait admirer, celui de vos 113113 yeux se fait adorer ; si l’on regarde l’un sans trembler, l’on ne
regarde jamais l’autre qu’avec crainte ; si l’un brille sans brûler, l’autre
brille et brûle tout ensemble ; si l’un enfin réjouit la vue sans embraser le
cœur, l’autre ne s’y présente jamais qu’il ne pénètre jusqu’au cœur, qu’il ne l’embrase et qu’il
ne cause une révolte dans tous les sens. Mais, comme je ne puis l’empêcher de
causer tant de mal et que je trouve autant de difficulté à enchaîner votre cœur
qu’il en trouve peu à rendre le mien votre esclave, j’ai la témérité de croire
que, pour me venger, je pourrai enchaîner vos bras et, si j’en viens à bout, je
pourrai me vanter d’avoir enchaîné ce qu’il y a de plus beau au monde, et
peut-être ensuite d’avoir adouci ce qu’il y a de plus fier. Mais il faut pour cela que vous
ayez autant de pitié que 114114 vous avez jusqu’ici eu de bonté La lettre d’Argante enchaîne les pointes, selon un
procédé qui avait fait le sujet d’une conversation au tome
I. pour
La lettre d’Argante enchaîne les pointes, selon un
procédé qui avait fait le sujet d’une conversation au tome
I. pour
ARGANTE.
— Je suis bien aise, Madame, dit Timandre à sa femme d’un ton railleur, après avoir achevé de lire, d’apprendre par cette lettre que vous ayez eu beaucoup de bonté pour Argante. Il y a longtemps que je m’en aperçois, mais je n’en avais pas encore de preuves si fortes que celle-ci, puisqu’elle est signée de sa main. Vous devez continuer à lui faire bonne mine, il est fort reconnaissant, et les présents qu’il fait, ajouta-t-il en montrant ses bracelets, sont si brillants et si riches qu’il n’est point de cœur qui doive ni qui se puisse défendre d’aimer un si galant homme.
— Je ne sais, lui répondit Clidamire, ce 115115 qui vous oblige à me tenir un semblable discours. J’ignore d’où viennent ces bracelets de diamants et je n’ai jamais vu la lettre que vous venez de lire.
— Je vois bien, Madame, lui repartit Timandre, que vous aimez tant la personne de qui elle vient que vous ne vous sauriez lasser de la lire, et qu’afin d’avoir encore cette satisfaction, vous feignez de ne l’avoir jamais vue. C’est pourquoi, comme je vous aime encore plus que vous ne pensez, je veux bien vous accorder une partie de ce que vous souhaitez, en vous en faisant moi-même la lecture.
Après cela, il lut tout haut la lettre d’Argante, que Clidamire écouta avec beaucoup d’attention. Ensuite de quoi elle dit ce qu’elle put pour faire voir son innocence et pour prouver qu’Argante 116116 avait pris ses bracelets de cheveux et avait mis ceux de diamants dans sa cassette sans qu’elle le sût. Mais, comme son malheur était encore plus fort que son innocence, son discours ne lui servit de rien et, quelque chose qu’elle pût dire, les apparences étaient toujours contre elle. Elle avait voulu fouiller dans sa cassette pour ôter ses bracelets, qu’elle croyait alors de cheveux, et, Timandre l’ayant surprise, elle avait été obligée de lui donner ce qu’elle en venait d’aveindre.
Cela, joint à ce qu’Argante ne faisait point voir dans sa lettre qu’il eût pris les bracelets de cheveux sans son aveu et qu’il eût mis les siens à la place, rendait ses excuses peu vraisemblables. Ce n’est pas qu’à bien examiner cette lettre, elle ne pût 117117 être comme elle était sans pécher contre la vraisemblance et que, n’étant lue que de Clidamire, cette belle infortunée ne dût aussi bien connaître qu’Argante avait changé ces bracelets avec ceux de cheveux que s’il se fût expliqué plus clairement. Mais le malheur de Clidamire fut tel que l’endroit qui la devait justifier faisait contre elle, puisqu’il laissait à penser à d’autres qu’elle avait donné des bracelets de cheveux et qu’ensuite on lui en avait donné de diamants. Ce qui fut cause que Timandre, après avoir quelque temps écouté ses excuses, quitta la froideur avec laquelle il avait commencé de parler et s’emporta contre sa femme. Il lui dit qu’elle ne pouvait nier qu’Argante eût des bracelets de ses cheveux, puisqu’il 118118 l’écrivait lui-même ; qu’elle ne pouvait soutenir qu’il ne lui en eût pas donné de diamants, puisqu’il les avait trouvés dans ses mains. Il ajouta que l’on ne donnait point de cheveux sans avoir de l’inclination pour ceux à qui l’on les donnait, et que l’on ne prenait point de présents si considérables que ceux qu’elle avait reçus sans se proposer d’être reconnaissante, et qu’il n’y avait point d’homme qui voulût se hasarder à faire de tels présents sans être assuré de venir à bout de ses desseins. Il lui dit ensuite tous les sujets qu’il avait eus d’être jaloux et tout ce qu’il avait remarqué depuis le premier jour qu’Argante avait commencé de la voir.
Tout ce discours ne toucha point tant Clidamire que le tour qu’Argante lui avait fait : elle était plus 119119 fâchée de sa déclaration d’amour que de la plainte que son mari en faisait, et l’envie qu’elle avait de le quereller fut cause qu’elle pria Timandre de lui permettre d’écrire à Argante de la venir trouver, afin qu’elle se pût justifier. Timandre en étant demeuré d’accord, elle écrivit ce billet, qu’elle lui montra avant que de l’envoyer.
Quelques affaires que vous puissiez avoir, dès que vous aurez reçu ce mot, ne manquez pas de venir trouver
CLIDAMIRE.
Elle dit à son mari, après avoir envoyé ce billet, qu’il connaîtrait bientôt son innocence et qu’Argante n’était pas assez hardi pour soutenir qu’il eût jamais 120120 rien reçu de sa main et qu’elle eût jamais rien pris de la sienne.
Ce jaloux par force, après avoir rêvé quelque temps là-dessus, s’imagina que ce n’était pas là le moyen d’en savoir la vérité et qu’Argante avait trop d’esprit pour ne pas s’accuser lui-même, afin d’excuser celle qu’il aimait. Et, cette pensée ayant augmenté son dépit, il sortit pour aller au-devant d’Argante, qu’il rencontra presque devant sa porte, et comme il se faisait tard et qu’il logeait dans une rue détournée par où il passait peu de monde, il ne l’eût pas plus tôt aperçu qu’il l’obligea à mettre l’épée à la main. Mais à peine avaient-ils commencé à se battre que Clidamire, qui s’était mise à la fenêtre pour voir ce que ferait son mari, fit quelque bruit et en-121121voya tous ses gens pour les séparer. Les voisins sortirent aussitôt et Argante, qui ne voulait point perdre Clidamire et qui savait qu’il y avait déjà longtemps que l’on parlait de leurs prétendues amours dans ce quartier, s’enfuit avant qu’aucuns des voisins l’eussent pu reconnaître.
Il ne fut pas plus tôt parti que Timandre ramassa un papier qu’Argante avait fait tomber de sa poche en tirant son mouchoir, avant qu’il lui eût parlé de mettre la main à l’épée. Ensuite de quoi il rentra chez lui, après avoir remercié ses voisins et leur avoir dit que ce n’était rien. Admirez ce que peut le malheur, lorsqu’il entreprend de persécuter une personne : il n’eut pas plus tôt ouvert le papier qu’il avait ramassé qu’il y trouva que c’était 122122 un billet écrit de la main de sa femme, dans lequel il y avait des bracelets de cheveux. Ce billet contenait ces paroles :
Je souhaite de vous voir avec impatience pour vous apprendre que Timandre n’est plus jaloux, ce qui vous doit obliger, si vous avez toujours la même bonté pour moi, à me venir trouver au plus tôt, afin que nous consultions ce que nous avons à faire.
CLIDAMIRE.
Pendant que Timandre rêvera sur ce nouvel incident, voyons ce que c’est que ce billet. Clidamire, comme l’on a vu dans le cours de cette histoire, ayant, par son adresse et par la jalousie qu’elle donnait à Timandre, obligé plusieurs fois ce volage à chan-123123ger de vie, voyant un jour qu’il recommençait à prendre ses premières habitudes, écrivit ce billet à Argante, afin qu’il vînt aviser avec elle aux moyens de le rendre jaloux, pour le ramener à son devoir, comme elle avait déjà fait plusieurs fois. Argante avait, depuis ce temps, laissé ce billet dans sa poche et, comme en prenant les bracelets de cheveux il les avait mis dans le premier papier qu’il avait trouvé dans sa poche, le malheur voulut que ce fût celui-là et, de plus, que l’on l’envoyât quérir avant qu’il eût eu le temps de serrer ni de regarder même ces bracelets.
Timandre, après avoir lu ce billet, loin de s’emporter, dit à Clidamire qu’il
avait ce qu’il souhaitait et qu’il n’en demandait pas davantage, et le
lendemain, 124124 ayant fait venir ses plus proches parents et leur ayant
conté tout ce qui était arrivé, voulut la remettre entre leurs mains Le Cocu imaginaire (1661) de Molière
présentait le même épisode à l’état embryonnaire : Sganarelle, convaincu
de l’infidélité de sa femme, sollicite un « parent de sa femme » pour
avoir raison de ce forfait (sc. XII). Il invoque à cette occasion les
preuves qu’il pense détenir de sa culpabilité. La situation sera reprise
et exploitée plus à fond dans Georges
Dandin.. Ce fut alors que, se trouvant bien
embarrassée, elle découvrit, pour
se justifier, toute la politique dont elle s’était servie pour le rendre jaloux
et montra même la pièce Du bonheur des femmes qui ont des maris jaloux,
qu’Argante avait faite à sa prière. Timandre fit voir aussitôt que cette pièce
qu’elle prétendait faire servir à sa justification était une preuve qui
faisait entièrement contre elle. Il fit voir qu’Argante, sous ombre de
l’obliger, avait, comme un galant adroit, entretenu autant qu’il avait pu la division
entre le mari et la femme, que son dessein était de s’insinuer peu à peu dans
ses bonnes grâces et que, bien 125125 qu’il semblât d’abord agir pour la
remettre en bonne intelligence avec lui, il n’avait néanmoins pour but que de
l’empêcher ; que cela se connaissait dans la pièce Du bonheur des femmes, etc.,
où il avait prouvé que les femmes qui se voulaient servir de la jalousie de
leurs maris pour devenir heureuses en tiraient de grands avantages et, entre
autres, des présents considérables ; qu’Argante n’avait point traité cet endroit
selon l’intention que Clidamire disait avoir eue, puisque, bien loin de faire
voir tous ses avantages dans la réconciliation du mari et de la femme, il les
lui faisait recevoir pendant le cours de sa jalousie, et même d’autres personnes
que du mari.
Le Cocu imaginaire (1661) de Molière
présentait le même épisode à l’état embryonnaire : Sganarelle, convaincu
de l’infidélité de sa femme, sollicite un « parent de sa femme » pour
avoir raison de ce forfait (sc. XII). Il invoque à cette occasion les
preuves qu’il pense détenir de sa culpabilité. La situation sera reprise
et exploitée plus à fond dans Georges
Dandin.. Ce fut alors que, se trouvant bien
embarrassée, elle découvrit, pour
se justifier, toute la politique dont elle s’était servie pour le rendre jaloux
et montra même la pièce Du bonheur des femmes qui ont des maris jaloux,
qu’Argante avait faite à sa prière. Timandre fit voir aussitôt que cette pièce
qu’elle prétendait faire servir à sa justification était une preuve qui
faisait entièrement contre elle. Il fit voir qu’Argante, sous ombre de
l’obliger, avait, comme un galant adroit, entretenu autant qu’il avait pu la division
entre le mari et la femme, que son dessein était de s’insinuer peu à peu dans
ses bonnes grâces et que, bien 125125 qu’il semblât d’abord agir pour la
remettre en bonne intelligence avec lui, il n’avait néanmoins pour but que de
l’empêcher ; que cela se connaissait dans la pièce Du bonheur des femmes, etc.,
où il avait prouvé que les femmes qui se voulaient servir de la jalousie de
leurs maris pour devenir heureuses en tiraient de grands avantages et, entre
autres, des présents considérables ; qu’Argante n’avait point traité cet endroit
selon l’intention que Clidamire disait avoir eue, puisque, bien loin de faire
voir tous ses avantages dans la réconciliation du mari et de la femme, il les
lui faisait recevoir pendant le cours de sa jalousie, et même d’autres personnes
que du mari.
Il ajouta à tout cela qu’il avait toujours assez estimé Clidamire pour croi-126126re qu’elle avait eu d’abord un bon dessein, mais que la suite faisait voir qu’elle n’avait pas eu la force de se défendre, qu’elle avait été surprise, qu’elle s’était laissée gagner et que les preuves qu’il en avait étaient si convaincantes qu’il n’y avait rien qui les pût détruire, ce que les parents avouèrent eux-mêmes, ne voyant point de jour à justifier Clidamire. Et, de vrai, quoique Argante n’eût rien gagné, toutes les apparences étaient contre elle et ils avaient raison d’avoir cette pensée, puisque c’était effectivement le dessein d’Argante, ce qui fait voir que celles qui souffrent que de certaines personnes qui sont toujours suspectes leur rendent de trop fréquentes visites, s’exposent non seulement à un 127127 semblable danger, mais se mettent encore au hasard de souffrir ce qu’elles n’auraient jamais cru devoir permettre, même aux plus grands princes du monde. Et l’on ne sait pas enfin, si les choses fussent toujours demeurées en même état, ce que Clidamire eût fait, quoiqu’elle fût une des plus vertueuse personnes de ce siècle.
Elle eut néanmoins tant de malheur qu’elle ne laissa pas d’être traitée en criminelle, et ses parents, qui la devaient protéger, furent les premiers à la blâmer. Ils conjurèrent toutefois Timandre de la vouloir souffrir chez lui, mais ils le prièrent en même temps de ne lui donner aucune liberté et de ne lui laisser voir personne. Timandre la garda à cette condition et la tint depuis toujours enfermée, plu-128128tôt pour lui ôter la connaissance de ses actions que pour la crainte qu’il eût qu’elle fût courtisée ; car il n’était pas naturellement jaloux et tout ce qu’il avait fait n’était que pour se délivrer des importunités, du bruit et de la jalousie de Clidamire. Ensuite de cet accommodement, les parents de cette malheureuse innocente cherchèrent Argante pour se venger dessus lui du déshonneur qu’ils prétendaient être fait à leur famille. Timandre le chercha aussi de son côté, mais ils ne le trouvèrent point, parce que son père l’avait contraint d’aller à la campagne, pour ne pas être exposé à un si grand nombre d’ennemis.
Clidamire mourut de regret deux ou trois ans après et nous apprit à ses dépens que l’on ne 129129 doit jamais forcer un homme d’être jaloux ; qu’il est vrai que la patience irritée devient fureur ; que les plus doux sont les plus difficiles à apaiser, lorsque l’on les a une fois poussés à bout et que la colère qu’ils ont longtemps retenue venant tout à coup à éclater, il est impossible de se pouvoir défendre des effets qu’elle produit, surtout quand les choses qui la font naître regardent l’honneur. C’est pourquoi la jalousie en faisant toujours douter, l’on ne s’en doit jamais servir pour quelque prétexte que ce soit, et ce remède doit être mis au nombre de ceux dont on ne peut user sans péril.

Ils s’arrêtèrent bien des fois pendant la lecture de cette nouvelle et dirent
bien des choses que je n’ai point voulu rappor130130ter, de crainte de
vous faire plus de dépit que
de plaisir en vous interrompant. Je dirai seulement que, lorsqu’Ariste eut
achevé de lire, il dit que cette nouvelle n’était pas comme toutes les
autres Conformément à une technique promotionnelle
courante dans les Nouvelles Nouvelles, le discours
d’Ariste sert à souligner la spécificité du « Jaloux par force » dans la
production contemporaine.,
qu’elle commençait par où les autres finissaient et qu’elle décrivait les
aventures qui étaient arrivées au héros et à l’héroïne depuis leur mariage, au
lieu de faire voir celles qui leur étaient arrivées devant que de se marier. Il dit encore qu’elle
était divertissante et surtout si nouvelle que l’on ne devait point craindre de
la lire, de peur de trouver ce qui avait été déjà dit dans d’autres, comme
l’on commençait à faire tous les jours
Conformément à une technique promotionnelle
courante dans les Nouvelles Nouvelles, le discours
d’Ariste sert à souligner la spécificité du « Jaloux par force » dans la
production contemporaine.,
qu’elle commençait par où les autres finissaient et qu’elle décrivait les
aventures qui étaient arrivées au héros et à l’héroïne depuis leur mariage, au
lieu de faire voir celles qui leur étaient arrivées devant que de se marier. Il dit encore qu’elle
était divertissante et surtout si nouvelle que l’on ne devait point craindre de
la lire, de peur de trouver ce qui avait été déjà dit dans d’autres, comme
l’on commençait à faire tous les jours Le succès des
nouvelles depuis le début des années 1660 a effectivement pour
conséquence une saturation du marché en 1663 déjà..
Clorante ajouta que L’Apologie de la jalousie réjouirait bien des maris
jaloux
Le succès des
nouvelles depuis le début des années 1660 a effectivement pour
conséquence une saturation du marché en 1663 déjà..
Clorante ajouta que L’Apologie de la jalousie réjouirait bien des maris
jaloux Ariste souligne ainsi l’applicabilité à la vie
des lecteurs et l’utilité de « L’Apologie », autant de critères
importants pour l’évaluation de la littérature dans les
années 1660. La pièce est par ailleurs présentée comme un contenu
détachable et autonome par rapport au « Jaloux par force », conformément
au mode de composition et de lecture des
Nouvelles Nouvelles. et que les fem-131131mes qui en avaient supporteraient leurs maux plus patiemment
qu’elles n’avaient de coutume, si elles faisaient réflexion sur le bien qui leur
en revenait, mais que celles qui n’en avaient point devaient prendre garde de ne
se pas embarrasser si avant que Clidamire, parce que l’on ne
sortait pas toujours d’un semblable embarras, comme l’on se figurait en formant
des desseins de cette nature.
Ariste souligne ainsi l’applicabilité à la vie
des lecteurs et l’utilité de « L’Apologie », autant de critères
importants pour l’évaluation de la littérature dans les
années 1660. La pièce est par ailleurs présentée comme un contenu
détachable et autonome par rapport au « Jaloux par force », conformément
au mode de composition et de lecture des
Nouvelles Nouvelles. et que les fem-131131mes qui en avaient supporteraient leurs maux plus patiemment
qu’elles n’avaient de coutume, si elles faisaient réflexion sur le bien qui leur
en revenait, mais que celles qui n’en avaient point devaient prendre garde de ne
se pas embarrasser si avant que Clidamire, parce que l’on ne
sortait pas toujours d’un semblable embarras, comme l’on se figurait en formant
des desseins de cette nature.
Comme j’allais repartir à Clorante, Straton entra La venue
du quatrième nouvelliste avait été annoncée à la p. 7 du tome
II. et dit à Arimant qu’il le priait de l’excuser s’il n’était
pas venu plus tôt pour savoir ce qu’il souhaitait de lui, mais qu’il ne venait
que d’arriver à son logis, où il avait appris qu’il l’avait envoyé chercher, et
que, bien qu’il eût des affaires pressantes, il était aussitôt venu. Arimant lui
répondit 132132 qu’il pouvait aller à ses affaires et qu’il ne l’avait
envoyé quérir que pour dîner avec la compagnie, ce qui fut cause que Straton
jeta les yeux sur tous ceux qui étaient là présents et, comme la plupart des
nouvellistes se connaissent, il s’écria, en apercevant Ariste :
La venue
du quatrième nouvelliste avait été annoncée à la p. 7 du tome
II. et dit à Arimant qu’il le priait de l’excuser s’il n’était
pas venu plus tôt pour savoir ce qu’il souhaitait de lui, mais qu’il ne venait
que d’arriver à son logis, où il avait appris qu’il l’avait envoyé chercher, et
que, bien qu’il eût des affaires pressantes, il était aussitôt venu. Arimant lui
répondit 132132 qu’il pouvait aller à ses affaires et qu’il ne l’avait
envoyé quérir que pour dîner avec la compagnie, ce qui fut cause que Straton
jeta les yeux sur tous ceux qui étaient là présents et, comme la plupart des
nouvellistes se connaissent, il s’écria, en apercevant Ariste :
— Ah ! bonjour, cher ami, je suis bien aise de vous avoir rencontré, j’ai bien
des choses à vous dire. Comment vous portez-vous ? Eh bien ! quelle
nouvelle ? En posant une série de questions sans attendre
de réponses, les nouvellistes dérogent aux normes de la
civilité. Donneau
commentera ce comportement fâcheux dans le « Portrait des
nouvellistes », à la p. 307. que dit-on au Parnasse ? que faites-vous présentement
? comment va la Muse ? Je fus hier au Palais, j’y vis le galant homme que
vous savez
En posant une série de questions sans attendre
de réponses, les nouvellistes dérogent aux normes de la
civilité. Donneau
commentera ce comportement fâcheux dans le « Portrait des
nouvellistes », à la p. 307. que dit-on au Parnasse ? que faites-vous présentement
? comment va la Muse ? Je fus hier au Palais, j’y vis le galant homme que
vous savez Le propos satirise le goût de la connivence et
du secret. Le
Palais
compte parmi les lieux très fréquentés de la capitale et constitue à ce
titre un lieu d’échange d’informations.
qui nous récita ce sonnet qui fut trouvé si beau. Que
dit-on du Portugal ?
Le propos satirise le goût de la connivence et
du secret. Le
Palais
compte parmi les lieux très fréquentés de la capitale et constitue à ce
titre un lieu d’échange d’informations.
qui nous récita ce sonnet qui fut trouvé si beau. Que
dit-on du Portugal ? La guerre de Restauration (1640-1668),
au cours de laquelle le Portugal affronte l’Espagne pour obtenir son
indépendance connaît plusieurs événements majeurs au moment où
paraissent les Nouvelles Nouvelles, en particulier les
batailles d'Elvas (14 janvier 1659) et d'Ameixial (8 juin 1663). Louis
XIV soutient les Portugais contre les Habsbourg d’Espagne, et le sujet
paraît régulièrement dans les correspondances, à l’exemple de cette
lettre de G. Patin. n’avez-vous rien appris des affaires
étrangères ? Quand vous voudrez, nous irons voir cette personne que 133133 vous savez. Elle a bien de belles pièces qu’elle ne montre pas à tout le
monde, il faudra tâcher d’en tirer quelques copies
La guerre de Restauration (1640-1668),
au cours de laquelle le Portugal affronte l’Espagne pour obtenir son
indépendance connaît plusieurs événements majeurs au moment où
paraissent les Nouvelles Nouvelles, en particulier les
batailles d'Elvas (14 janvier 1659) et d'Ameixial (8 juin 1663). Louis
XIV soutient les Portugais contre les Habsbourg d’Espagne, et le sujet
paraît régulièrement dans les correspondances, à l’exemple de cette
lettre de G. Patin. n’avez-vous rien appris des affaires
étrangères ? Quand vous voudrez, nous irons voir cette personne que 133133 vous savez. Elle a bien de belles pièces qu’elle ne montre pas à tout le
monde, il faudra tâcher d’en tirer quelques copies La
copie constitue l’un des principaux modes de circulation
des pièces et des informations. .
La
copie constitue l’un des principaux modes de circulation
des pièces et des informations. .
Ariste, au lieu de lui répondre (ce qui aurait été fort difficile, vu la
quantité de choses qu’il avait dites), lui en dit deux fois autant d’autres et
lui fit vingt demandes sans lui donner le loisir de parler, non plus qu’il avait
fait. Ensuite de quoi, Straton dit qu’il avait quantité de nouvelles de
Parnasse dans sa poche La tendance à accumuler les
nouvelles dans les poches apparaît aussi dans le « Portrait des
nouvellistes ». Donneau
s'inspire également d'un motif comique proposé par Sorel dans les «
Lois de la galanterie » (1658) : « il faut toujours avoir ses pochettes pleines
de sonnets, épigrammes, madrigaux, élégies et autres vers, soit qu’ils
soient satiriques, ou sur un sujet d’amour ». Le tome II des
Nouvelles Nouvelles dépeignait déjà Ariste qui devait
« ôter presque tout ce qui était dans ses poches et [ouvrir] une
infinité de papiers » (p. 83). qu’il nous voulait montrer
et, après en avoir tiré un grand papier, il lut aussitôt.
La tendance à accumuler les
nouvelles dans les poches apparaît aussi dans le « Portrait des
nouvellistes ». Donneau
s'inspire également d'un motif comique proposé par Sorel dans les «
Lois de la galanterie » (1658) : « il faut toujours avoir ses pochettes pleines
de sonnets, épigrammes, madrigaux, élégies et autres vers, soit qu’ils
soient satiriques, ou sur un sujet d’amour ». Le tome II des
Nouvelles Nouvelles dépeignait déjà Ariste qui devait
« ôter presque tout ce qui était dans ses poches et [ouvrir] une
infinité de papiers » (p. 83). qu’il nous voulait montrer
et, après en avoir tiré un grand papier, il lut aussitôt.

134134EXTRAIT D’UNE LETTRE ÉCRITE DU PARNASSE Par ce
titre débute la « Lettre écrite du Parnasse », qui constitue une des
pièces les plus remarquables du tome III des Nouvelles
Nouvelles.L'annotation de cette pièce a été réalisée
par Deborah Steinberger., touchant les nouveaux règlements qui
ont été depuis peu faits dans le Conseil d'Apollon et des Muses
extraordinairement assemblé.
Par ce
titre débute la « Lettre écrite du Parnasse », qui constitue une des
pièces les plus remarquables du tome III des Nouvelles
Nouvelles.L'annotation de cette pièce a été réalisée
par Deborah Steinberger., touchant les nouveaux règlements qui
ont été depuis peu faits dans le Conseil d'Apollon et des Muses
extraordinairement assemblé.
Il y eut naguère au Parnasse bien du bruit entre Apollon et les
Muses Sorel commence son Nouveau
Parnasse (Œuvres diverses ou discours mêlés,
1663) par une exposition comparable : « Après quelques querelles de peu
d'importance arrivées dans l'ancien Parnasse, sa tranquillité fut un
jour entièrement troublée » (p. 1)., Apollon ne pouvant
souffrir que les Muses fissent avoir plus de réputation dans le monde aux
filles
Sorel commence son Nouveau
Parnasse (Œuvres diverses ou discours mêlés,
1663) par une exposition comparable : « Après quelques querelles de peu
d'importance arrivées dans l'ancien Parnasse, sa tranquillité fut un
jour entièrement troublée » (p. 1)., Apollon ne pouvant
souffrir que les Muses fissent avoir plus de réputation dans le monde aux
filles Apollon, qui représente la tradition, s’oppose à
l’essor des auteurs féminins ; les Muses, en revanche, défendent les
femmes de lettres. Cette opposition avait déjà été exploitée dans
Les Femmes illustres (1642, « Harangue de Sapho à
Érinne ») de Madeleine de Scudéry. L’allégorie des Muses permet ainsi de
justifier la participation féminine au monde des lettres : « Vous me
direz peut-être que tous les hommes ne nous sont pas si rigoureux et que
quelques-uns consentent que les femmes emploient leur esprit à la
connaissance des belles lettres, pourvu qu’elles ne se mêlent pas de
vouloir composer elles-mêmes des ouvrages. Mais que ceux qui sont de
cette opinion se souviennent que si Mercure et Apollon sont de leur
sexe, Minerve et les Muses sont du nôtre » (p. 433-434). En tant que divinités, les Muses ont voix au chapitre
dans le domaine des lettres et peuvent présenter en toute légitimité des
revendications qui pourraient peut-être plus difficilement être mises
dans la bouche des femmes elles-mêmes. L’artifice consiste donc à
présenter une requête pour les femmes, mais non par les
femmes. qui mettent présentement des ouvrages d'esprit au
jour qu'aux auteurs les plus fameux et les plus
consommés dans cet
illustre et spirituel emploi. Mais, comme les Muses sont 135135 du sexe
de ces belles, elles surent si bien soutenir leur parti qu'elles obligèrent
Apollon (qui jusqu'ici avait eu sur elles toute l'autorité qu'un prince a sur
ses sujets) de faire un accommodement qui lui sera toujours honteux, puisqu'il
fut arrêté qu'il présiderait au
Parnasse, qu'il aurait deux voix et qu'il aurait la gloire de
prononcer ce qui serait
arrêté au Conseil des Muses, mais qu'elles auraient chacune leur voix et qu'il
ne serait rien conclu sans qu'elles donnassent toutes leur opinion
Apollon, qui représente la tradition, s’oppose à
l’essor des auteurs féminins ; les Muses, en revanche, défendent les
femmes de lettres. Cette opposition avait déjà été exploitée dans
Les Femmes illustres (1642, « Harangue de Sapho à
Érinne ») de Madeleine de Scudéry. L’allégorie des Muses permet ainsi de
justifier la participation féminine au monde des lettres : « Vous me
direz peut-être que tous les hommes ne nous sont pas si rigoureux et que
quelques-uns consentent que les femmes emploient leur esprit à la
connaissance des belles lettres, pourvu qu’elles ne se mêlent pas de
vouloir composer elles-mêmes des ouvrages. Mais que ceux qui sont de
cette opinion se souviennent que si Mercure et Apollon sont de leur
sexe, Minerve et les Muses sont du nôtre » (p. 433-434). En tant que divinités, les Muses ont voix au chapitre
dans le domaine des lettres et peuvent présenter en toute légitimité des
revendications qui pourraient peut-être plus difficilement être mises
dans la bouche des femmes elles-mêmes. L’artifice consiste donc à
présenter une requête pour les femmes, mais non par les
femmes. qui mettent présentement des ouvrages d'esprit au
jour qu'aux auteurs les plus fameux et les plus
consommés dans cet
illustre et spirituel emploi. Mais, comme les Muses sont 135135 du sexe
de ces belles, elles surent si bien soutenir leur parti qu'elles obligèrent
Apollon (qui jusqu'ici avait eu sur elles toute l'autorité qu'un prince a sur
ses sujets) de faire un accommodement qui lui sera toujours honteux, puisqu'il
fut arrêté qu'il présiderait au
Parnasse, qu'il aurait deux voix et qu'il aurait la gloire de
prononcer ce qui serait
arrêté au Conseil des Muses, mais qu'elles auraient chacune leur voix et qu'il
ne serait rien conclu sans qu'elles donnassent toutes leur opinion La « Lettre » revendique ici une hégémonie
féminine qui ressemble à celle qu’envisagera Armande dans Les
Femmes savantes de Molière (1672) : « Nous serons par nos
lois les juges des ouvrages ; / Par nos lois, prose et vers, tout nous
sera soumis ; / Nul n’aura de l’esprit hors nous et nos amis » (III, 2,
922-924).. Ensuite de cet accord, elles s'assemblèrent à
quelques jours de là avec Apollon et firent tous les règlements
La « Lettre » revendique ici une hégémonie
féminine qui ressemble à celle qu’envisagera Armande dans Les
Femmes savantes de Molière (1672) : « Nous serons par nos
lois les juges des ouvrages ; / Par nos lois, prose et vers, tout nous
sera soumis ; / Nul n’aura de l’esprit hors nous et nos amis » (III, 2,
922-924).. Ensuite de cet accord, elles s'assemblèrent à
quelques jours de là avec Apollon et firent tous les règlements Le Parnasse réformé (1668) de Guéret
aura aussi recours à une ordonnance venant du Parnasse concernant la vie
littéraire. Ce document est composé d’une liste de vingt-et-un
règlements, signés du nom d’Apollon ; ils paraissent à la fin du texte
(p. 127-135). qui suivent. 136136
Le Parnasse réformé (1668) de Guéret
aura aussi recours à une ordonnance venant du Parnasse concernant la vie
littéraire. Ce document est composé d’une liste de vingt-et-un
règlements, signés du nom d’Apollon ; ils paraissent à la fin du texte
(p. 127-135). qui suivent. 136136
I
Pour s'accommoder au temps Cette phrase
d’ouverture donne le ton de la « Lettre » avec cette
expression que l’on retrouve également aux p. 159, 225, 275 : selon les
principes de la culture mondaine, pour plaire
aux lecteurs, la littérature doit être adaptée à son époque. Ce qui
fonde le plus sûrement l’« agrément » d’un texte est dès lors la mise en
circulation de figures et d’idées à la mode. C’est
précisément l’une des qualités majeures de que Straton reconnaîtra à
l’œuvre de Mlle de Scudéry (« Sa Clélie a plu à tout le
monde, parce qu’elle a si bien su parler dans ses conversations des
choses du temps… » p. 169). De même, dans le dialogue des morts de son
Mont Parnasse ou de la préférence entre la prose et la poésie
(1663), Grille d’Estoublon fait parler ainsi Voiture à Homère
disgracié : « Apollon lui-même change de face toutes les années, aussi
bien que la fortune ; il s’accommode aux saisons, aux esprits, aux
caprices des hommes. Il se plaît aujourd’hui aux vers français, votre
grec est étranger et barbare en ce pays… » (p. 43)., auquel
les dieux et les hommes ont toujours donné quelque chose et semblent
présentement s'accommoder mieux que jamais, les ouvrages d'esprit ne seront plus
jugés bons selon leurs mérites, mais selon le nombre de leurs approbateurs qui,
de quelque qualité et de quelque sexe qu'ils soient, l'emporteront
toujours
Cette phrase
d’ouverture donne le ton de la « Lettre » avec cette
expression que l’on retrouve également aux p. 159, 225, 275 : selon les
principes de la culture mondaine, pour plaire
aux lecteurs, la littérature doit être adaptée à son époque. Ce qui
fonde le plus sûrement l’« agrément » d’un texte est dès lors la mise en
circulation de figures et d’idées à la mode. C’est
précisément l’une des qualités majeures de que Straton reconnaîtra à
l’œuvre de Mlle de Scudéry (« Sa Clélie a plu à tout le
monde, parce qu’elle a si bien su parler dans ses conversations des
choses du temps… » p. 169). De même, dans le dialogue des morts de son
Mont Parnasse ou de la préférence entre la prose et la poésie
(1663), Grille d’Estoublon fait parler ainsi Voiture à Homère
disgracié : « Apollon lui-même change de face toutes les années, aussi
bien que la fortune ; il s’accommode aux saisons, aux esprits, aux
caprices des hommes. Il se plaît aujourd’hui aux vers français, votre
grec est étranger et barbare en ce pays… » (p. 43)., auquel
les dieux et les hommes ont toujours donné quelque chose et semblent
présentement s'accommoder mieux que jamais, les ouvrages d'esprit ne seront plus
jugés bons selon leurs mérites, mais selon le nombre de leurs approbateurs qui,
de quelque qualité et de quelque sexe qu'ils soient, l'emporteront
toujours La Lettre écrite du Parnasse
soutient ici la dictature de la majorité du public. Ce principe
démocratique semble contredire la primauté accordée ailleurs dans la
lettre au jugement des « seigneurs de l’Académie française » (art. VI)
concernant les ouvrages d’esprit. L’article consacre ainsi l’opportunité
de la « stratégie du succès » (Alain Viala, Naissance de
l’écrivain) telle qu’illustrée récemment dans la préface de
L’École des femmes (« Bien des gens ont frondé
d’abord cette comédie ; mais les rieurs ont été pour elle, et tout le
mal qu’on en a pu dire n’a pu faire qu’elle n’ait eu un succès dont je
me contente »). Straton ironise à nouveau sur cette question dans la
suite des Nouvelles Nouvelles : « Quand on a réussi, on
est justifié » (p. 211). sur ceux qui seront d'un
sentiment contraire, mais seulement lorsque leur nombre sera le plus grand.
La Lettre écrite du Parnasse
soutient ici la dictature de la majorité du public. Ce principe
démocratique semble contredire la primauté accordée ailleurs dans la
lettre au jugement des « seigneurs de l’Académie française » (art. VI)
concernant les ouvrages d’esprit. L’article consacre ainsi l’opportunité
de la « stratégie du succès » (Alain Viala, Naissance de
l’écrivain) telle qu’illustrée récemment dans la préface de
L’École des femmes (« Bien des gens ont frondé
d’abord cette comédie ; mais les rieurs ont été pour elle, et tout le
mal qu’on en a pu dire n’a pu faire qu’elle n’ait eu un succès dont je
me contente »). Straton ironise à nouveau sur cette question dans la
suite des Nouvelles Nouvelles : « Quand on a réussi, on
est justifié » (p. 211). sur ceux qui seront d'un
sentiment contraire, mais seulement lorsque leur nombre sera le plus grand.
II
Les ouvrages qui seront plus approuvés des femmes que des 137137 hommes seront tenus pour être pleins d'esprit et, surtout, pour être naturellement écrits.
III
Les auteurs seront tenus de fêter les six premiers jours de la vente des
ouvrages de leur composition et seront obligés d'être plus
propres
ces jours-là que les autres La figure du poète
crotté, sans ressources et peu soucieux de sa personne, est un
lieu commun de la littérature comique de l’époque. Dans Le
Parnasse réformé (1668) de Guéret,
Apollon exigera que les poètes se tiennent propres et bien coiffés
(Article VIII, « Enjoignons à tous les poètes d’avoir de l’esprit, leur
permettons de s’habiller à leur fantaisie ; ordonnons néanmoins qu’ils
peigneront tous les jours leurs perruques, qu’ils changeront deux fois
de linge par semaine, et qu’ils feront décrotter leurs chausses », p.
131)..
La figure du poète
crotté, sans ressources et peu soucieux de sa personne, est un
lieu commun de la littérature comique de l’époque. Dans Le
Parnasse réformé (1668) de Guéret,
Apollon exigera que les poètes se tiennent propres et bien coiffés
(Article VIII, « Enjoignons à tous les poètes d’avoir de l’esprit, leur
permettons de s’habiller à leur fantaisie ; ordonnons néanmoins qu’ils
peigneront tous les jours leurs perruques, qu’ils changeront deux fois
de linge par semaine, et qu’ils feront décrotter leurs chausses », p.
131)..
IV
Ceux de théâtre seront obligés de faire la même chose pendant les six premières
représentations de leurs pièces. Outre ces fêtes qu'ils fêteront dans leur
particulier, sans qu'il soit
fête pour tout le Parnasse, ils seront encore obligés de fêter les fêtes
générales, 138138 qui seront les jours de la naissance des deux
Corneille, de Sapho et de l'auteur de la Cléopâtre et du Faramond Dans Le Parnasse réformé (1668), Guéret
citera lui aussi Corneille l’aîné, Mlle de Scudéry, et La Calprenède
comme des exemples d’excellence littéraire - Corneille pour la poésie et
les deux autres pour le roman (p. 79-80). Il existe de nombreux points
communs entre ces auteurs, notamment leur attrait pour un public féminin
et/ou galant et, dans le cas de Corneille le jeune et de La Calprenède,
le choix des sujets. Timocrate (1656), chef-d’œuvre de
Thomas Corneille, s’inspire de la Cléopâtre (1648) de La
Calprenède, et son Stilicon (1660) est basé sur la
même matière que le Faramond (1661) du romancier. Les
deux auteurs ont aussi créé des tragédies basées sur l’histoire
(relativement récente) du Comte d’Essex, favori de la reine Élisabeth I
d’Angleterre (la pièce de La Calprenède a été représentée pour la
première fois en 1637 ; celle de Corneille verra le jour en 1678). Mais
alors que les frères Corneille comptent, à l’époque de la publication
des Nouvelles Nouvelles, parmi les maîtres incontestés de
l’art dramatique (Straton appelle le vieux Corneille « le prince des
poètes français », infra, p. 271-272), Madeleine de
Scudéry (Sapho) et La Calprenède seront ciblés par la satire. Dans son
dialogue des Héros de roman (composé vers 1664-1665 mais
publié seulement après la mort du satiriste), Boileau se moque de leurs
œuvres en accusant ces auteurs d’ « excès » et de « puérilité » (p. 5)
et il critique leurs héros efféminés (« je n’ai jamais rien vu de si
dameret » p. 11) : « Artamène ne sait du matin au soir que lamenter,
gémir, et filer le parfait amour » p. 5). Pour Mme de Sévigné, en
revanche, la lecture de Cléopâtre représente un péché
mignon : « Je reviens donc à nos lectures : c’est sans préjudice de
Cléopâtre que j’ai gagé d'achever ; vous savez comme
je soutiens mes gageures. Je songe quelquefois d’où vient la folie que
j’ai pour ces sottises-là ; j’ai peine à le comprendre. Vous vous
souvenez peut-être assez de moi pour savoir à quel point je suis blessée
des méchants styles ; j’ai quelque lumière pour les bons, et personne
n’est plus touché que moi des charmes de l’éloquence. Le style de La
Calprenède est maudit en mille endroits ; de grandes périodes de roman,
de méchants mots, je sens tout cela. J’écrivis l'autre jour une lettre à
mon fils une lettre de ce style, qui était fort plaisante. Je trouve
donc que celui de La Calprenède est détestable, et cependant je ne
laisse pas de m’y prendre comme à de la glu : la beauté des sentiments,
la violence des passions, la grandeur des événements, et le succès
miraculeux de leurs redoutables épées, tout cela m'entraîne comme une
petite fille ; j'entre dans leurs desseins… » (À Madame de Grignan.
Aux Rochers, dimanche 12 juillet, 1671). , et cela parce qu'ils sont les premiers
chacun en leur genre d'écrire et que, par leurs ouvrages, ils honorent le
Parnasse et tout le corps des auteurs.
Dans Le Parnasse réformé (1668), Guéret
citera lui aussi Corneille l’aîné, Mlle de Scudéry, et La Calprenède
comme des exemples d’excellence littéraire - Corneille pour la poésie et
les deux autres pour le roman (p. 79-80). Il existe de nombreux points
communs entre ces auteurs, notamment leur attrait pour un public féminin
et/ou galant et, dans le cas de Corneille le jeune et de La Calprenède,
le choix des sujets. Timocrate (1656), chef-d’œuvre de
Thomas Corneille, s’inspire de la Cléopâtre (1648) de La
Calprenède, et son Stilicon (1660) est basé sur la
même matière que le Faramond (1661) du romancier. Les
deux auteurs ont aussi créé des tragédies basées sur l’histoire
(relativement récente) du Comte d’Essex, favori de la reine Élisabeth I
d’Angleterre (la pièce de La Calprenède a été représentée pour la
première fois en 1637 ; celle de Corneille verra le jour en 1678). Mais
alors que les frères Corneille comptent, à l’époque de la publication
des Nouvelles Nouvelles, parmi les maîtres incontestés de
l’art dramatique (Straton appelle le vieux Corneille « le prince des
poètes français », infra, p. 271-272), Madeleine de
Scudéry (Sapho) et La Calprenède seront ciblés par la satire. Dans son
dialogue des Héros de roman (composé vers 1664-1665 mais
publié seulement après la mort du satiriste), Boileau se moque de leurs
œuvres en accusant ces auteurs d’ « excès » et de « puérilité » (p. 5)
et il critique leurs héros efféminés (« je n’ai jamais rien vu de si
dameret » p. 11) : « Artamène ne sait du matin au soir que lamenter,
gémir, et filer le parfait amour » p. 5). Pour Mme de Sévigné, en
revanche, la lecture de Cléopâtre représente un péché
mignon : « Je reviens donc à nos lectures : c’est sans préjudice de
Cléopâtre que j’ai gagé d'achever ; vous savez comme
je soutiens mes gageures. Je songe quelquefois d’où vient la folie que
j’ai pour ces sottises-là ; j’ai peine à le comprendre. Vous vous
souvenez peut-être assez de moi pour savoir à quel point je suis blessée
des méchants styles ; j’ai quelque lumière pour les bons, et personne
n’est plus touché que moi des charmes de l’éloquence. Le style de La
Calprenède est maudit en mille endroits ; de grandes périodes de roman,
de méchants mots, je sens tout cela. J’écrivis l'autre jour une lettre à
mon fils une lettre de ce style, qui était fort plaisante. Je trouve
donc que celui de La Calprenède est détestable, et cependant je ne
laisse pas de m’y prendre comme à de la glu : la beauté des sentiments,
la violence des passions, la grandeur des événements, et le succès
miraculeux de leurs redoutables épées, tout cela m'entraîne comme une
petite fille ; j'entre dans leurs desseins… » (À Madame de Grignan.
Aux Rochers, dimanche 12 juillet, 1671). , et cela parce qu'ils sont les premiers
chacun en leur genre d'écrire et que, par leurs ouvrages, ils honorent le
Parnasse et tout le corps des auteurs.
V
Les livres de galanterie et les bagatelles
auront plus de cours que les grands et solides ouvrages Le même constat est effectué, dans La Critique de
l’École des femmes (1663), par le poète ridicule Lysidas,
qui déplore l’évolution du goût du public théâtral : « …il y a une
grande différence de toutes ces bagatelles
à la beauté des pièces sérieuses. Cependant tout le monde donne
là-dedans aujourd’hui : on ne court plus qu’à cela, et l’on voit une
solitude effroyable aux grands ouvrages, lorsque des sottises ont tout
Paris » (scène VI). La valeur dépréciative du terme « bagatelle » est
également soulignée dans le Nouveau Parnasse (1663) de
Sorel : « Pour les orateurs galants, qui étaient des écrivains en prose,
lesquels ne s’occupaient qu’à faire d’agréables lettres et des billets
doux ou des romans tendres, et autres pièces divertissantes, les gens du
parti sérieux les appelaient des sophistes et des conteurs de bagatelles
» (, p. 6). .
Le même constat est effectué, dans La Critique de
l’École des femmes (1663), par le poète ridicule Lysidas,
qui déplore l’évolution du goût du public théâtral : « …il y a une
grande différence de toutes ces bagatelles
à la beauté des pièces sérieuses. Cependant tout le monde donne
là-dedans aujourd’hui : on ne court plus qu’à cela, et l’on voit une
solitude effroyable aux grands ouvrages, lorsque des sottises ont tout
Paris » (scène VI). La valeur dépréciative du terme « bagatelle » est
également soulignée dans le Nouveau Parnasse (1663) de
Sorel : « Pour les orateurs galants, qui étaient des écrivains en prose,
lesquels ne s’occupaient qu’à faire d’agréables lettres et des billets
doux ou des romans tendres, et autres pièces divertissantes, les gens du
parti sérieux les appelaient des sophistes et des conteurs de bagatelles
» (, p. 6). .
VI
Outre le privilège du Roi qu'il faut avoir pour faire imprimer un livre, les
auteurs seront obligés d'avoir une approbation 139139 des seigneurs
de l'Académie française Au moment de la publication des
Nouvelles Nouvelles (février 1663), l’Académie
française se compose de quarante-deux membres, dont onze siégeaient
depuis sa fondation par Richelieu en 1634. Les plus célèbres parmi ces
membres fondateurs sont Valentin Conrart, Jean Desmarets de
Saint-Sorlin, le marquis de Racan, et Jean Chapelain. Y figurent
également en 1663 le Chancelier Pierre Séguier (élu en 1635, devenu
protecteur de l’Académie à la mort de Richelieu en 1642), François de La
Mothe le Vayer (élu en 1639), Pierre Corneille (1647), François-Eudes de
Mézeray (1648), Georges de Scudéry (1650), Paul Pellisson (1653),
Charles Cotin (1655), Gilles Boileau (1659), Antoine Furetière et Jean
Renaud de Segrais (élus en 1662). Le Comte de Saint-Aignan sera reçu en
juillet 1663., sans laquelle le roi sera prié de ne plus
accorder de privilège, et défenses seront faites à tous libraires et imprimeurs
d'imprimer aucuns livres sans voir ladite approbation attachée aux privilèges du
Roi qu'auront obtenus les auteurs.
Au moment de la publication des
Nouvelles Nouvelles (février 1663), l’Académie
française se compose de quarante-deux membres, dont onze siégeaient
depuis sa fondation par Richelieu en 1634. Les plus célèbres parmi ces
membres fondateurs sont Valentin Conrart, Jean Desmarets de
Saint-Sorlin, le marquis de Racan, et Jean Chapelain. Y figurent
également en 1663 le Chancelier Pierre Séguier (élu en 1635, devenu
protecteur de l’Académie à la mort de Richelieu en 1642), François de La
Mothe le Vayer (élu en 1639), Pierre Corneille (1647), François-Eudes de
Mézeray (1648), Georges de Scudéry (1650), Paul Pellisson (1653),
Charles Cotin (1655), Gilles Boileau (1659), Antoine Furetière et Jean
Renaud de Segrais (élus en 1662). Le Comte de Saint-Aignan sera reçu en
juillet 1663., sans laquelle le roi sera prié de ne plus
accorder de privilège, et défenses seront faites à tous libraires et imprimeurs
d'imprimer aucuns livres sans voir ladite approbation attachée aux privilèges du
Roi qu'auront obtenus les auteurs.
VII
Nul ne sera proposé pour être reçu auteur et n’aura de permission de faire
imprimer ses œuvres avant que d’avoir composé et jeté au feu plus de dix mille
vers et trois ou quatre rames de papier pleines de prose. L’activité d’auteur est un métier qui ne s’acquiert qu’après un long
exercice - et non une occupation de « loisir mondain » - affirme
ironiquement cet article. Le suivant en tirera les conséquences : les
femmes ont droit dès lors à un statut spécial, en vertu de leur nature
différente.
L’activité d’auteur est un métier qui ne s’acquiert qu’après un long
exercice - et non une occupation de « loisir mondain » - affirme
ironiquement cet article. Le suivant en tirera les conséquences : les
femmes ont droit dès lors à un statut spécial, en vertu de leur nature
différente.
VIII
Les femmes seront beaucoup 140140 plus tôt reçues que les hommes dans le
corps des auteurs et elles auront permission de faire imprimer après avoir
composé deux mille vers et écrit une rame de papier de prose et, par un privilège tout
particulier, ces premiers ouvrages auront de l’estime parmi le monde et seront
conservés, parce que le beau sexe ne fait rien qu’avec application et où
l’on ne remarque beaucoup de génie et beaucoup d’esprit. En
soulignant l’« esprit » et le « génie » – c'est-à-dire le talent natif –
des femmes, Donneau de Visé se conforme à la thèse souvent affirmée par
les philosophes – et reçue dans les milieux mondains –, qui veut que
leurs qualités dominantes soient plus de l'ordre de l'aptitude
naturelle, de la capacité innée à saisir ce qui est beau, que le fruit
de l'effort, de la réflexion et de l'étude, comme la critique moderne
l'a souligné. C’est autour de cette notion de facilité spontanée du
savoir qu’offre la langue française que le mythe du naturel féminin va
trouver son ancrage. La plupart des philosophes à partir de Malebranche,
Poullain de la Barre compris, semblent admettre qu’un degré supérieur de
délicatesse caractérise les fibres du cerveau féminin, ce qui explique
la plus grande promptitude de leur esprit, leur capacité supérieure de
discernement. Les femmes auraient une sensibilité naturelle pour ce qui
est clair, vif, naturel et de bon sens. Comme elles pensent
naturellement, elles parlent naturellement et raisonnablement, et
inversement. […] (p. 57) Maître, Myriam., « Les “belles” et les belles
lettres : femmes, instances du féminin et nouvelles configurations du
savoir » dans Lyons, J. D., Welch, C., Le Savoir au XVIIe
siècle, Actes du 34e congrès annuel de la North American
Society of Seventeenth-Century French Literature, University of
Virginia, Charlottesville, 14-16 mars 2002, p. 35-67. Le talent inné des
femmes leur assure une production de qualité du premier coup, les
dispensant d’un long apprentissage et de fastidieux essais ; il leur
permet aussi de juger avec rapidité, là où leurs homologues masculins se
perdent en considérations inutiles. Ce culte du naturel, de ce qui
semble jaillir spontanément, va de pair avec la préférence accordée aux
pièces mineures – voir l’article V –, composées « sur le vif », et non
longuement mûries dans un cabinet, et rejoint en partie la préférence
donnée à la poésie au détriment d’autres formes comme l’histoire et la
traduction, qui demandent plus d’érudition et un travail de plus longue
haleine.
En
soulignant l’« esprit » et le « génie » – c'est-à-dire le talent natif –
des femmes, Donneau de Visé se conforme à la thèse souvent affirmée par
les philosophes – et reçue dans les milieux mondains –, qui veut que
leurs qualités dominantes soient plus de l'ordre de l'aptitude
naturelle, de la capacité innée à saisir ce qui est beau, que le fruit
de l'effort, de la réflexion et de l'étude, comme la critique moderne
l'a souligné. C’est autour de cette notion de facilité spontanée du
savoir qu’offre la langue française que le mythe du naturel féminin va
trouver son ancrage. La plupart des philosophes à partir de Malebranche,
Poullain de la Barre compris, semblent admettre qu’un degré supérieur de
délicatesse caractérise les fibres du cerveau féminin, ce qui explique
la plus grande promptitude de leur esprit, leur capacité supérieure de
discernement. Les femmes auraient une sensibilité naturelle pour ce qui
est clair, vif, naturel et de bon sens. Comme elles pensent
naturellement, elles parlent naturellement et raisonnablement, et
inversement. […] (p. 57) Maître, Myriam., « Les “belles” et les belles
lettres : femmes, instances du féminin et nouvelles configurations du
savoir » dans Lyons, J. D., Welch, C., Le Savoir au XVIIe
siècle, Actes du 34e congrès annuel de la North American
Society of Seventeenth-Century French Literature, University of
Virginia, Charlottesville, 14-16 mars 2002, p. 35-67. Le talent inné des
femmes leur assure une production de qualité du premier coup, les
dispensant d’un long apprentissage et de fastidieux essais ; il leur
permet aussi de juger avec rapidité, là où leurs homologues masculins se
perdent en considérations inutiles. Ce culte du naturel, de ce qui
semble jaillir spontanément, va de pair avec la préférence accordée aux
pièces mineures – voir l’article V –, composées « sur le vif », et non
longuement mûries dans un cabinet, et rejoint en partie la préférence
donnée à la poésie au détriment d’autres formes comme l’histoire et la
traduction, qui demandent plus d’érudition et un travail de plus longue
haleine.
IX
Ceux qui ne pourront se faire estimer dans les ruelles n’auront jamais d’approbation générale dans le monde, quoi qu’ils puissent faire de bien. C’est pourquoi ils sont avertis de ne point faire 141141 de presse au Parnasse, de peur de perdre leur temps.
X
Il est défendu à tous les auteurs de prendre pour épouses aucunes femmes
qui soient reçues dans leur corps La situation qu’envisage
cet article semble hypothétique, car l’existence de tels couples à
l’époque de la publication des Nouvelles Nouvelles n’a
(jusqu’ici) pas été documentée. L’exemple le plus célèbre du XVIIe
siècle est celui du couple Dacier (mariés en 1683). André Dacier
(1651-1722) était un traducteur et philologue, élu à l’Académie
française en 1695, et son épouse, Anne Le Fèvre (1645-1720), était une
classiciste illustre, traductrice d’Homère et de Sapho. À l’époque de
leur mariage, elle avait déjà publié de nombreux ouvrages. Mais ce cas
semble unique : aucune des autres femmes d’esprit du XVIIe siècle n’a
épousé un intellectuel. La poétesse et dramaturge Françoise Pascal ne
s’est apparemment jamais mariée, et Marie-Catherine Desjardins (dite Mme
de Villedieu) a publié la plupart de ses ouvrages avant son mariage en
1677 avec Claude-Nicolas de Chaste. La plaisanterie de Donneau procède
de l’amalgame de deux traits de satire distincts : la propension au
litige des gens de lettres (Furetière « Les auteurs sont
sujets à se quereller et à se dire beaucoup d’injures »,
Dictionnaire universel, à l’article « auteur »),
d’une part ; et d’autre part, le caractère acariâtre et dominateur des
femmes savantes, tel que l’avait remis au goût du jour la récente
Académie des femmes (1661) de Chappuzeau et que le
développera pleinement la comédie de Molière en 1672. et,
à toutes celles qui en sont, de prendre aucuns auteurs pour maris, non seulement
pour éviter les querelles, qui ne sont que trop fréquentes entre les gens
d’esprit, mais encore parce que leur ménage n’irait pas bien et que les femmes
qui écrivent ne peuvent avoir tout le soin que demande un semblable
embarras.
La situation qu’envisage
cet article semble hypothétique, car l’existence de tels couples à
l’époque de la publication des Nouvelles Nouvelles n’a
(jusqu’ici) pas été documentée. L’exemple le plus célèbre du XVIIe
siècle est celui du couple Dacier (mariés en 1683). André Dacier
(1651-1722) était un traducteur et philologue, élu à l’Académie
française en 1695, et son épouse, Anne Le Fèvre (1645-1720), était une
classiciste illustre, traductrice d’Homère et de Sapho. À l’époque de
leur mariage, elle avait déjà publié de nombreux ouvrages. Mais ce cas
semble unique : aucune des autres femmes d’esprit du XVIIe siècle n’a
épousé un intellectuel. La poétesse et dramaturge Françoise Pascal ne
s’est apparemment jamais mariée, et Marie-Catherine Desjardins (dite Mme
de Villedieu) a publié la plupart de ses ouvrages avant son mariage en
1677 avec Claude-Nicolas de Chaste. La plaisanterie de Donneau procède
de l’amalgame de deux traits de satire distincts : la propension au
litige des gens de lettres (Furetière « Les auteurs sont
sujets à se quereller et à se dire beaucoup d’injures »,
Dictionnaire universel, à l’article « auteur »),
d’une part ; et d’autre part, le caractère acariâtre et dominateur des
femmes savantes, tel que l’avait remis au goût du jour la récente
Académie des femmes (1661) de Chappuzeau et que le
développera pleinement la comédie de Molière en 1672. et,
à toutes celles qui en sont, de prendre aucuns auteurs pour maris, non seulement
pour éviter les querelles, qui ne sont que trop fréquentes entre les gens
d’esprit, mais encore parce que leur ménage n’irait pas bien et que les femmes
qui écrivent ne peuvent avoir tout le soin que demande un semblable
embarras.
XI
Tous les auteurs ne laisseront 142142 passer aucune occasion de dire du bien des protecteurs du Parnasse.
XII
Le duc de ……, la marquise de M….., le comte de ….. et le chevalier du ……, perpétuel auditeur des pièces de théâtre, grand amateur et juste juge de ces poèmes, seront remerciés des bons offices qu’ils ont, toute leur vie, rendus aux gens de lettres. Leurs noms seront conservés dans un temple de mémoire, qui sera élevé sur le Parnasse même, et seront mis devant ceux des auteurs les plus célèbres.
XIII
Ceux qui écriront contre Apollon et contre les Muses n’ob-143143tiendront plus de permission de l’Académie de faire imprimer leurs œuvres et seront déclarés criminels de lèse-Apollon au premier chef, parce que c’est le plus grand crime qu’ils puissent commettre contre lui, ne pouvant s’attaquer à la vie d’un dieu.
XIV
Les auteurs qui pourront trouver quelque chose de si nouveau L’importance du critère de la « nouveauté » justifie que
le règlement y consacre un article spécifique. que chacun
demeure d’accord de n’avoir jamais rien vu de semblable seront les plus estimés,
quand même leurs ouvrages n’auraient pas la dernière perfection.
L’importance du critère de la « nouveauté » justifie que
le règlement y consacre un article spécifique. que chacun
demeure d’accord de n’avoir jamais rien vu de semblable seront les plus estimés,
quand même leurs ouvrages n’auraient pas la dernière perfection.
XV
L’impossibilité qu’il y a d’em-144144pêcher que l’on ne fasse de satires,
parce qu’elles sont plus en vogue que jamais Le début des
années 1660 voit un nouvel essor de la satire en vers, accompagné
d’une réflexion sur les conditions et les limites du genre.
et ceux qui réussissent en ce genre d’écrire beaucoup plus estimés qu’ils ne
devraient être, fait que nous permettons celles qui, en s’attaquant à tout le
monde, ne s’attaquent à personne
Le début des
années 1660 voit un nouvel essor de la satire en vers, accompagné
d’une réflexion sur les conditions et les limites du genre.
et ceux qui réussissent en ce genre d’écrire beaucoup plus estimés qu’ils ne
devraient être, fait que nous permettons celles qui, en s’attaquant à tout le
monde, ne s’attaquent à personne Dans La Critique
de l’École des femmes (1663), Molière met des arguments
semblables dans la bouche d’Uranie, qui parle de l’utilité des satires «
générales » : « Pour moi, je me garderai bien de m’en
offenser [des satires] et de prendre rien sur mon compte de tout ce qui
s’y dit. Ces sortes de satires tombent directement sur les mœurs, et ne
frappent les personnes que par réflexion. N’allons point nous appliquer
nous-mêmes les traits d’une censure générale ; et profitons de la leçon,
si nous pouvons, sans faire semblant qu’on parle à nous. Toutes les
peintures ridicules qu’on expose sur les théâtres doivent être regardées
sans chagrin de tout le monde. Ce sont miroirs publics, où il ne faut jamais témoigner qu’on se voie… » (scène
VI)., qui reprennent agréablement les mauvaises mœurs, qui blâment en
divertissant les coutumes ridicules et qui, pour l’ordinaire, produisent de bons
effets en faisant souvent changer ceux qu’elles font le plus rire.
Dans La Critique
de l’École des femmes (1663), Molière met des arguments
semblables dans la bouche d’Uranie, qui parle de l’utilité des satires «
générales » : « Pour moi, je me garderai bien de m’en
offenser [des satires] et de prendre rien sur mon compte de tout ce qui
s’y dit. Ces sortes de satires tombent directement sur les mœurs, et ne
frappent les personnes que par réflexion. N’allons point nous appliquer
nous-mêmes les traits d’une censure générale ; et profitons de la leçon,
si nous pouvons, sans faire semblant qu’on parle à nous. Toutes les
peintures ridicules qu’on expose sur les théâtres doivent être regardées
sans chagrin de tout le monde. Ce sont miroirs publics, où il ne faut jamais témoigner qu’on se voie… » (scène
VI)., qui reprennent agréablement les mauvaises mœurs, qui blâment en
divertissant les coutumes ridicules et qui, pour l’ordinaire, produisent de bons
effets en faisant souvent changer ceux qu’elles font le plus rire.
XVI
Les poètes seront tenus pour gens illustres, vu la quantité de gens de
qualité Savoir faire des vers compte parmi les signes
de galanterie. Des petits marquis aux grandes dames, chacun s’applique
donc à la versification. Les recueils poétiques des années 1650-1660
accueillent ainsi des vers d’Henriette Coligny de La Suze, de Charlotte
de Brégy, ou de Monsieur de Bouillon, tandis que l’on célèbre le talent
de Saint-Aignan. qui se mêlent de faire des
vers. 145145
Savoir faire des vers compte parmi les signes
de galanterie. Des petits marquis aux grandes dames, chacun s’applique
donc à la versification. Les recueils poétiques des années 1650-1660
accueillent ainsi des vers d’Henriette Coligny de La Suze, de Charlotte
de Brégy, ou de Monsieur de Bouillon, tandis que l’on célèbre le talent
de Saint-Aignan. qui se mêlent de faire des
vers. 145145
XVII
Il est défendu, sur peine de
n’obtenir de cinq ans de permission de faire imprimer, de
composer de méchants vers et de
se servir de mots non approuvés On retrouvera le même
type de plaisanterie dans Le Parnasse réformé
(1668) (« Voulons que l’Académie punisse comme criminels de lèse-majesté
apollinaire ceux qui corrompront la langue », p. 132-133), ainsi que
dans Les Femmes savantes de Molière (projet d’épuration
de la langue par Armande, III, 2, 901-908). pour exprimer
une belle pensée, parce que c’est là l’origine des méchants vers que l’on voit
tous les jours. Et comme ce sont les grands auteurs et ceux qui sont le plus
généralement approuvés qui, croyant que tout leur est permis, le font exprès
pour faire dire qu’ils sont au-dessus des règles et qu’ils ont le droit d’en
donner, comme celui de prendre des licences, et que les autres, s’imaginant bien faire, les
imitent en ce qu’ils font de mal de même qu’en ce qu’ils 146146 font de
beau, il leur est plus expressément défendu qu’aux autres de prendre dorénavant
aucune licence de cette
nature.
On retrouvera le même
type de plaisanterie dans Le Parnasse réformé
(1668) (« Voulons que l’Académie punisse comme criminels de lèse-majesté
apollinaire ceux qui corrompront la langue », p. 132-133), ainsi que
dans Les Femmes savantes de Molière (projet d’épuration
de la langue par Armande, III, 2, 901-908). pour exprimer
une belle pensée, parce que c’est là l’origine des méchants vers que l’on voit
tous les jours. Et comme ce sont les grands auteurs et ceux qui sont le plus
généralement approuvés qui, croyant que tout leur est permis, le font exprès
pour faire dire qu’ils sont au-dessus des règles et qu’ils ont le droit d’en
donner, comme celui de prendre des licences, et que les autres, s’imaginant bien faire, les
imitent en ce qu’ils font de mal de même qu’en ce qu’ils 146146 font de
beau, il leur est plus expressément défendu qu’aux autres de prendre dorénavant
aucune licence de cette
nature.
XVIII
Défenses sont faites à tous les auteurs de plus mentir dorénavant dans les épîtres
liminaires Autre plaisanterie reprise dans
Le Parnasse réformé
:
« Article X. Défendons de mentir dans les épîtres dédicatoires. » (p. 132). L’humour sur les épîtres dédicatoires
est monnaie courante. et, pour détruire plus facilement
cette mauvaise coutume, nous ordonnons que l’on ne recevra plus d’auteurs qui
n’aient de quoi vivre honorablement, sachant bien que le désir d’avoir de
l’argent les fait souvent parler contre la vérité ; c’est pourquoi nous leur
défendons d’en prendre. Mais pour donner lieu à la libéralité des princes de s’exercer, nous
ne leur pouvons défendre d’accepter des présents,147147 parce qu’il n’y a
rien de honteux pour eux, ni pour leur corps, que cela s’est pratiqué de tout
temps et que les rois s’en font les uns aux autres.
Autre plaisanterie reprise dans
Le Parnasse réformé
:
« Article X. Défendons de mentir dans les épîtres dédicatoires. » (p. 132). L’humour sur les épîtres dédicatoires
est monnaie courante. et, pour détruire plus facilement
cette mauvaise coutume, nous ordonnons que l’on ne recevra plus d’auteurs qui
n’aient de quoi vivre honorablement, sachant bien que le désir d’avoir de
l’argent les fait souvent parler contre la vérité ; c’est pourquoi nous leur
défendons d’en prendre. Mais pour donner lieu à la libéralité des princes de s’exercer, nous
ne leur pouvons défendre d’accepter des présents,147147 parce qu’il n’y a
rien de honteux pour eux, ni pour leur corps, que cela s’est pratiqué de tout
temps et que les rois s’en font les uns aux autres.
XIX
Nous ordonnons à tous les auteurs qui seront reçus à l’avenir, et qui auront tous de quoi vivre honorablement sans avoir besoin de personne, de ne point céder aux ignorants, quand même ils seraient beaucoup au-dessus d’eux, et de faire toutes les civilités et rendre tous les honneurs imaginables aux gens de qualité qui font des vers, parce qu’ils leur font honneur d’être de leur corps. 148148
XX
Avant que d’arrêter un auteur prisonnier, on avertira l’Académie, laquelle
prendra soin d’en avertir tous les auteurs, qui seront tous obligés de
faire la somme dont il
sera redevable, afin de n’avoir pas l’affront d’avoir un confrère
prisonnier L’histoire littéraire en retient quelques
exemples. Suite aux difficultés financières de L’Illustre théâtre,
Molière avait été emprisonné au Châtelet durant le mois d’août 1645. Le
15 juin 1671, le poète Pierre Perrin fut incarcéré à la suite de son
association avec le marquis de Sourdéac et Champeron, permettant à Lully
de récupérer le privilège de la musique au théâtre. . Mais
comme il se pourrait trouver quelques personnes qui, se fiant trop sur ce
règlement, pourraient s’endetter, ladite Académie sera tenue d’examiner quelles
gens auront contracté ces dettes et pour quelles raisons, et si elle trouve
qu’ils l’aient fait sans un pressant besoin, elle leur fera de grandes
réprimandes pour la première fois et, s’ils y retournent, elle les déclarera
indignes d’avoir 149149 aucun rang dans le corps spirituel des auteurs,
leur défendra de faire voir aucuns de leurs ouvrages et ne leur accordera à
l’avenir nulle permission d’imprimer.
L’histoire littéraire en retient quelques
exemples. Suite aux difficultés financières de L’Illustre théâtre,
Molière avait été emprisonné au Châtelet durant le mois d’août 1645. Le
15 juin 1671, le poète Pierre Perrin fut incarcéré à la suite de son
association avec le marquis de Sourdéac et Champeron, permettant à Lully
de récupérer le privilège de la musique au théâtre. . Mais
comme il se pourrait trouver quelques personnes qui, se fiant trop sur ce
règlement, pourraient s’endetter, ladite Académie sera tenue d’examiner quelles
gens auront contracté ces dettes et pour quelles raisons, et si elle trouve
qu’ils l’aient fait sans un pressant besoin, elle leur fera de grandes
réprimandes pour la première fois et, s’ils y retournent, elle les déclarera
indignes d’avoir 149149 aucun rang dans le corps spirituel des auteurs,
leur défendra de faire voir aucuns de leurs ouvrages et ne leur accordera à
l’avenir nulle permission d’imprimer.
XXI
Ceux qui, dans leurs vers, donneront des louanges à des personnes qui ne les auront pas méritées seront obligés de s’en dédire publiquement, afin que l’affront qu’en recevront les uns et les autres empêche les uns d’en donner et les autres d’en acheter.
XXII
Comme l’esprit est une des plus belles et des plus avantageuses qualités que
puissent avoir les hommes, et la seule qui les puisse 150150 rendre
considérables par eux-mêmes, ceux qui font bien des vers et qui ne l’avouent
qu’avec peine, et le plus souvent ne l’avouent point du tout Avoir de l’esprit et de savoir faire de vers est unanimement
valorisé dans la France galante. S’en réclamer, en revanche, requiert
une certaine prudence. Le risque est soit d’être ridiculisé comme
mauvais poète (voir Mascarille dans les Précieuses
ridicules ou, plus tard Oronte dans Le
Misanthrope), soit de passer pour un écrivain laborieux,
contraire à l’idéal brillant de la galanterie. Les tactiques mises en
oeuvre sont alors multiples : manuscrit volés ou pris en charge par
l’éditeur (Poésies choisies de Sercy, Desjardins dans son
Recueil de quelques lettres et relations
galantes), nonchalance affichée dans les discours liminaires
(Furetière ou Le Pays) ou, justement, publication anonyme. Dans son Roman
Bourgeois (1666), Furetière traite le même sujet, racontant
l’histoire d’« un fort honnête homme qui ne voulait point passer pour
auteur déclaré, le [le libraire] vint menacer de lui donner des coups de
bâton à cause qu’il avait fait imprimer un petit nombre de vers de
galanterie sous son nom, et l’avait mis au commencement du livre, dans
le catalogue des auteurs, qu’il avait même fait afficher au coin des
rues. » (p. 247)., croyant qu’il y ait du déshonneur pour eux,
seront obligés dans six
mois, ou d’avouer publiquement qu’ils en font, ou de n’en plus faire du
tout.
Avoir de l’esprit et de savoir faire de vers est unanimement
valorisé dans la France galante. S’en réclamer, en revanche, requiert
une certaine prudence. Le risque est soit d’être ridiculisé comme
mauvais poète (voir Mascarille dans les Précieuses
ridicules ou, plus tard Oronte dans Le
Misanthrope), soit de passer pour un écrivain laborieux,
contraire à l’idéal brillant de la galanterie. Les tactiques mises en
oeuvre sont alors multiples : manuscrit volés ou pris en charge par
l’éditeur (Poésies choisies de Sercy, Desjardins dans son
Recueil de quelques lettres et relations
galantes), nonchalance affichée dans les discours liminaires
(Furetière ou Le Pays) ou, justement, publication anonyme. Dans son Roman
Bourgeois (1666), Furetière traite le même sujet, racontant
l’histoire d’« un fort honnête homme qui ne voulait point passer pour
auteur déclaré, le [le libraire] vint menacer de lui donner des coups de
bâton à cause qu’il avait fait imprimer un petit nombre de vers de
galanterie sous son nom, et l’avait mis au commencement du livre, dans
le catalogue des auteurs, qu’il avait même fait afficher au coin des
rues. » (p. 247)., croyant qu’il y ait du déshonneur pour eux,
seront obligés dans six
mois, ou d’avouer publiquement qu’ils en font, ou de n’en plus faire du
tout.
XXIII
Les auteurs seront regardés comme personnes de mérite qui, par leur esprit, sont au-dessus du reste des hommes. Ils seront respectés de tout le monde. Ceux de théâtre le seront surtout des comédiens, et les uns et les autres le seront des libraires, parce qu’ils les font gagner.
— Dites qu’ils se font gagner l’un 151151 l’autre, dit Ariste à Straton, dès qu’il eut achevé de lire cet article.
— Il est vrai, lui repartit Clorante, mais les auteurs ne sont pas ceux qui gagnent le plus.
Après quoi Straton continua de lire.
XXIV
Ceux qui aiment passionnément les lettres, qui se plaisent à lire les beaux livres, qui recherchent tous les beaux vers et aiment à les entendre réciter, ne laisseront pas, bien qu’ils n’écrivent point, d’avoir rang dans le Parnasse après les auteurs.
XXV
Tous les auteurs sont invités de
se vêtir souvent de noir C’est le costume dans lequel se
présentera Trissotin auprès de Philaminte (Les Femmes
savantes III, 3, v. 928)., pour mieux soutenir
la gravité de leur 152152
profession, et les plus anciens de leur corps ne porteront point de
dentelles.
C’est le costume dans lequel se
présentera Trissotin auprès de Philaminte (Les Femmes
savantes III, 3, v. 928)., pour mieux soutenir
la gravité de leur 152152
profession, et les plus anciens de leur corps ne porteront point de
dentelles.
XXVI
Tous ceux qui seront reçus auteurs seront tenus de faire une pièce à la louange des Muses, de l’Académie et de la profession qu’ils embrassent.
XXVII
Les auteurs qui auront autrefois fait deux ou trois pièces de théâtre, bien
qu’ils ne travaillent plus, jouiront de leur ancien privilège d’entrer à la
comédie sans payer. Ceux qui travailleront encore pourront mener de leurs amis
avec eux, et surtout aux premières représentations de leurs 153153
pièces, où ils auront grand pouvoir. Ceux qui font des romans et qui ont grande
réputation dans le monde auront aussi le privilège d’y entrer, mais sans pouvoir
mener personne avec eux. Ce privilège leur est octroyé parce que leurs ouvrages
fournissent de beaux sujets et des incidents considérables Parmi les pièces contemporaines tirées de romans, on peut citer la
tragédie Timocrate (1656) de Thomas Corneille, basée sur
le Cléopâtre de La Calprenède, ainsi que sa
Bérénice (1657), qui trouve sa source dans un épisode
du Grand Cyrus des Scudéry. La tragicomédie
Sésostris de Françoise Pascal (Lyon, 1660) s’inspire
elle aussi de ce roman. aux auteurs qui travaillent pour le
théâtre, et sera appelé « privilège de bel esprit ».
Parmi les pièces contemporaines tirées de romans, on peut citer la
tragédie Timocrate (1656) de Thomas Corneille, basée sur
le Cléopâtre de La Calprenède, ainsi que sa
Bérénice (1657), qui trouve sa source dans un épisode
du Grand Cyrus des Scudéry. La tragicomédie
Sésostris de Françoise Pascal (Lyon, 1660) s’inspire
elle aussi de ce roman. aux auteurs qui travaillent pour le
théâtre, et sera appelé « privilège de bel esprit ».
XXVIII
Il est très expressément défendu à tous les auteurs d’écrire contre
aucun de leur corps Dans La Critique de
L’Ecole des femmes, Dorante dénoncera les guerres d’auteurs,
« leurs ligues offensives et défensives ; aussi bien que leurs guerres
d’esprit, et leurs combats de prose, et de vers » (sc. VI). Le début des
années 1660 avait été marqué par les affrontements spectaculaires qui
avaient opposé, à coups de libelles imprimés, Gilles Ménage et Charles
Cotin (La Ménagerie), ainsi que, dans une actualité toute
récente, par les attaques de l’abbé d’Aubignac contre Corneille (les
Remarques sur la tragédie de Sophonisbe de Monsieur Corneille
sont sur le point de paraître), mais bien contre ceux qui
n’en sont pas, ce qu’ils ne pourront toutefois faire à moins que l’on n’ait
écrit contre eux. Ils sont aussi a-154154vertis de bien prendre garde de
ne point écrire contre l’honneur des dames
Dans La Critique de
L’Ecole des femmes, Dorante dénoncera les guerres d’auteurs,
« leurs ligues offensives et défensives ; aussi bien que leurs guerres
d’esprit, et leurs combats de prose, et de vers » (sc. VI). Le début des
années 1660 avait été marqué par les affrontements spectaculaires qui
avaient opposé, à coups de libelles imprimés, Gilles Ménage et Charles
Cotin (La Ménagerie), ainsi que, dans une actualité toute
récente, par les attaques de l’abbé d’Aubignac contre Corneille (les
Remarques sur la tragédie de Sophonisbe de Monsieur Corneille
sont sur le point de paraître), mais bien contre ceux qui
n’en sont pas, ce qu’ils ne pourront toutefois faire à moins que l’on n’ait
écrit contre eux. Ils sont aussi a-154154vertis de bien prendre garde de
ne point écrire contre l’honneur des dames Allusion
possible à l’épisode du madrigal de l’abbé Cotin sur la surdité de Mlle
de Scudéry. Ce poème avait déclenché vers 1660 une querelle entre l’abbé
et Gilles Ménage, qui avait jugé ces vers offensants et avait voulu
défendre l’honneur de son amie. Cotin donne sa version des événements au
début de son recueil de vers, La Ménagerie
(p. 4). , parce que c’est le plus grand crime qu’ils
puissent commettre, et pour lequel nous avons ordonné de très cruelles
peines.
Allusion
possible à l’épisode du madrigal de l’abbé Cotin sur la surdité de Mlle
de Scudéry. Ce poème avait déclenché vers 1660 une querelle entre l’abbé
et Gilles Ménage, qui avait jugé ces vers offensants et avait voulu
défendre l’honneur de son amie. Cotin donne sa version des événements au
début de son recueil de vers, La Ménagerie
(p. 4). , parce que c’est le plus grand crime qu’ils
puissent commettre, et pour lequel nous avons ordonné de très cruelles
peines.
XXIX
Les personnes d’épée qui seront reçues au nombre des auteurs seront plus
estimées que les autres, parce qu’elles sont capables de plus d’une chose et
qu’elles peuvent se servir de la plume et de l’épée Motif
topique de la littérature européenne et sujet de nombreuses
dissertations humanistes, l’alliance de la plume et de l’épée concerne
habituellement des enjeux d’État. Elle trouve ici un application
originale et comique à la question des querelles
littéraires. pour défendre les auteurs.
Motif
topique de la littérature européenne et sujet de nombreuses
dissertations humanistes, l’alliance de la plume et de l’épée concerne
habituellement des enjeux d’État. Elle trouve ici un application
originale et comique à la question des querelles
littéraires. pour défendre les auteurs.
XXX
L’on continuera d’observer plus exactement que jamais l’ancien-155155ne
coutume de faire des vers sur la mort des plus considérables auteurs La pratique est courante dans l’Europe humaniste. Si
certaines compositions sont publiées dans les recueils collectifs (voir
notamment L’Académie des poètes modernes
français ; voir Miriam Speyer, Briller par la diversité : les
recueils collectifs de poésies au XVIIe siècle (1597-1671),
Université de Caen, 2019), ils trouvent place avant tout dans les
tombeaux poétiques dédiés notamment aux grands auteurs (voir P.
Desmoulières, Les Recueils de poésie funèbre imprimés en Italie,
en France et dans les Îles britanniques (1587-1644), thèse
Paris-Sorbonne, 2016). On en trouve également dans les « Pompes funèbres
», qui consistent à relater une procession mortuaire fictive (et parfois
burlesque) en vers ou en prosimètre pour célébrer l’auteur défunt. Le
genre est alors particulièrement à la mode, suite à la parution en 1660
de deux pompes funèbres dédiées à Scarron, composées par Somaize et
Boucher. La seconde est entièrement en vers. En 1673, la mort de Molière
donnera lieu à de nombreuses épigrammes publiées entre autres dans le
Mercure galant. .
La pratique est courante dans l’Europe humaniste. Si
certaines compositions sont publiées dans les recueils collectifs (voir
notamment L’Académie des poètes modernes
français ; voir Miriam Speyer, Briller par la diversité : les
recueils collectifs de poésies au XVIIe siècle (1597-1671),
Université de Caen, 2019), ils trouvent place avant tout dans les
tombeaux poétiques dédiés notamment aux grands auteurs (voir P.
Desmoulières, Les Recueils de poésie funèbre imprimés en Italie,
en France et dans les Îles britanniques (1587-1644), thèse
Paris-Sorbonne, 2016). On en trouve également dans les « Pompes funèbres
», qui consistent à relater une procession mortuaire fictive (et parfois
burlesque) en vers ou en prosimètre pour célébrer l’auteur défunt. Le
genre est alors particulièrement à la mode, suite à la parution en 1660
de deux pompes funèbres dédiées à Scarron, composées par Somaize et
Boucher. La seconde est entièrement en vers. En 1673, la mort de Molière
donnera lieu à de nombreuses épigrammes publiées entre autres dans le
Mercure galant. .
XXXI
On aura grande estime et grande vénération pour les femmes qui seront
reçues du nombre des auteurs De nombreuses femmes sont
reconnues pour leurs écrits à l’époque de la publication des
Nouvelles Nouvelles. Parmi ces autrices actives vers
1663—celles qui avouent leurs écrits ou qui ont cherché à les faire
publier--les plus célèbres sont Madeleine de Scudéry, Marie-Catherine
Desjardins, Antoinette Deshoulières, et Henriette de Coligny, comtesse
de La Suze. Pour une liste plus ample, l’on consultera le « Répertoire
bio-bibliographique », p. 655-726 dans Les Précieuses, Naissance
des femmes de lettres en France au XVIIe siècle de Myriam
Maître, ainsi que la « Bibliography of Women Writers, 1640-1715 » qui
figure en annexe à l’étude de Joan de Jean, Tender
Geographies, Women and the Origins of the Novel in
France, p. 201-221. et l’on ne croira point,
parce qu’elles sont femmes, que leurs ouvrages ne doivent être ni
forts ni achevés.
De nombreuses femmes sont
reconnues pour leurs écrits à l’époque de la publication des
Nouvelles Nouvelles. Parmi ces autrices actives vers
1663—celles qui avouent leurs écrits ou qui ont cherché à les faire
publier--les plus célèbres sont Madeleine de Scudéry, Marie-Catherine
Desjardins, Antoinette Deshoulières, et Henriette de Coligny, comtesse
de La Suze. Pour une liste plus ample, l’on consultera le « Répertoire
bio-bibliographique », p. 655-726 dans Les Précieuses, Naissance
des femmes de lettres en France au XVIIe siècle de Myriam
Maître, ainsi que la « Bibliography of Women Writers, 1640-1715 » qui
figure en annexe à l’étude de Joan de Jean, Tender
Geographies, Women and the Origins of the Novel in
France, p. 201-221. et l’on ne croira point,
parce qu’elles sont femmes, que leurs ouvrages ne doivent être ni
forts ni achevés.
— L’on aurait tort de le croire, dit Clorante, et je ne doute point qu’elles ne soient plus favorisées des Muses que les hommes, parce qu’elles sont de leur sexe.
— Quand elles n’en seraient point favorisées, repartit Straton, elles ne
laisseraient pas que de faire de belles choses. Les femmes n’écrivent point du tout,
156156 ou elles font des chefs-d’œuvre lorsqu’elles s’en mêlent. Il y
a je ne sais quoi de si galant et de si dégagé, une si grande délicatesse et un
tour si spirituel dans tout ce qu’elles font, que l’on ne peut lire leurs
ouvrages sans en être charmé. Celles même qui sans
se mêler d’écrire aiment les lettres, qui se divertissent
à voir les beaux ouvrages et qui se mêlent d’en juger Le
propos de Straton s’inscrit dans le cadre des débats fréquents que
suscite la reconnaissance d’une capacité des femmes à formuler des
jugements pertinents sur les ouvrages littéraires., ont
l’esprit plus pénétrant et portent un jugement plus assuré d’un ouvrage que la
plupart des plus grands hommes qui, voulant trop raffiner, demeurent toujours
dans le doute et ne décident jamais rien. Et j’ai peu vu de ces sortes de femmes
qui se soient trompées, lorsqu’elles ont dit qu’un livre serait estimé et qu’une
pièce de théâtre réussirait.
Le
propos de Straton s’inscrit dans le cadre des débats fréquents que
suscite la reconnaissance d’une capacité des femmes à formuler des
jugements pertinents sur les ouvrages littéraires., ont
l’esprit plus pénétrant et portent un jugement plus assuré d’un ouvrage que la
plupart des plus grands hommes qui, voulant trop raffiner, demeurent toujours
dans le doute et ne décident jamais rien. Et j’ai peu vu de ces sortes de femmes
qui se soient trompées, lorsqu’elles ont dit qu’un livre serait estimé et qu’une
pièce de théâtre réussirait.
Mais permettez-moi, 157157 continua le même, de quitter les louanges du beau sexe pour achever de vous faire voir la lettre que je vous lisais auparavant, car j’ai des affaires pressantes qui m’appellent à la ville.
La Renommée sera priée de se trouver dans trois jours dans notre Conseil pour recevoir de la main d’Apollon ces nouveaux règlements, afin de les aller publier après par tout le Parnasse et dans toutes les villes de France, et non dans aucun autre pays, parce qu’il y a des choses qui ne sont que pour ce royaume et qui ne seraient ni bien reçues ni approuvées ailleurs.
Cette déesse sera pareillement chargée de publier par tout le monde qu’à la requête d’Apollon et des Muses tous les dieux assemblés ont reconnu et entendent que chacun re-158158connaisse que le corps des auteurs est le plus célèbre de tous ceux de l’univers, à cause que l’esprit est plus estimé que la noblesse, que les charges et que les grandes richesses. Elle fera savoir en même temps que les dieux ont ordonné que les poètes auraient le premier rang parmi les auteurs, parce qu’il faut plus d’esprit, de mémoire et d’invention pour être poète que pour être historien ou traducteur.
Quelques jours après que ces règlements eurent été publiés, un auteur de théâtre dont
les comédiens avaient refusé de jouer la pièce vint présenter une requête à
Apollon, signée de plus de quarante auteurs, dans laquelle il le priait
d’ajouter à ses règlements que les comédiens ne pourraient plus jouer de pièces
sans avoir une approbation de l’Académie et qu’ils seraient obligés de 159159 jouer toutes celles qu’elle approuverait. L’affaire ayant été mise
en délibération, il fut dit que l’on n’aurait point d’égard à sa requête et
qu’il n’y avait personne qui pût mieux juger que les comédiens du succès des
ouvrages de théâtre et qui connût mieux ce qui devait plaire ou choquer, attendu
leur grande expérience et la quantité d’épreuves qu’ils en faisaient tous
les jours L’évolution d’une production dramatique dominée
par des instances théoriques et normatives (Académie française) vers un
théâtre gouverné par le succès public et l’expérience pratique constitue
l’une des grandes évolutions littéraires du XVIIe siècle. Elle trouve
son origine dans la querelle du Cid et s’impose au début
des années 1660 avec la naissance de la critique dramatique. .
L’évolution d’une production dramatique dominée
par des instances théoriques et normatives (Académie française) vers un
théâtre gouverné par le succès public et l’expérience pratique constitue
l’une des grandes évolutions littéraires du XVIIe siècle. Elle trouve
son origine dans la querelle du Cid et s’impose au début
des années 1660 avec la naissance de la critique dramatique. .
Voilà tout ce qui s’est passé de plus considérable au Parnasse depuis ma dernière lettre. Dès qu’il y arrivera quelque chose digne de vous le faire savoir, je ne manquerai pas de vous l’écrire.

— L’on ne peut rien mander
de semblable, reprit Ariste, qui ne soit à la honte d’Apollon et des
Muses Ici débute une longue série d’observations, de
bons mots et d’exemples portant sur les évolutions du monde littéraire
depuis la Fronde et en particulier sur la place des femmes, les
techniques publicitaires et leurs conséquences pour la littérature. Les
principales thématiques qu’aborde Donneau sont : – le rôle des
femmes comme arbitres de la littérature (développement largement inspiré de La
Précieuse de Pure) – le rôle de la publicité, notamment
celle des lectures publiques et des extraits. – les arguments et
qualités nécessaires au succès d’un ouvrage. – la préoccupation (=
prévention) fondée sur la réputation des auteurs. – les cabales et les
spectateurs payés pour soutenir une pièce. Guéret reprendra une partie
de ces discours dans son Parnasse réformé et dans sa
Guerre des auteurs anciens et modernes, de même que
Sorel dans le premier chapitre du traité De la connaissance
des bons livres intitulé « Du jugement des livres par les titres, par les
noms des auteurs ou par leur crédit et par toutes les premières
apparences ». . L’on voit bien qu’ils ont été contraints de
s’accommoder au temps et qu’ils n’ont fait la 160160 plupart de ces
règlements que parce que l’on les avait déjà faits par toute la France et qu’il
leur était impossible d’empêcher qu’ils ne fussent suivis. Et de vrai, Apollon et toutes les
Muses auraient beau faire des règlements contraires au premier, au 2e, au 5e, au
8e, au 9e, au 14e, au 15e, au 23e, au 25e et au 29e de ceux qu’ils viennent de
faire, avant que toute
leur autorité fût suffisante pour obliger la France à les suivre. Que l’on
n’allègue point que les Muses veulent favoriser les personnes de leur sexe dans
plusieurs de ces règlements, ce n’est qu’un discours inventé pour empêcher de
connaître le peu de pouvoir qu’elles ont sur l’esprit des hommes et pour
empêcher que l’on ne sache que la mode est beaucoup plus forte que leur
autori-161161té
Ici débute une longue série d’observations, de
bons mots et d’exemples portant sur les évolutions du monde littéraire
depuis la Fronde et en particulier sur la place des femmes, les
techniques publicitaires et leurs conséquences pour la littérature. Les
principales thématiques qu’aborde Donneau sont : – le rôle des
femmes comme arbitres de la littérature (développement largement inspiré de La
Précieuse de Pure) – le rôle de la publicité, notamment
celle des lectures publiques et des extraits. – les arguments et
qualités nécessaires au succès d’un ouvrage. – la préoccupation (=
prévention) fondée sur la réputation des auteurs. – les cabales et les
spectateurs payés pour soutenir une pièce. Guéret reprendra une partie
de ces discours dans son Parnasse réformé et dans sa
Guerre des auteurs anciens et modernes, de même que
Sorel dans le premier chapitre du traité De la connaissance
des bons livres intitulé « Du jugement des livres par les titres, par les
noms des auteurs ou par leur crédit et par toutes les premières
apparences ». . L’on voit bien qu’ils ont été contraints de
s’accommoder au temps et qu’ils n’ont fait la 160160 plupart de ces
règlements que parce que l’on les avait déjà faits par toute la France et qu’il
leur était impossible d’empêcher qu’ils ne fussent suivis. Et de vrai, Apollon et toutes les
Muses auraient beau faire des règlements contraires au premier, au 2e, au 5e, au
8e, au 9e, au 14e, au 15e, au 23e, au 25e et au 29e de ceux qu’ils viennent de
faire, avant que toute
leur autorité fût suffisante pour obliger la France à les suivre. Que l’on
n’allègue point que les Muses veulent favoriser les personnes de leur sexe dans
plusieurs de ces règlements, ce n’est qu’un discours inventé pour empêcher de
connaître le peu de pouvoir qu’elles ont sur l’esprit des hommes et pour
empêcher que l’on ne sache que la mode est beaucoup plus forte que leur
autori-161161té Le règne de la mode en France et
la nécessité qui en résulte de s'accommoder à l’usage sont des motifs
récurrents des discours postérieurs à la Fronde. On les trouve dénoncés
à maintes reprises dans La Précieuse de Pure et il feront
tout le sujet du Parnasse réformé de Gabriel
Guéret en 1669. . Elles sont toutes divines, elles n’ont
plus rien de leur sexe que la beauté et, comme elles sont beaucoup au-dessus des
femmes, il est certain qu’elles ne prennent le parti que des personnes de
mérite.
Le règne de la mode en France et
la nécessité qui en résulte de s'accommoder à l’usage sont des motifs
récurrents des discours postérieurs à la Fronde. On les trouve dénoncés
à maintes reprises dans La Précieuse de Pure et il feront
tout le sujet du Parnasse réformé de Gabriel
Guéret en 1669. . Elles sont toutes divines, elles n’ont
plus rien de leur sexe que la beauté et, comme elles sont beaucoup au-dessus des
femmes, il est certain qu’elles ne prennent le parti que des personnes de
mérite.
— Elles peuvent sans injustice, répondit Clorante, prendre celui de plusieurs
femmes qui ne cèdent en rien aux plus grands hommes de ce
siècle Outre Madeleine de Scudéry, les années 1660
connaissent une multiplication des autrices de premier plan telles que
Marie-Catherine Desjardins (future Villedieu), Henriette Coligny de la
Suze, Charlotte Saumaise de Brégy ou encore Antoinette Deshoulières.
. Mais, bien qu’il y en ait de très habiles entre celles qui se
mêlent d’écrire et celles qui font profession
ouverte de voir tous les beaux ouvrages, d’en juger et de
protéger leurs auteurs, je ne puis néanmoins estimer les gens qui font tout ce
qu’ils peuvent afin que les femmes les mettent en réputation
Outre Madeleine de Scudéry, les années 1660
connaissent une multiplication des autrices de premier plan telles que
Marie-Catherine Desjardins (future Villedieu), Henriette Coligny de la
Suze, Charlotte Saumaise de Brégy ou encore Antoinette Deshoulières.
. Mais, bien qu’il y en ait de très habiles entre celles qui se
mêlent d’écrire et celles qui font profession
ouverte de voir tous les beaux ouvrages, d’en juger et de
protéger leurs auteurs, je ne puis néanmoins estimer les gens qui font tout ce
qu’ils peuvent afin que les femmes les mettent en réputation Ici commence le premier développement sur le rôle des femmes
comme arbitres de la littérature. Le motif, bien attesté depuis les années 1630, a été
particulièrement exploité par l’abbé de Pure dans sa
Précieuse. Il se retrouvera notamment dans
Le Parnasse réformé de Gabriel
Guéret (1669) ainsi que dans De la connaissance des bons
livres de Sorel (1671). Molière en fera tout le sujet de ses
Femmes savantes. , et qui aiment mieux
devoir les applaudissements que l’on leur donne au bien qu’elles
publient d’eux 162162 qu’au mérite de leurs œuvres. Et, pour moi, je n’ai point de plus
grand divertissement que celui de voir ou de me représenter un de ces auteurs
lisant ses ouvrages au milieu de quatre ou cinq femmes
Ici commence le premier développement sur le rôle des femmes
comme arbitres de la littérature. Le motif, bien attesté depuis les années 1630, a été
particulièrement exploité par l’abbé de Pure dans sa
Précieuse. Il se retrouvera notamment dans
Le Parnasse réformé de Gabriel
Guéret (1669) ainsi que dans De la connaissance des bons
livres de Sorel (1671). Molière en fera tout le sujet de ses
Femmes savantes. , et qui aiment mieux
devoir les applaudissements que l’on leur donne au bien qu’elles
publient d’eux 162162 qu’au mérite de leurs œuvres. Et, pour moi, je n’ai point de plus
grand divertissement que celui de voir ou de me représenter un de ces auteurs
lisant ses ouvrages au milieu de quatre ou cinq femmes Les lectures publiques constituent une
technique publicitaire pratiquée avant la parution d’un ouvrage. Les
assemblées féminines représentent le nouveau public cible à conquérir,
ce que Sorel soulignera encore dans De la connaissance des bons
livres : « Quand [les] livres sont des poésies et autres
œuvres galantes, il ne faut pas manquer de les montrer aux dames, qui
aiment ces sortes de choses et ont accoutumé de leur donner le prix. »
(p. 19). qui, sans écouter ses raisons,
condamnent et lui font changer ce qui leur déplaît
Les lectures publiques constituent une
technique publicitaire pratiquée avant la parution d’un ouvrage. Les
assemblées féminines représentent le nouveau public cible à conquérir,
ce que Sorel soulignera encore dans De la connaissance des bons
livres : « Quand [les] livres sont des poésies et autres
œuvres galantes, il ne faut pas manquer de les montrer aux dames, qui
aiment ces sortes de choses et ont accoutumé de leur donner le prix. »
(p. 19). qui, sans écouter ses raisons,
condamnent et lui font changer ce qui leur déplaît La
mise en cause des critères féminins d’évaluation de la littérature
reprend notamment la critique formulée par Du Bosc dans son
Honnête femme, réédité en 1662., qui lui font retrancher ce qu’elles n’aiment
pas et lui font ajouter ce qui leur vient en la fantaisie. Tout cela
étant fait, si la pièce qu’il leur a lue est à leur gré, elles l’envoient de
maison en maison, chez toutes leurs amies, pour en faire des lectures, avec une
recommandation et un certificat de la bonté de sa pièce. Elles le produisent après elles-mêmes dans les
compagnies, elles l’y mènent
La
mise en cause des critères féminins d’évaluation de la littérature
reprend notamment la critique formulée par Du Bosc dans son
Honnête femme, réédité en 1662., qui lui font retrancher ce qu’elles n’aiment
pas et lui font ajouter ce qui leur vient en la fantaisie. Tout cela
étant fait, si la pièce qu’il leur a lue est à leur gré, elles l’envoient de
maison en maison, chez toutes leurs amies, pour en faire des lectures, avec une
recommandation et un certificat de la bonté de sa pièce. Elles le produisent après elles-mêmes dans les
compagnies, elles l’y mènent Guéret reprendra ce motif
dans Le Parnasse réformé (1669) à propos des marquis à
sonnets : « Deux ou trois coquettes de leur intrigue les appuient de
leurs suffrages, et avec cela ils se font passer pour beaux esprits »
(p. 54). C’est aussi ce que Molière mettra en scène à l’acte III
des Femmes savantes., elles font son
compliment, elles parlent de la bonté de son ouvrage, elles en
163163 racontent le sujet et rendent ce pauvre auteur si confus et si
surpris des louanges qu’elles lui donnent, qu’encore qu’il ait beaucoup
d’esprit, il n’y peut répondre que par une infinité de révérences. N’est-ce pas
là un sot personnage, et le rôle que joue cet auteur ne doit-il pas faire
une plaisante vision à l’esprit de ceux qui se le représentent ?
Guéret reprendra ce motif
dans Le Parnasse réformé (1669) à propos des marquis à
sonnets : « Deux ou trois coquettes de leur intrigue les appuient de
leurs suffrages, et avec cela ils se font passer pour beaux esprits »
(p. 54). C’est aussi ce que Molière mettra en scène à l’acte III
des Femmes savantes., elles font son
compliment, elles parlent de la bonté de son ouvrage, elles en
163163 racontent le sujet et rendent ce pauvre auteur si confus et si
surpris des louanges qu’elles lui donnent, qu’encore qu’il ait beaucoup
d’esprit, il n’y peut répondre que par une infinité de révérences. N’est-ce pas
là un sot personnage, et le rôle que joue cet auteur ne doit-il pas faire
une plaisante vision à l’esprit de ceux qui se le représentent ? Donneau de Visé en appelle à la mémoire du
lecteur/spectateur qui a déjà vu ce motif des femmes spectatrices traité
à de nombreuses reprises.
Donneau de Visé en appelle à la mémoire du
lecteur/spectateur qui a déjà vu ce motif des femmes spectatrices traité
à de nombreuses reprises.
Pour ce qui est des femmes, elles ont raison d’agir de la sorte car, ou les
ouvrages que l’on leur fait voir les divertissent quand ils sont bons, ou elles
se divertissent aux dépens des auteurs lorsqu’ils ne valent rien. Mais ce qui
est de plus à remarquer est que la connaissance que la plupart de ces sortes
d’auteurs ont de ces femmes de qualité qui mettent beaucoup de leurs confrères
en 164164 réputation est une connaissance éloignée, recherchée, mendiée
et que fait faire le plus souvent quelqu’un des domestiques, qu’un auteur
viendra trouver vingt fois pour le prier de parler de lui à sa maîtresse ;
lequel, après avoir été bien importuné, lui en parle avantageusement et lui en
dit du bien jusqu’à ce qu’il lui fasse souhaiter de le voir. Il est enfin (après
avoir bien brigué cette connaissance) introduit dans sa ruelle, où il lit sa pièce en présence
de trois ou quatre amies, d’où s’ensuit tout ce que j’ai déjà dit, à quoi l’on
peut ajouter que les galants de ces dames, sans en avoir rien vu, publient sur leur
rapport que c’est la plus belle chose du monde. Les amis
de ces galants le disent aussi pour les obliger, et voilà ce qui met pré-165165sentement les auteurs au monde. Voilà d’où vient que l’on en voit qui
sont en grande réputation après leur coup d’essai La
critique est cinglante : ce n’est plus la qualité du coup d’essai qui
fait la valeur de l’auteur, comme le voudrait une éthique de l’audace
énoncée depuis le Cid (« Mes pareils à deux fois ne se
font point connaître / Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de
maître », acte II, scène 2), mais bien la maîtrise des codes sociaux et
des techniques publicitaires visant les femmes., cependant
que d’autres, vieillis dans l’étude, après avoir fait cent beaux ouvrages, ne
sont ni connus ni estimés, faute d’avoir eu connaissance de ces femmes qui
donnent la vogue à de certains auteurs et qui font réussir tout ce qui part
d’eux.
La
critique est cinglante : ce n’est plus la qualité du coup d’essai qui
fait la valeur de l’auteur, comme le voudrait une éthique de l’audace
énoncée depuis le Cid (« Mes pareils à deux fois ne se
font point connaître / Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de
maître », acte II, scène 2), mais bien la maîtrise des codes sociaux et
des techniques publicitaires visant les femmes., cependant
que d’autres, vieillis dans l’étude, après avoir fait cent beaux ouvrages, ne
sont ni connus ni estimés, faute d’avoir eu connaissance de ces femmes qui
donnent la vogue à de certains auteurs et qui font réussir tout ce qui part
d’eux.
— Il est donc vrai, repartit Straton, que les femmes sont utiles et qu’elles doivent avoir beaucoup d’esprit, puisque l’on s’en rapporte à leur sentiment et que c’est d’elles que dépend la réputation des personnes les plus spirituelles.
— C’est une vérité, répondit Ariste, et si l’on n’a leur approbation Il s’agit d’une conviction très ferme chez Donneau de Visé :
« [C]omme ce sont [les femmes] qui font réussir les ouvrages, ceux qui
ne trouveront point le secret de leur plaire, ne réussiront jamais »
(Extraordinaire du Mercure Galant, t. IV, 1673, p. 266), on a beau travailler et se donner de la peine,
on ne réussira jamais
Il s’agit d’une conviction très ferme chez Donneau de Visé :
« [C]omme ce sont [les femmes] qui font réussir les ouvrages, ceux qui
ne trouveront point le secret de leur plaire, ne réussiront jamais »
(Extraordinaire du Mercure Galant, t. IV, 1673, p. 266), on a beau travailler et se donner de la peine,
on ne réussira jamais Même constat dans La
Précieuse de Pure : « Hé quoi, disait-il, il faudra qu'un homme qui a
consommé sa vie à étudier les belles choses, et à pénétrer jusqu'au fond
de leur mérite, n'ait de réputation que sur l'approbation d'une dame ou
d'une demoiselle ». A la fin des années 1650, une lettre de
Brébeuf formulait également un constat similaire : « Vous savez ce
que Monsieur de Corneille nous en a dit [de La Pharsale].
Encore qu’il ne désapprouve pas entièrement cette pièce, j’avoue avec
lui que […] les dames qui font faire le débit des livres nouveaux
courent après les romans et les choses plaisantes ; et ne pouvant pas
se résoudre à lire les sérieuses, elles ne soucieront guères de voir
les démêlés de César et de Pompée » .
Même constat dans La
Précieuse de Pure : « Hé quoi, disait-il, il faudra qu'un homme qui a
consommé sa vie à étudier les belles choses, et à pénétrer jusqu'au fond
de leur mérite, n'ait de réputation que sur l'approbation d'une dame ou
d'une demoiselle ». A la fin des années 1650, une lettre de
Brébeuf formulait également un constat similaire : « Vous savez ce
que Monsieur de Corneille nous en a dit [de La Pharsale].
Encore qu’il ne désapprouve pas entièrement cette pièce, j’avoue avec
lui que […] les dames qui font faire le débit des livres nouveaux
courent après les romans et les choses plaisantes ; et ne pouvant pas
se résoudre à lire les sérieuses, elles ne soucieront guères de voir
les démêlés de César et de Pompée » .
— Ce que vous 166166 dites est véritable, répondit Straton.
Après quoi il dit, en élevant sa voix :
— Ah ! vraiment, j’oubliais de vous dire que le pauvre Mairet est malade et que
l’on dit que c’est le dépit qu’il a de ce qu’on a refait sa Sophonisbe On ne connaît pas directement la réaction de Mairet à la
reprise du sujet par Corneille. Le second prit soin de ménager le
premier dans sa préface, afin de ne provoquer que son véritable adversaire, l’abbé
d’Aubignac (voir l’article de C. Schuwey et A. Vuilleumier). Mairet sera à nouveau évoqué plusieurs fois dans le
passage du t. III consacré à la critique de la Sophonisbe
(p. 244sq.). À noter que les libraires profitèrent
de la reprise pour rééditer à l’identique la Sophonisbe
de Mairet. qui lui cause cette maladie. Celui qui
l’a entrepris devait bien attendre qu’il fût mort, pour ne pas donner à des
enfants, en présence d’un père âgé de quatre-vingt-quinze ans
On ne connaît pas directement la réaction de Mairet à la
reprise du sujet par Corneille. Le second prit soin de ménager le
premier dans sa préface, afin de ne provoquer que son véritable adversaire, l’abbé
d’Aubignac (voir l’article de C. Schuwey et A. Vuilleumier). Mairet sera à nouveau évoqué plusieurs fois dans le
passage du t. III consacré à la critique de la Sophonisbe
(p. 244sq.). À noter que les libraires profitèrent
de la reprise pour rééditer à l’identique la Sophonisbe
de Mairet. qui lui cause cette maladie. Celui qui
l’a entrepris devait bien attendre qu’il fût mort, pour ne pas donner à des
enfants, en présence d’un père âgé de quatre-vingt-quinze ans Contrairement à ce que prétend Donneau, Mairet n’a que
cinquante-neuf ans au moment où paraissent les Nouvelles
Nouvelles. S'agit-il d'une faute d'impression ? On trouve
quoi qu'il en soit un propos semblable dans les Remarques sur la
Sophonisbe de l’abbé d’Aubignac (1663) : « La croyance de
mieux faire que tous les autres ne devait pas soulever Monsieur
Corneille contre un homme mort au théâtre. » (p. 4). La critique de la Sophonisbe insérée plus
loin (p. 244sq.) présente d’autres similarités avec les
discours de d’Aubignac, notamment p. 248, 255, 256 et suivantes.
, la mort qu’il a prétendu leur donner. Je crois toutefois qu’ils
n’en auront que la peur
Contrairement à ce que prétend Donneau, Mairet n’a que
cinquante-neuf ans au moment où paraissent les Nouvelles
Nouvelles. S'agit-il d'une faute d'impression ? On trouve
quoi qu'il en soit un propos semblable dans les Remarques sur la
Sophonisbe de l’abbé d’Aubignac (1663) : « La croyance de
mieux faire que tous les autres ne devait pas soulever Monsieur
Corneille contre un homme mort au théâtre. » (p. 4). La critique de la Sophonisbe insérée plus
loin (p. 244sq.) présente d’autres similarités avec les
discours de d’Aubignac, notamment p. 248, 255, 256 et suivantes.
, la mort qu’il a prétendu leur donner. Je crois toutefois qu’ils
n’en auront que la peur Dans ses remarques sur la
Sophonisbe, d’Aubignac prétend également que la pièce
de Corneille est un échec : « Aussi la justice publique l’a-t-elle vengé
[Mairet] et Monsieur Corneille qui voyait tout le Parnasse au-dessous de
lui a donné sujet de le mettre au-dessous d’un autre auquel on ne
pensait plus […] » (p. 4). . Savez-vous, continua-t-il en riant, que
le livre de ……… n’a pas réussi
Dans ses remarques sur la
Sophonisbe, d’Aubignac prétend également que la pièce
de Corneille est un échec : « Aussi la justice publique l’a-t-elle vengé
[Mairet] et Monsieur Corneille qui voyait tout le Parnasse au-dessous de
lui a donné sujet de le mettre au-dessous d’un autre auquel on ne
pensait plus […] » (p. 4). . Savez-vous, continua-t-il en riant, que
le livre de ……… n’a pas réussi La remarque de Straton
mime la manière dont l’auctorialité est figurée dans les publications
contemporaines (omission partielle ou complète du nom). Les
Nouvelles Nouvelles en sont le parfait exemple,
puisque la page de titre les
attribue à « M. de ……… ». La pratique dérive d’un goût galant du
secret
dont témoigne l’avis au lecteur de Célinte (1661) : « Ne
t’informe point trop curieusement, lecteur, de l’auteur de cette
nouvelle ». La hâte avec laquelle il débite ces informations correspond
au caractère des nouvellistes. ?
Bien des gens en ont été surpris. Pour moi qui connais assez bien les choses et
qui vois d’abord quels effets
elles doivent produire, je l’en avais bien averti et, s’il avait suivi mon
conseil, il s’en se-167167rait bien trouvé. À propos, on dit que notre
cher ami a eu un beau présent de la dédicace de son livre. Le prince que vous
savez n’a rien donné à l’homme que vous connaissez, il en est dans le plus
grand dépit
du monde et proteste qu’il ne
fera plus de ces épîtres liminaires où l’on dit que l’on ne demande rien et que
l’intérêt ne fait point agir. Il a même été sur le point de faire une satire
contre lui, après avoir dit tant de choses à sa gloire. Quelle heure est-il ? Il
faut que je m’en aille. Fûtes-vous hier voir la pièce nouvelle ? Qu’y dit-on ? Y
remarquâtes-vous force partisans ? Y avait-il bien du monde ? Les incidents en
sont-ils beaux ? Combien de fois y applaudit-on ?
La remarque de Straton
mime la manière dont l’auctorialité est figurée dans les publications
contemporaines (omission partielle ou complète du nom). Les
Nouvelles Nouvelles en sont le parfait exemple,
puisque la page de titre les
attribue à « M. de ……… ». La pratique dérive d’un goût galant du
secret
dont témoigne l’avis au lecteur de Célinte (1661) : « Ne
t’informe point trop curieusement, lecteur, de l’auteur de cette
nouvelle ». La hâte avec laquelle il débite ces informations correspond
au caractère des nouvellistes. ?
Bien des gens en ont été surpris. Pour moi qui connais assez bien les choses et
qui vois d’abord quels effets
elles doivent produire, je l’en avais bien averti et, s’il avait suivi mon
conseil, il s’en se-167167rait bien trouvé. À propos, on dit que notre
cher ami a eu un beau présent de la dédicace de son livre. Le prince que vous
savez n’a rien donné à l’homme que vous connaissez, il en est dans le plus
grand dépit
du monde et proteste qu’il ne
fera plus de ces épîtres liminaires où l’on dit que l’on ne demande rien et que
l’intérêt ne fait point agir. Il a même été sur le point de faire une satire
contre lui, après avoir dit tant de choses à sa gloire. Quelle heure est-il ? Il
faut que je m’en aille. Fûtes-vous hier voir la pièce nouvelle ? Qu’y dit-on ? Y
remarquâtes-vous force partisans ? Y avait-il bien du monde ? Les incidents en
sont-ils beaux ? Combien de fois y applaudit-on ?
La pièce que vous savez, dont l’illustre ……… a donné le sujet, est 168168
dans les mains de Madame de ……… ; elle croit qu’elle réussira, mais elle dit qu’il y a quelque chose
d’obscur dans les premiers actes. Je sais comment les rôles sont distribués, et
cela lui pourrait bien faire tort, car il en avait promis un beau à Mademoiselle
………, qui est une très bonne actrice et qui a de grands amis, et toutes les
excuses qu’il en a données sont qu’un grand prince lui a ordonné de les
distribuer de la sorte. C……… a fait une pièce L’initiale
C… renvoie probablement à Corneille, faute d’autres candidats et en
raison du prestige de celui-ci. La pièce en question est peut-être
Sophonisbe, la belle Baronne étant morte en 1662.
Auquel cas, l’indication fournie ici constituerait un témoignage inédit
sur la genèse de cette pièce, par laquelle Corneille aurait envisagé de
concrétiser son retour à la scène en 1659 (à la place
d’Oedipe). Mais il peut aussi s’agir d’une simple
parodie de rumeur que lancerait un nouvelliste comme
Straton. qu’il avait quittée il y a trois ans et dont il avait
fait un acte. Il a été bien surpris de la mort de la belle Baronne
L’initiale
C… renvoie probablement à Corneille, faute d’autres candidats et en
raison du prestige de celui-ci. La pièce en question est peut-être
Sophonisbe, la belle Baronne étant morte en 1662.
Auquel cas, l’indication fournie ici constituerait un témoignage inédit
sur la genèse de cette pièce, par laquelle Corneille aurait envisagé de
concrétiser son retour à la scène en 1659 (à la place
d’Oedipe). Mais il peut aussi s’agir d’une simple
parodie de rumeur que lancerait un nouvelliste comme
Straton. qu’il avait quittée il y a trois ans et dont il avait
fait un acte. Il a été bien surpris de la mort de la belle Baronne Il s’agit de Jeanne Auzoult, actrice de l’Hôtel de Bourgogne
décédée en 1662. , car il n’avait résolu de l’achever que
parce qu’il y avait un rôle plein de tendresse qu’il lui destinait. Je m’en vais, car
j’ai affaire à la ville, vous m’excuserez bien si je vous quitte si tôt.
Il s’agit de Jeanne Auzoult, actrice de l’Hôtel de Bourgogne
décédée en 1662. , car il n’avait résolu de l’achever que
parce qu’il y avait un rôle plein de tendresse qu’il lui destinait. Je m’en vais, car
j’ai affaire à la ville, vous m’excuserez bien si je vous quitte si tôt.
Que c’est 169169 une admirable fille que l’illustre Sapho La notoriété de Madeleine de Scudéry, universellement
reconnaissable derrière le pseudonyme de Sapho, est à son zénith au
début des années 1660. Par-delà le succès de la
Clélie(1656-1660) et la parution récente de
Célinte (1661), sa présence dans le monde des lettres est assurée
par les ouvrages qui lui sont dédiés : La Politique des coquettes
(1660), La Pistole parlante de Samuel Isarn
(1660) et le Louis d’or (1661) du même auteur.
, je ne crois que l’on puisse jamais écrire si délicatement
qu’elle ! Sa Clélie a plu à tout le monde
La notoriété de Madeleine de Scudéry, universellement
reconnaissable derrière le pseudonyme de Sapho, est à son zénith au
début des années 1660. Par-delà le succès de la
Clélie(1656-1660) et la parution récente de
Célinte (1661), sa présence dans le monde des lettres est assurée
par les ouvrages qui lui sont dédiés : La Politique des coquettes
(1660), La Pistole parlante de Samuel Isarn
(1660) et le Louis d’or (1661) du même auteur.
, je ne crois que l’on puisse jamais écrire si délicatement
qu’elle ! Sa Clélie a plu à tout le monde Le dernier tome
de Clélie a paru en 1660, mais l’ouvrage a marqué une
génération de lecteurs et de lectrices. Signe de ce succès, le premier
volume d’une traduction allemande
paraîtra l’année suivante, en 1664., parce qu’elle a si
bien su parler dans ses conversations des choses du temps et qu’elle a si bien
décrit nos mœurs et nos coutumes, ce qui se dit et ce qui se fait dans ce
siècle, que ceux-là mêmes dont elle n’avait pas dessein de parler y ont trouvé
leur portrait. Ce n’est que par là que l’on réussit présentement
Le dernier tome
de Clélie a paru en 1660, mais l’ouvrage a marqué une
génération de lecteurs et de lectrices. Signe de ce succès, le premier
volume d’une traduction allemande
paraîtra l’année suivante, en 1664., parce qu’elle a si
bien su parler dans ses conversations des choses du temps et qu’elle a si bien
décrit nos mœurs et nos coutumes, ce qui se dit et ce qui se fait dans ce
siècle, que ceux-là mêmes dont elle n’avait pas dessein de parler y ont trouvé
leur portrait. Ce n’est que par là que l’on réussit présentement Même observation dans le Chemin de la Fortune (1663) : « D’une façon ou d’autre, pour être assuré de leur
débit, il faut avoir l’adresse de les faire sur des sujets qui aient du
crédit partout et de les écrire d’un style qui soit à la mode » (p. 78). : décrire ce qui se dit et ce qui se fait
tous les jours, et le bien représenter, c’est avoir trouvé l’unique et véritable
moyen de plaire. Il n’y a maintenant que ces tableaux qui soient non seulement
de vente, mais même de grand prix ; l’on n’en achète point d’autres, et le
peintre et le marchand les 170170 vendent ce qu’ils veulent, ce qui
montre que les choses les plus fortes et les plus relevées ne sont plus en
crédit, que l’on n’aime que
les plus communes, bien exprimées, et que l’on ne veut plus rien que de
naturel
Même observation dans le Chemin de la Fortune (1663) : « D’une façon ou d’autre, pour être assuré de leur
débit, il faut avoir l’adresse de les faire sur des sujets qui aient du
crédit partout et de les écrire d’un style qui soit à la mode » (p. 78). : décrire ce qui se dit et ce qui se fait
tous les jours, et le bien représenter, c’est avoir trouvé l’unique et véritable
moyen de plaire. Il n’y a maintenant que ces tableaux qui soient non seulement
de vente, mais même de grand prix ; l’on n’en achète point d’autres, et le
peintre et le marchand les 170170 vendent ce qu’ils veulent, ce qui
montre que les choses les plus fortes et les plus relevées ne sont plus en
crédit, que l’on n’aime que
les plus communes, bien exprimées, et que l’on ne veut plus rien que de
naturel Le naturel compte parmi les
critères d’évaluation de la
littérature mondaine.. Je m’en vais.
Le naturel compte parmi les
critères d’évaluation de la
littérature mondaine.. Je m’en vais.
À propos, je vis, il y a deux ou trois jours La scène qui
suit narre un épisode de récitateur importun, tel qu’incarné
par Mascarille dans
Les Précieuses ridicules et par les nouvellistes tout au long
du tome II des Nouvelles Nouvelles, en particulier par
Straton lui-même au moment où il le raconte. L'aveuglement face à ses
propres défauts et un motif courant de la satire, que Donneau applique
souvent aux nouvellistes. , ……… qui, depuis la porte
Saint-Denis jusqu’au Luxembourg
La scène qui
suit narre un épisode de récitateur importun, tel qu’incarné
par Mascarille dans
Les Précieuses ridicules et par les nouvellistes tout au long
du tome II des Nouvelles Nouvelles, en particulier par
Straton lui-même au moment où il le raconte. L'aveuglement face à ses
propres défauts et un motif courant de la satire, que Donneau applique
souvent aux nouvellistes. , ……… qui, depuis la porte
Saint-Denis jusqu’au Luxembourg Soit du nord au sud de
Paris. La mention des lieux concrets de la capitale est une
caractéristique du style des années 1660 que l’on retrouve
notamment dans l’incipit d’Artémise et Poliante de Boursault. , ne me dit qu’un sonnet, qu’il
me répéta cent fois. Il m’en fit remarquer tous les vers, les uns après les
autres, il me fit voir séparément que tous les mots qui les composaient étaient
choisis, propres et significatifs, et fut si longtemps à me parler de la pointe
Soit du nord au sud de
Paris. La mention des lieux concrets de la capitale est une
caractéristique du style des années 1660 que l’on retrouve
notamment dans l’incipit d’Artémise et Poliante de Boursault. , ne me dit qu’un sonnet, qu’il
me répéta cent fois. Il m’en fit remarquer tous les vers, les uns après les
autres, il me fit voir séparément que tous les mots qui les composaient étaient
choisis, propres et significatifs, et fut si longtemps à me parler de la pointe Au coeur de l’esthétique théâtrale des années 1660, les
pointes et les pensées font l’objet d’un débat
auquel prend part la grande conversation sur le sujet au tome II des Nouvelles
Nouvelles., à l’admirer et à la répéter, que je ne
savais plus quelle posture tenir, ni que lui répondre ; et il dit enfin tant de
bien de lui que, pour lui donner toutes 171171 les louanges imaginables,
je n’avais qu’à lui faire un signe de tête ou tout au plus qu’à lui répondre
souvent oui. Après m’avoir longtemps parlé de ce sonnet, il changea de discours
et m’entretint pendant un quart d’heure d’un mot nouveau qu’il voulait
autoriser
Au coeur de l’esthétique théâtrale des années 1660, les
pointes et les pensées font l’objet d’un débat
auquel prend part la grande conversation sur le sujet au tome II des Nouvelles
Nouvelles., à l’admirer et à la répéter, que je ne
savais plus quelle posture tenir, ni que lui répondre ; et il dit enfin tant de
bien de lui que, pour lui donner toutes 171171 les louanges imaginables,
je n’avais qu’à lui faire un signe de tête ou tout au plus qu’à lui répondre
souvent oui. Après m’avoir longtemps parlé de ce sonnet, il changea de discours
et m’entretint pendant un quart d’heure d’un mot nouveau qu’il voulait
autoriser La remarque reprend les
plaisanteries des Précieuses ridicules ou du
Dictionnaire des précieuses et le sujet sera encore
abordé dans Le Parnasse réformé de
Guéret en 1669. Elle évoque ainsi les débats contemporains sur les
évolutions linguistiques et sur le développement anarchique des
néologismes. et qu’il avait mis dans un livre qu’il allait
faire imprimer. Il me dit toutes les raisons qui le poussaient à s’en servir et
qui l’obligeaient à croire que ce mot serait approuvé, ce qui lui donna lieu
d’entrer dans une profonde admiration de lui-même, d’où il ne sortit que pour
parler encore de son sonnet et pour me dire que je n’en avais pas remarqué
toutes les beautés.
La remarque reprend les
plaisanteries des Précieuses ridicules ou du
Dictionnaire des précieuses et le sujet sera encore
abordé dans Le Parnasse réformé de
Guéret en 1669. Elle évoque ainsi les débats contemporains sur les
évolutions linguistiques et sur le développement anarchique des
néologismes. et qu’il avait mis dans un livre qu’il allait
faire imprimer. Il me dit toutes les raisons qui le poussaient à s’en servir et
qui l’obligeaient à croire que ce mot serait approuvé, ce qui lui donna lieu
d’entrer dans une profonde admiration de lui-même, d’où il ne sortit que pour
parler encore de son sonnet et pour me dire que je n’en avais pas remarqué
toutes les beautés.
— Il y a, dit-il, un sens mystérieux de quoi vous ne vous êtes pas aperçu. Il faut que 172172 je vous le répète. Écoutez.
Il me le récita encore après cela et, lorsqu’il eut achevé, il me voulut faire
voir ce sens mystérieux, qui l’était en effet tellement qu’il n’y avait que
lui qui y pût rien connaître Parmi les critères
d’évaluation de la
littérature mondaine figure au premier rang celui d’être clair et
compréhensible, par opposition au galimatias souvent raillé par Molière.
Dans la « Conversation des pointes ou pensées » du
tome II, Clorante avait critiqué la recherche obsessionnelle de l’effet,
produisant « tant de choses si obscures où l'on ne comprend rien » (p. 113). et qui en pût développer le mystère. Je lui dis par complaisance que je
le trouvais beau.
Parmi les critères
d’évaluation de la
littérature mondaine figure au premier rang celui d’être clair et
compréhensible, par opposition au galimatias souvent raillé par Molière.
Dans la « Conversation des pointes ou pensées » du
tome II, Clorante avait critiqué la recherche obsessionnelle de l’effet,
produisant « tant de choses si obscures où l'on ne comprend rien » (p. 113). et qui en pût développer le mystère. Je lui dis par complaisance que je
le trouvais beau.
— Cela est fin et délicat, me repartit-il, il en faut demeurer d’accord, tout le
monde ne s’en aperçoit pas et il n’y a que les gens d’esprit qui le
puissent connaître Le comportement du récitateur
importun satirise
également une ridicule prétention déjà mise en scène dans La
Précieuse, lorsque Mélanire se disait « l’arbitre de ces
hauts sujets qui sont au-dessus des sens et au-dessus du vulgaire. » (t. I, p. 48). S’il est en effet bon d’être au-dessus du vulgaire, il
est ridicule de prétendre soi-même à cette position.. Je
vais porter la lettre du Parnasse que je vous viens de lire à une dame de
qualité qui me l’a ce matin envoyé demander. Adieu. Il faut avouer que Mademoiselle
D……… écrit bien
Le comportement du récitateur
importun satirise
également une ridicule prétention déjà mise en scène dans La
Précieuse, lorsque Mélanire se disait « l’arbitre de ces
hauts sujets qui sont au-dessus des sens et au-dessus du vulgaire. » (t. I, p. 48). S’il est en effet bon d’être au-dessus du vulgaire, il
est ridicule de prétendre soi-même à cette position.. Je
vais porter la lettre du Parnasse que je vous viens de lire à une dame de
qualité qui me l’a ce matin envoyé demander. Adieu. Il faut avouer que Mademoiselle
D……… écrit bien À l’instar des occurrences aux p. 166 et p.
168, la figuration d’un nom dissimulé ou incomplet mime les pratiques de
connivence qu’affiche la littérature mondaine ainsi que le goût du
secret des nouvellistes. En 1663, Mademoiselle D…. renvoie toutefois de
manière transparente à Marie-Catherine Desjardins, qui a publié
plusieurs pièces en prose et en vers entre 1660 et 1663 et, en
particulier, un recueil de poésies
en 1662. ; ses vers sont partout également forts, et ce
n’est point une marchandise mêlée
À l’instar des occurrences aux p. 166 et p.
168, la figuration d’un nom dissimulé ou incomplet mime les pratiques de
connivence qu’affiche la littérature mondaine ainsi que le goût du
secret des nouvellistes. En 1663, Mademoiselle D…. renvoie toutefois de
manière transparente à Marie-Catherine Desjardins, qui a publié
plusieurs pièces en prose et en vers entre 1660 et 1663 et, en
particulier, un recueil de poésies
en 1662. ; ses vers sont partout également forts, et ce
n’est point une marchandise mêlée Expression péjorative.
Furetière parle ainsi de ses Poésies diverses (1655,
rééditées en 1664) : « […] dans ce siècle malheureux où on achète des
livres selon qu’ils sont gros et pesants si j’eusse fait un livre de la
taille d’un almanach, mon libraire n’y eût pas trouvé son compte […].
J’ai donc été obligé de laisser le son avec la farine et de vider mon
porte-feuille jusques à n’y laisser pas quelques mauvais impromptus
[…].» (Préface) Le recours au terme de marchandise est une métaphore
topique pour parler de littérature dans les années 1660 (voir C.
Schuwey, Un entrepreneur des lettres au XVIIe siècle,
Paris, Classiques Garnier, à paraître).. Si la nouvelle
qui court de-173173puis hier est véritable, la France est en état de
se faire craindre par toute la terre
Expression péjorative.
Furetière parle ainsi de ses Poésies diverses (1655,
rééditées en 1664) : « […] dans ce siècle malheureux où on achète des
livres selon qu’ils sont gros et pesants si j’eusse fait un livre de la
taille d’un almanach, mon libraire n’y eût pas trouvé son compte […].
J’ai donc été obligé de laisser le son avec la farine et de vider mon
porte-feuille jusques à n’y laisser pas quelques mauvais impromptus
[…].» (Préface) Le recours au terme de marchandise est une métaphore
topique pour parler de littérature dans les années 1660 (voir C.
Schuwey, Un entrepreneur des lettres au XVIIe siècle,
Paris, Classiques Garnier, à paraître).. Si la nouvelle
qui court de-173173puis hier est véritable, la France est en état de
se faire craindre par toute la terre Selon toute
vraisemblance, cette remarque ne fait référence à aucun événement
précis, et sert à railler le sensationnalisme ridicule des
nouvellistes..
Selon toute
vraisemblance, cette remarque ne fait référence à aucun événement
précis, et sert à railler le sensationnalisme ridicule des
nouvellistes..
Straton dit toutes ces choses avec tant de précipitation qu’il eut à peine le
loisir de respirer pendant qu’il parla. Et après avoir ainsi joué tout seul
au propos interrompu Le jeu du propos interrompu compte
parmi les jeux de société les plus célèbres, décrit de la
Maison des jeux de Sorel (1642) au Manuel complet des jeux de
société (1836). Conformément aux règles du jeu, la remarque est
ainsi une plaisante manière de dire que Straton fait les questions et
les réponses tout seul, et que ses propos n’ont aucun lien entre
eux., comme il avait fait en arrivant, et avoir fait un si
long discours sans liaison et sans suite, et même sans donner le temps à
personne de lui répondre, et avoir dit plusieurs fois qu’il s’en allait sans
sortir de sa place, il fut un demi-moment sans parler, ce que je crois qu’il ne fit que
pour reprendre haleine, après lequel temps il reprit la parole et dit :
Le jeu du propos interrompu compte
parmi les jeux de société les plus célèbres, décrit de la
Maison des jeux de Sorel (1642) au Manuel complet des jeux de
société (1836). Conformément aux règles du jeu, la remarque est
ainsi une plaisante manière de dire que Straton fait les questions et
les réponses tout seul, et que ses propos n’ont aucun lien entre
eux., comme il avait fait en arrivant, et avoir fait un si
long discours sans liaison et sans suite, et même sans donner le temps à
personne de lui répondre, et avoir dit plusieurs fois qu’il s’en allait sans
sortir de sa place, il fut un demi-moment sans parler, ce que je crois qu’il ne fit que
pour reprendre haleine, après lequel temps il reprit la parole et dit :
— Je me plais si fort ici et l’entretien de la compagnie est si agréable que je ne me puis encore résoudre à m’en aller.
— Vous me per-174174mettrez donc, lui dit Ariste, qui était aussi
bouillant et aussi grand nouvelliste que lui, de parler à mon tour, car je n’ai
presque rien dit depuis que vous êtes entré et, quoi que vous disiez de notre
entretien, vous avez tout seul entretenu la compagnie En
reprenant Straton pour son impertinent babil, Ariste se ridiculise
également, étant lui aussi grand parleur. L’aveuglement par rapport à
ses propres défauts est un lieu commun de la satire des années
1650-1660 tel qu’exprimé par Furetière dans ses Poésies
diverses : « Il m’est arrivé qu’ayant lu par plaisir une des
pièces à un de ceux qui y était le plus naïvement dépeint, au lieu de
s’y reconnaître, il s’écria aussitôt voilà Monsieur *** qui était un
autre homme que je ne connaissais point et qui avait fait une pareille
sottise. » (Épître dédicatoire, 1655)..
En
reprenant Straton pour son impertinent babil, Ariste se ridiculise
également, étant lui aussi grand parleur. L’aveuglement par rapport à
ses propres défauts est un lieu commun de la satire des années
1650-1660 tel qu’exprimé par Furetière dans ses Poésies
diverses : « Il m’est arrivé qu’ayant lu par plaisir une des
pièces à un de ceux qui y était le plus naïvement dépeint, au lieu de
s’y reconnaître, il s’écria aussitôt voilà Monsieur *** qui était un
autre homme que je ne connaissais point et qui avait fait une pareille
sottise. » (Épître dédicatoire, 1655)..
— Je consens très volontiers que vous parliez, lui répondit Straton.
Après cela, il parla encore un quart d’heure, sans donner le temps à Ariste de dire une seule parole. Il dit ensuite, en s’adressant au même :
— Si vous vouliez venir demain chez moi, je vous montrerais Autre caractéristique des nouvellistes, celle de faire des
secrets de tout et de susciter ainsi la curiosité. Le motif paraît dans
le New Cry de Ben Jonson (1623), source de la satire des
nouvellistes : « And talk reserv'd, lock'd up, and full of fear; / Nay,
ask you how the day goes, in your ear ». …
Autre caractéristique des nouvellistes, celle de faire des
secrets de tout et de susciter ainsi la curiosité. Le motif paraît dans
le New Cry de Ben Jonson (1623), source de la satire des
nouvellistes : « And talk reserv'd, lock'd up, and full of fear; / Nay,
ask you how the day goes, in your ear ». …
Ariste lui demanda aussitôt :
— Est-ce quelque chose…
— Oui, oui, interrompit Straton en souriant, en remuant la tête, en grimaçant et en faisant toutes les actions d’un homme qui s’applaudit, c’est quelque chose qui sera… je ne 175175 dis rien… nous ferons voir que… et je veux… l’on dira peut-être alors… oui, oui, l’on parlera de nous, et ceux qui disent que je… mais patience… elle sera bientôt achevée d’imprimer et jusqu’à ce temps…
— Enfin, interrompit Ariste, qui perdait patience, tout ce discours veut dire que jusques à ce temps vous passerez pour un homme dont on ne connaît pas tout l’esprit, mais qu’alors l’on vous estimera et que l’on parlera de vous.
— Vous avez deviné, lui répondit Straton en riant, car, entre nous, c’est
la plus belle chose du monde En parlant immodestement de
son propre ouvrage, Straton fait glisser le propos de la satire de
nouvelliste à la satire d’auteur telle que l’incarnera le Lycidas de
La Critique de l’École des femmes. Par ailleurs, son
discours mime les différents types de discours promotionnels que l’on
retrouve dans les paratextes. . J’aurais mauvaise grâce de
le dire à d’autres, mais je crois devoir ce témoignage à la vérité et à un ami
si cher que vous. Je me suis surpassé moi-même, je ne sais où j’ai pris tout ce
que j’ai 176176 dit, il y a des endroits qui me surprennent et qui
m’étonnent. J’en ai ajouté
En parlant immodestement de
son propre ouvrage, Straton fait glisser le propos de la satire de
nouvelliste à la satire d’auteur telle que l’incarnera le Lycidas de
La Critique de l’École des femmes. Par ailleurs, son
discours mime les différents types de discours promotionnels que l’on
retrouve dans les paratextes. . J’aurais mauvaise grâce de
le dire à d’autres, mais je crois devoir ce témoignage à la vérité et à un ami
si cher que vous. Je me suis surpassé moi-même, je ne sais où j’ai pris tout ce
que j’ai 176176 dit, il y a des endroits qui me surprennent et qui
m’étonnent. J’en ai ajouté L’amplification d’un ouvrage ou l’ajout de pièces est une
pratique courante, notamment dans les années 1660. Elle explique le
succès éditorial que rencontre le modèle du recueil (voir C. Schuwey,
Un Entrepreneur des lettres au XVIIe siècle, Paris,
Classique Garnier, « Aux enseignes de papier : les recueils comme
plateformes de publication » et M. Speyer, Briller par la diversité : les
recueils collectifs de poésies au XVIIe siècle, thèse
soutenue le 10 avril 2019 à l’Université de Caen)., depuis
que j’ai achevé cet ouvrage, qu’on ne pourra s’empêcher d’estimer. Il faut
avouer qu’il vient bien des choses, en travaillant, à quoi l’on ne s’attend pas.
À votre avis, quel prix y ferai-je mettre
L’amplification d’un ouvrage ou l’ajout de pièces est une
pratique courante, notamment dans les années 1660. Elle explique le
succès éditorial que rencontre le modèle du recueil (voir C. Schuwey,
Un Entrepreneur des lettres au XVIIe siècle, Paris,
Classique Garnier, « Aux enseignes de papier : les recueils comme
plateformes de publication » et M. Speyer, Briller par la diversité : les
recueils collectifs de poésies au XVIIe siècle, thèse
soutenue le 10 avril 2019 à l’Université de Caen)., depuis
que j’ai achevé cet ouvrage, qu’on ne pourra s’empêcher d’estimer. Il faut
avouer qu’il vient bien des choses, en travaillant, à quoi l’on ne s’attend pas.
À votre avis, quel prix y ferai-je mettre En mentionnant
le prix de son livre, Straton l’inscrit dans une logique marchande et
apparaît ainsi comme un fâcheux auteur. À noter que,
jusqu’à la fin du siècle, il est très rare de trouver le prix d’un livre
imprimé, même dans les catalogues de libraires. En 1678, le
Mercure galant sera le premier livre à annoncer un
prix fixe (10 sols en blanc, 15 sols en veau et 1 livre en maroquin).
? On dit que les gens de qualité croient que ce qui n’est pas
cher n’est pas bon. Cet ouvrage doit bien faire du bruit dans toutes les
provinces et dans tous les pays étrangers. Le titre doit bien surprendre et je
ne le veux point dire jusqu’à ce que le livre soit en vente. Je ne puis sortir
de mon étonnement, lorsque
je le relis, et je m’imagine que c’est un songe. Les incidents y naissent
naturellement
En mentionnant
le prix de son livre, Straton l’inscrit dans une logique marchande et
apparaît ainsi comme un fâcheux auteur. À noter que,
jusqu’à la fin du siècle, il est très rare de trouver le prix d’un livre
imprimé, même dans les catalogues de libraires. En 1678, le
Mercure galant sera le premier livre à annoncer un
prix fixe (10 sols en blanc, 15 sols en veau et 1 livre en maroquin).
? On dit que les gens de qualité croient que ce qui n’est pas
cher n’est pas bon. Cet ouvrage doit bien faire du bruit dans toutes les
provinces et dans tous les pays étrangers. Le titre doit bien surprendre et je
ne le veux point dire jusqu’à ce que le livre soit en vente. Je ne puis sortir
de mon étonnement, lorsque
je le relis, et je m’imagine que c’est un songe. Les incidents y naissent
naturellement La remarque est plus probablement
inspirée d’Aristote que des théories contemporaines sur la fiction narrative
(on ne trouve pas de théorie correspondante dans les textes retenus par
C. Esmein, Poétiques du roman, Paris, Champion, 2004).
Elle est probablement reprise de plusieurs passages de la
Pratique du théâtre de d’Aubignac, notamment sur les
sujets pleins d’incidents, la préparation, et la liaison. Straton s’affirme ici en auteur pédant,
obsédé par les critères savants de la composition dramatique.
, ils sont préparés sans être prévus, l’un produit l’au-177177tre sans qu’il y ait rien de forcé, il y a dans tout l’ouvrage des
délicatesses, des endroits si bien touchés, des mignardises, du fin, du
délicat, du brillant, du pompeux, du galant, du tendre, du fort, de
l’enjoué, de ce je-ne-sais-quoi qui plaît et qui charme, de ces choses du temps
sans lesquelles on ne peut plus réussir
La remarque est plus probablement
inspirée d’Aristote que des théories contemporaines sur la fiction narrative
(on ne trouve pas de théorie correspondante dans les textes retenus par
C. Esmein, Poétiques du roman, Paris, Champion, 2004).
Elle est probablement reprise de plusieurs passages de la
Pratique du théâtre de d’Aubignac, notamment sur les
sujets pleins d’incidents, la préparation, et la liaison. Straton s’affirme ici en auteur pédant,
obsédé par les critères savants de la composition dramatique.
, ils sont préparés sans être prévus, l’un produit l’au-177177tre sans qu’il y ait rien de forcé, il y a dans tout l’ouvrage des
délicatesses, des endroits si bien touchés, des mignardises, du fin, du
délicat, du brillant, du pompeux, du galant, du tendre, du fort, de
l’enjoué, de ce je-ne-sais-quoi qui plaît et qui charme, de ces choses du temps
sans lesquelles on ne peut plus réussir La liste des
qualités qui précède comprend à peu près tout ce qui peut être dit sur
un ouvrage. Straton se décrit donc comme un auteur absolu, possédant
toutes les qualités possibles. Le nombre d’adjectifs évoque par ailleurs
la diversité de son ouvrage, qualité centrale pour toute littérature à
la mode. Enfin, le rapport aux choses du temps correspond à la vision de
la littérature qui s’impose à partir de la seconde moitié du siècle
(voir C. Schuwey, Un entrepreneur des lettres, Paris,
Classiques Garnier, 2020).. Tout y paraît plein de
feu, l’on y remarque beaucoup de génie et tout est enfin écrit naturellement, bien
que tout y paraisse noble et hardi, et que l’expression en soit belle, délicate
et forte tout ensemble.
La liste des
qualités qui précède comprend à peu près tout ce qui peut être dit sur
un ouvrage. Straton se décrit donc comme un auteur absolu, possédant
toutes les qualités possibles. Le nombre d’adjectifs évoque par ailleurs
la diversité de son ouvrage, qualité centrale pour toute littérature à
la mode. Enfin, le rapport aux choses du temps correspond à la vision de
la littérature qui s’impose à partir de la seconde moitié du siècle
(voir C. Schuwey, Un entrepreneur des lettres, Paris,
Classiques Garnier, 2020).. Tout y paraît plein de
feu, l’on y remarque beaucoup de génie et tout est enfin écrit naturellement, bien
que tout y paraisse noble et hardi, et que l’expression en soit belle, délicate
et forte tout ensemble.
Si ce livre, continua-t-il, ne plaît à tout le monde La
diversité apparaît ici comme une technique commerciale permettant de
satisfaire à tous les goûts du siècle. En 1672, le premier numéro du
Mercure galant s’ouvrira sur la phrase suivante : « Ce
livre doit avoir de quoi plaire à tout le monde, à cause de la diversité
des matières dont il est rempli » (préface). , il faut, depuis un mois qu’il est sous la
presse, que le goût du siècle ait changé
La
diversité apparaît ici comme une technique commerciale permettant de
satisfaire à tous les goûts du siècle. En 1672, le premier numéro du
Mercure galant s’ouvrira sur la phrase suivante : « Ce
livre doit avoir de quoi plaire à tout le monde, à cause de la diversité
des matières dont il est rempli » (préface). , il faut, depuis un mois qu’il est sous la
presse, que le goût du siècle ait changé Par-delà la
dimension parodique de la situation, le règne de la mode en littérature
et le relativisme culturel qu’elle entraîne sont des réalités qui font
l’objet d’une observation récurrente. Ainsi Brébeuf se plaint que les
dames « ne soucieront guère de voir les démêlés de César et de
Pompée » parce que le « le burlesque a dépravé le goût de tout Paris
» (Lettres), Chapelain reconnaît que « notre nation a changé de goût
pour les lectures et, au lieu des romans, qui sont tombés avec La
Calprenède, les voyages sont venus en crédit et tiennent le haut bout
dans la Cour et la Ville » (15 décembre 1663) et, en 1671, Sorel reconnaît qu’« il y a une mode pour les
livres comme pour les autres choses » (p. 11). et, comme il y a des endroits qui sont du
temps, il faut qu’ils aient tout le malheur ima-178178ginable s’ils ne charment
tous ceux qui les liront.
Par-delà la
dimension parodique de la situation, le règne de la mode en littérature
et le relativisme culturel qu’elle entraîne sont des réalités qui font
l’objet d’une observation récurrente. Ainsi Brébeuf se plaint que les
dames « ne soucieront guère de voir les démêlés de César et de
Pompée » parce que le « le burlesque a dépravé le goût de tout Paris
» (Lettres), Chapelain reconnaît que « notre nation a changé de goût
pour les lectures et, au lieu des romans, qui sont tombés avec La
Calprenède, les voyages sont venus en crédit et tiennent le haut bout
dans la Cour et la Ville » (15 décembre 1663) et, en 1671, Sorel reconnaît qu’« il y a une mode pour les
livres comme pour les autres choses » (p. 11). et, comme il y a des endroits qui sont du
temps, il faut qu’ils aient tout le malheur ima-178178ginable s’ils ne charment
tous ceux qui les liront.
Si cet ouvrage était d’un de ces auteurs Cette remarque
inaugure un débat sur le rôle de la préoccupation comme critère
fondamental de fonctionnement du marché littéraire. La réflexion
paraîtra à nouveau à propos de Molière (voir notamment p. 212). En 1671
Charles Sorel en reprendra des éléments de cette critique dans le
premier chapitre de son traité De la connaissance des bons
livres. qui sont aussi célèbres par l’estime et par
la vénération que l’habitude fait avoir pour eux et pour leur nom que par le
mérite de leurs ouvrages, et dont on loue les productions avant que de les
avoir vues
Cette remarque
inaugure un débat sur le rôle de la préoccupation comme critère
fondamental de fonctionnement du marché littéraire. La réflexion
paraîtra à nouveau à propos de Molière (voir notamment p. 212). En 1671
Charles Sorel en reprendra des éléments de cette critique dans le
premier chapitre de son traité De la connaissance des bons
livres. qui sont aussi célèbres par l’estime et par
la vénération que l’habitude fait avoir pour eux et pour leur nom que par le
mérite de leurs ouvrages, et dont on loue les productions avant que de les
avoir vues À noter que Donneau de Visé en tirera lui-même
parti en 1673. Grâce à un avis inséré dans la Gazette d’Amsterdam du 13 janvier 1673, il fera courir le bruit que sa nouvelle
comédie des Maris infidèles est en fait de Molière, pour
attirer ainsi plus de spectateurs. et que de savoir si
elles méritent les louanges que l’on leur donne, mon livre serait le plus beau
du monde, il l’emporterait sur tout ce que nous voyons d’ouvrages approuvés,
l’on y découvrirait chaque jour des mystères nouveaux, on louerait avec
emportement de certains endroits
À noter que Donneau de Visé en tirera lui-même
parti en 1673. Grâce à un avis inséré dans la Gazette d’Amsterdam du 13 janvier 1673, il fera courir le bruit que sa nouvelle
comédie des Maris infidèles est en fait de Molière, pour
attirer ainsi plus de spectateurs. et que de savoir si
elles méritent les louanges que l’on leur donne, mon livre serait le plus beau
du monde, il l’emporterait sur tout ce que nous voyons d’ouvrages approuvés,
l’on y découvrirait chaque jour des mystères nouveaux, on louerait avec
emportement de certains endroits Ces exclamations
correspondent aux pratiques mondaines de consommation de la
littérature., ils seraient dans la bouche de tout le monde et
suffiraient pour rendre un auteur immortel.
Ces exclamations
correspondent aux pratiques mondaines de consommation de la
littérature., ils seraient dans la bouche de tout le monde et
suffiraient pour rendre un auteur immortel.
C’est une étrange chose que
la préoccupation, a-179179jouta-t-il. J’espère toutefois de
m’établir une réputation si forte et si puissante Même
idée en 1671 dans De la connaissance des bons livres de
Charles Sorel, p. 19sq.. que je n’aurai plus besoin que de mon nom
pour faire réussir tout ce que je ferai. Je n’épargnerai rien pour en venir à
bout. J’ai trouvé le moyen de connaître quantité de femmes qui dans toutes
les belles ruelles
disent du bien de moi et de mes ouvrages, même avant que je leur montre, et
j’espère dans peu faire connaissance avec quelques-uns de ces galants
abbés
Même
idée en 1671 dans De la connaissance des bons livres de
Charles Sorel, p. 19sq.. que je n’aurai plus besoin que de mon nom
pour faire réussir tout ce que je ferai. Je n’épargnerai rien pour en venir à
bout. J’ai trouvé le moyen de connaître quantité de femmes qui dans toutes
les belles ruelles
disent du bien de moi et de mes ouvrages, même avant que je leur montre, et
j’espère dans peu faire connaissance avec quelques-uns de ces galants
abbés Les abbés de cour, qui ne
sont pas nécessairement des ecclésiastiques, constituent en effet des
protagonistes importants du champ littéraire. qui, après
les femmes, donnent le branle à la réputation et qui, dans les belles
compagnies, ont séance comme juges de tout ce qui se fait de nouveau et qui
peuvent, avec les femmes, donner un arrêt pour la ruine entière ou pour la réussite d’un
livre. Quand j’aurai ac-180180quis, par quelques civilités et par quelque
déférence pour leurs sentiments,
l’estime de ces belles et de ces messieurs, l’on dira, avant que mes
ouvrages soient sous la presse
Les abbés de cour, qui ne
sont pas nécessairement des ecclésiastiques, constituent en effet des
protagonistes importants du champ littéraire. qui, après
les femmes, donnent le branle à la réputation et qui, dans les belles
compagnies, ont séance comme juges de tout ce qui se fait de nouveau et qui
peuvent, avec les femmes, donner un arrêt pour la ruine entière ou pour la réussite d’un
livre. Quand j’aurai ac-180180quis, par quelques civilités et par quelque
déférence pour leurs sentiments,
l’estime de ces belles et de ces messieurs, l’on dira, avant que mes
ouvrages soient sous la presse Dans De la
connaissance des bons livres en 1671, Sorel notera : « Les
auteurs qui recherchent la gloire et le crédit doivent être des gens qui
s’introduisent dans toute sorte de compagnies, et qui parlant à chacun
de leurs ouvrages, les fassent désirer longtemps avant qu’on les voie. »
(p. 18)., que ce sont les plus belles choses du
monde, et l’on dira que j’aurai pensé à des choses à quoi je n’aurai jamais
songé. Mes partisans feront admirer à quantité de personnes des choses qu’elles
n’auront jamais vues. Ces personnes, préoccupées par leurs discours, pousseront des hélas
sans savoir pourquoi
Dans De la
connaissance des bons livres en 1671, Sorel notera : « Les
auteurs qui recherchent la gloire et le crédit doivent être des gens qui
s’introduisent dans toute sorte de compagnies, et qui parlant à chacun
de leurs ouvrages, les fassent désirer longtemps avant qu’on les voie. »
(p. 18)., que ce sont les plus belles choses du
monde, et l’on dira que j’aurai pensé à des choses à quoi je n’aurai jamais
songé. Mes partisans feront admirer à quantité de personnes des choses qu’elles
n’auront jamais vues. Ces personnes, préoccupées par leurs discours, pousseront des hélas
sans savoir pourquoi Ces exclamations correspondent aux
pratiques mondaines de consommation de la littérature. et donneront, dans toutes les assemblées où
elles se trouveront, des louanges à ce qu’elles ne connaîtront point. Quand
j’aurai une fois fait des partisans et que mon nom sera connu et estimé dans les
compagnies galantes,
je m’endormirai sur ma ré-181181putation et, quand je ferai alors
les plus méchantes choses du monde, je suis assuré que mes ouvrages
seront toujours estimés et qu’ils n’auront plus besoin que de mon nom pour
réussir
Ces exclamations correspondent aux
pratiques mondaines de consommation de la littérature. et donneront, dans toutes les assemblées où
elles se trouveront, des louanges à ce qu’elles ne connaîtront point. Quand
j’aurai une fois fait des partisans et que mon nom sera connu et estimé dans les
compagnies galantes,
je m’endormirai sur ma ré-181181putation et, quand je ferai alors
les plus méchantes choses du monde, je suis assuré que mes ouvrages
seront toujours estimés et qu’ils n’auront plus besoin que de mon nom pour
réussir Dans les années 1650, le libraire Sercy avait
utilisé la réputation d’auteurs en vogue pour faire réussir ses recueils
de Poésies choisies. Sur la page de titre, figurait par exemple le nom de
Corneille alors même qu’aucune pièce du dramaturge n’apparaissait dans
l’ouvrage. Voir Miriam Speyer, Les Recueils collectifs de
poésies au XVIIe siècle (1597-1671), thèse soutenue 10
avril 2019, Université de Caen). .
Dans les années 1650, le libraire Sercy avait
utilisé la réputation d’auteurs en vogue pour faire réussir ses recueils
de Poésies choisies. Sur la page de titre, figurait par exemple le nom de
Corneille alors même qu’aucune pièce du dramaturge n’apparaissait dans
l’ouvrage. Voir Miriam Speyer, Les Recueils collectifs de
poésies au XVIIe siècle (1597-1671), thèse soutenue 10
avril 2019, Université de Caen). .
— Vous me permettrez, Monsieur, lui répliquai-je (après lui avoir dit que je n’entendais pas parler à lui, quoique ce fût mon dessein, et que son mérite était connu de tout le monde), de vous dire qu’il n’y a que les jeunes auteurs et les ignorants qui se persuadent qu’il n’y a que le nom de ceux qui ont su acquérir de la réputation par quelques heureux ouvrages qu’ils ont faits autrefois, qui fasse réussir tout ce qu’ils font journellement. Il faut croire qu’il y a du mérite et que mille et mille personnes qui approuvent ce qui 182182 part de leur plume ne sont pas si aveuglées que d’estimer une chose seulement par le nom de celui qui l’a faite. Cependant, ces petits messieurs qui, sans être auteurs, croient en avoir la qualité, ou plutôt qui le sont sans en avoir le mérite, se persuadent qu’il n’y a que la préoccupation que l’on a pour un nom connu qui fasse réussir les ouvrages et ont bien l’audace de dire, ou du moins de faire pressentir, en comparant les leurs à ceux de ces grands hommes, que s’ils étaient soutenus d’un nom fameux, ils feraient peut-être plus de bruit que tout ce que l’on a jamais vu de plus beau et de plus achevé.
— Je sais, me répondit Straton, qu’il y a des auteurs assez
impertinents pour se
donner cette vanité, mais je suis prêt de soutenir devant 183183 toute la
terre que la préoccupation que l’on a pour un nom fait toujours réussir les
ouvrages de ceux qui le portent, beaucoup plus qu’ils ne réussiraient si
l’on croyait que d’autres en fussent auteurs Même idée dans
De la connaissance des bons livres (1671) : « Nous
avons vu des ouvrages qui ont eu peu de crédit lorsqu’ils n’ont porté
qu’un nom nom obscur, lesquels ont été fort recherchés depuis qu’ils ont
été illustrés par les nouvelles qualités des auteurs. » (p. 20). . Cette préoccupation est un torrent qui
entraîne les applaudissements avec une rapidité presque incroyable. L’on
n’oserait ouvrir la bouche qu’elle ne soit aussitôt fermée par des personnes qui traitent
d’ignorants et de stupides ceux qui veulent parler, en leur disant, pour toutes
raisons : "Cet ouvrage est d’un tel", ou "Ne savez-vous pas que cet ouvrage est
d’un tel auteur ?" La personne qui a été ainsi traitée croit que c’est un grand
crime que de ne pas approuver ce que fait un tel et dit à ceux qui lui en disent
du mal la même chose que l’on lui 184184 a dite. Ceux-là en disent autant
aux autres et, par un bonheur si grand qu’il ne se peut presque imaginer,
il n’est pas permis d’examiner ce que font ceux dont la préoccupation que l’on a pour eux fait
réussir les ouvrages. Quelques fautes qu’ils puissent commettre, leur nom les
met à l’abri de la plus juste critique et, bien que ce que l’on dit contre eux
soit souvent vrai, il ne laisse pas que de passer pour des effets de l’envie, et les
plus habiles
ne peuvent faire connaître leurs défauts sans se faire railler et sans passer pour
injustes, pour médisants et pour envieux.
Même idée dans
De la connaissance des bons livres (1671) : « Nous
avons vu des ouvrages qui ont eu peu de crédit lorsqu’ils n’ont porté
qu’un nom nom obscur, lesquels ont été fort recherchés depuis qu’ils ont
été illustrés par les nouvelles qualités des auteurs. » (p. 20). . Cette préoccupation est un torrent qui
entraîne les applaudissements avec une rapidité presque incroyable. L’on
n’oserait ouvrir la bouche qu’elle ne soit aussitôt fermée par des personnes qui traitent
d’ignorants et de stupides ceux qui veulent parler, en leur disant, pour toutes
raisons : "Cet ouvrage est d’un tel", ou "Ne savez-vous pas que cet ouvrage est
d’un tel auteur ?" La personne qui a été ainsi traitée croit que c’est un grand
crime que de ne pas approuver ce que fait un tel et dit à ceux qui lui en disent
du mal la même chose que l’on lui 184184 a dite. Ceux-là en disent autant
aux autres et, par un bonheur si grand qu’il ne se peut presque imaginer,
il n’est pas permis d’examiner ce que font ceux dont la préoccupation que l’on a pour eux fait
réussir les ouvrages. Quelques fautes qu’ils puissent commettre, leur nom les
met à l’abri de la plus juste critique et, bien que ce que l’on dit contre eux
soit souvent vrai, il ne laisse pas que de passer pour des effets de l’envie, et les
plus habiles
ne peuvent faire connaître leurs défauts sans se faire railler et sans passer pour
injustes, pour médisants et pour envieux.
Quand il eut cessé de parler, Ariste prit la parole et dit :
— Pour vous montrer que tout ce que Straton vient de dire de la préoccupation que l’on a pour un nom fameux est 185185 véritable, je me trouvai il y a quatre ou cinq jours à la comédie d’un de ces auteurs dont la réputation n’est établie que par la force. J’étais sur le théâtre, auprès d’un jeune homme qui paraissait de qualité. Comme l’on cause quelquefois avec ceux auprès desquels on se rencontre, et que l’on se dit souvent son sentiment les uns aux autres, il me dit que la pièce ne lui plaisait pas et qu’il n’y trouvait rien de bon.
— Comment, Monsieur, lui repartis-je, cette pièce est pourtant de Corneille.
Ce discours le fit rougir et il crut avoir fait une faute qui le devait faire railler de tout le monde, de n’avoir point loué une pièce de Corneille, encore bien qu’il ne l’estimât point.
— Je ne dis pas, me répondit-il, que je la trouve entièrement méchante ; il y a des endroits 186186 inimitables et qui ne peuvent partir que d’un Corneille.
Un demi quart d’heure après, je lui dis qu’elle n’était pas de Corneille et que l’on m’en venait d’assurer.
— Eh bien ! me dit-il en souriant, n’avais-je pas raison de ne la pas trouver bonne ? Et si j’ai trouvé beaux quelques endroits, c’est que l’acteur les a si bien récités qu’il a su me contraindre malgré moi à donner des applaudissements à l’auteur qui n’étaient pas dus à lui seul.
Quelques moments après, je lui dis qu’une autre personne venait de m’assurer qu’elle était de Corneille.
— Ah, que je le connaissais bien ! me repartit-il ; tout ce que je disais n’était que pour savoir votre sentiment.
— Nous en allons être éclaircis, lui dis-je, et je vais présentement der-187187rière le théâtre le demander aux comédiens.
Je revins un moment après et je lui dis qu’elle n’était pas de Corneille.
— Je l’ai toujours cru, me dit-il, et vous avez vu que je vous ai d’abord dit mon sentiment.
Comme nous en étions sur « elle est de Corneille, elle n’en est pas », ce qui voulait dire « elle est bonne si elle est de lui, elle est méchante si elle est d’un autre », un jeune étourdi qui était derrière nous tira celui avec qui je parlais et lui dit :
— Morbleu, voilà une belle pièce ! Elle est assurément de Corneille, car j’y viens de remarquer un vers de sa façon. Il faut avouer que c’est un grand homme, que pour les pièces de théâtre aucun ne saurait disputer avec lui et qu’il est si haut qu’il est même au-dessus de l’envie.
La pièce finit peu de temps après que cet ignorant lui 188188 eut donné tant d’applaudissements parce qu’il y avait remarqué un vers qu’il avait cru de la manière de Corneille, et ces deux messieurs, ayant su de la plupart de tous ceux qui étaient sur le théâtre, et même de tous les comédiens, que la pièce n’était point de Corneille, la condamnèrent entièrement et ne pardonnèrent pas même aux endroits qu’ils avaient admirés.
— Quoi ! leur dis-je, m’étant encore rencontré auprès d’eux sur le théâtre, après que tout le monde se fut levé, devez-vous ainsi faire injustice à un pauvre auteur qui a fait une bonne pièce, parce que l’on ne vous l’a pas donnée sous le nom de Corneille ? Tant que vous avez cru qu’elle était de ce maître du théâtre, vous l’avez admirée, 189189 et présentement que vous savez qu’elle n’en est pas, vous dites que c’est la plus méchante chose du monde. Cependant elle est toujours la même qu’elle était et, quoique l’on vous ait dit qu’elle n’est pas de Corneille, elle n’a pour cela rien perdu de ses beautés.
Ah ! je vois bien, continuai-je, et c’est une vérité dont je commence à ne plus
douter, que lorsqu’un auteur s’est une fois acquis de la réputation, son nom
fait du moins autant de chefs-d’œuvre que lui. L’on regarde tout ce qui part de
sa plume au travers de l’éclat de ce même nom A la suite
du retrait provisoire de Corneille du théâtre dans les années 1650, son
nom avait acquis une aura particulière : prestigieuse, mais à laquelle
l’on mesurait désormais ses nouvelles productions. Le discours sur la
Sophonisbe ci-dessous en est l’exemple. Voir M.
Escola, « Au nom de Corneille. L’auteur comme genre », Littératures classiques, no 89, 2016, p.
55-72., et cet éclat, préoccupant les esprits, les aveuglant et les empêchant
de blâmer tout ce qui sort de l’esprit d’une personne si célèbre, fait que l’on
fouille, pour ainsi dire, jusques 190190 au fond de ses ouvrages pour y
reconnaître l’art et pour y découvrir des beautés que l’on y veut absolument
trouver (n’y en eût-il point) et que l’on assure ne se pouvoir rencontrer dans ce
que font les autres. Les plus méchants endroits de leurs pièces, et qui sont généralement
reconnus pour tels, sont pris pour des marques de l’adresse de leur esprit et de
leur prudence consommée,
et ils ne les y ont mis (à ce que disent les aveugles adorateurs d’un nom) que
pour donner de l’éclat aux autres, bien qu’ils n’aient jamais eu ce dessein.
S’ils font des fautes qui soient inexcusables, que l’on cherche tant que l’on
voudra (disent les mêmes), l’on ne trouvera personne qui puisse d’une autre
manière mieux expliquer les mê-191191mes choses, et ils ne l’ont fait
qu’après avoir bien consulté et
avoir connu qu’ils ne pouvaient faire autrement. Voilà comme l’on leur fournit
des excuses qu’ils n’ont jamais préparées et comme l’on se persuade qu’ils ne
font rien que de bien, parce que l’on s’est mis dans l’imagination
A la suite
du retrait provisoire de Corneille du théâtre dans les années 1650, son
nom avait acquis une aura particulière : prestigieuse, mais à laquelle
l’on mesurait désormais ses nouvelles productions. Le discours sur la
Sophonisbe ci-dessous en est l’exemple. Voir M.
Escola, « Au nom de Corneille. L’auteur comme genre », Littératures classiques, no 89, 2016, p.
55-72., et cet éclat, préoccupant les esprits, les aveuglant et les empêchant
de blâmer tout ce qui sort de l’esprit d’une personne si célèbre, fait que l’on
fouille, pour ainsi dire, jusques 190190 au fond de ses ouvrages pour y
reconnaître l’art et pour y découvrir des beautés que l’on y veut absolument
trouver (n’y en eût-il point) et que l’on assure ne se pouvoir rencontrer dans ce
que font les autres. Les plus méchants endroits de leurs pièces, et qui sont généralement
reconnus pour tels, sont pris pour des marques de l’adresse de leur esprit et de
leur prudence consommée,
et ils ne les y ont mis (à ce que disent les aveugles adorateurs d’un nom) que
pour donner de l’éclat aux autres, bien qu’ils n’aient jamais eu ce dessein.
S’ils font des fautes qui soient inexcusables, que l’on cherche tant que l’on
voudra (disent les mêmes), l’on ne trouvera personne qui puisse d’une autre
manière mieux expliquer les mê-191191mes choses, et ils ne l’ont fait
qu’après avoir bien consulté et
avoir connu qu’ils ne pouvaient faire autrement. Voilà comme l’on leur fournit
des excuses qu’ils n’ont jamais préparées et comme l’on se persuade qu’ils ne
font rien que de bien, parce que l’on s’est mis dans l’imagination La préoccupation apparaît ainsi comme une variante de
l’imagination, « maîtresse d’erreur et de fausseté », selon Pascal, dont les Pensées (1669) commencent à circuler quelques mois après son
décès. qu’ils ne peuvent mal faire.
La préoccupation apparaît ainsi comme une variante de
l’imagination, « maîtresse d’erreur et de fausseté », selon Pascal, dont les Pensées (1669) commencent à circuler quelques mois après son
décès. qu’ils ne peuvent mal faire.
— Ce que vous dites est bien véritable, lui répliqua Straton, et la préoccupation que l’on a pour une personne fait plus des trois tiers de la réussite de ses ouvrages. Nous voyons tous les jours quantité de pièces qui réussissent par la bonne opinion que l’on a d’un auteur et par la déférence que l’on a pour son nom, et ce qui est de remarquable, c’est que ces pièces sont souvent applaudies de tout le monde avant qu’elles aient 192192 été vues de personne, avant qu’elles soient achevées et même quelquefois avant qu’elles soient commencées. Si cela n’arrive pas ordinairement, cela ne manque du moins jamais d’arriver lorsque l’on commence à publier qu’elles sont faites.
Il est enfin certain, continua-t-il, que les grands auteurs se doivent plus fier au bonheur de leur nom qu’au mérite de leurs ouvrages. J’ai souvent vu venir des gens à la comédie qui, après avoir demandé à la porte qui était l’auteur de la pièce que l’on devait jouer, assuraient absolument qu’elle était bonne ou qu’elle était méchante selon le nom que l’on leur disait, comme si ceux qui ont fait de bonnes pièces n’en pouvaient pas faire de méchantes, et ceux qui en ont fait 193193 de méchantes n’en pouvaient pas faire de bonnes, ce que l’expérience fait voir tous les jours.
Je leur accordai ce dernier point, mais je les voulus tirer de l’erreur où ils
étaient de croire que l’on ne rendait pas justice à tous ceux qui travaillaient
pour l’esprit, et que ce n’était pas le mérite des grands hommes qui faisait
réussir leurs ouvrages. Mais je les trouvai tellement opiniâtres L'opiniâtreté constitue un écart envers les normes de la
civilité au moins depuis L’Honnête homme de Faret. Il s’agit d’un trait caractéristique que
les nouvellistes partagent avec les héros moliéresques Sganarelle
(L’Ecole des maris) et Arnolphe (L’Ecole
des femmes), récemment apparus sur
scène. que je vis bien que ce serait perdre temps que de
disputer avec eux, et je connus par là que les
derniers des auteurs croient valoir autant que les plus grands hommes du siècle,
que le dépit de
n’être pas autant estimés que ceux qui passent pour leurs maîtres les fait
parler de la sorte et qu’ils rejettent sur l’éclat de leurs noms ce qu’ils
savent bien qui 194194 n’est qu’un pur effet de leur mérite.
L'opiniâtreté constitue un écart envers les normes de la
civilité au moins depuis L’Honnête homme de Faret. Il s’agit d’un trait caractéristique que
les nouvellistes partagent avec les héros moliéresques Sganarelle
(L’Ecole des maris) et Arnolphe (L’Ecole
des femmes), récemment apparus sur
scène. que je vis bien que ce serait perdre temps que de
disputer avec eux, et je connus par là que les
derniers des auteurs croient valoir autant que les plus grands hommes du siècle,
que le dépit de
n’être pas autant estimés que ceux qui passent pour leurs maîtres les fait
parler de la sorte et qu’ils rejettent sur l’éclat de leurs noms ce qu’ils
savent bien qui 194194 n’est qu’un pur effet de leur mérite.
— Comme vous n’avez parlé, dit alors Clorante, que des auteurs dont le nom fait
réussir les ouvrages, il faut que je vous entretienne un moment de ceux qui font
réussir les leurs par brigues et par applaudissements mendiés La pratique de la brigue avait fait l’objet d’une parodie
dans Les Précieuses ridicules, sc. IX : « je vous demande
d’applaudir, comme il faut, quand nous serons là. Car je me suis engagé
de faire valoir la pièce, et l’auteur m’en est venu prier encore ce
matin. C’est la coutume ici, qu’à nous autres gens de condition, les
auteurs viennent lire leurs pièces nouvelles, pour nous engager à les
trouver belles, et leur donner de la réputation, et je vous laisse à
penser, si quand nous disons quelque chose le parterre ose nous
contredire. Pour moi, j’y suis fort exact ; et quand j’ai promis à
quelque poète, je crie toujours : "Voilà qui est beau ", devant que les
chandelles soient allumées. » .
La pratique de la brigue avait fait l’objet d’une parodie
dans Les Précieuses ridicules, sc. IX : « je vous demande
d’applaudir, comme il faut, quand nous serons là. Car je me suis engagé
de faire valoir la pièce, et l’auteur m’en est venu prier encore ce
matin. C’est la coutume ici, qu’à nous autres gens de condition, les
auteurs viennent lire leurs pièces nouvelles, pour nous engager à les
trouver belles, et leur donner de la réputation, et je vous laisse à
penser, si quand nous disons quelque chose le parterre ose nous
contredire. Pour moi, j’y suis fort exact ; et quand j’ai promis à
quelque poète, je crie toujours : "Voilà qui est beau ", devant que les
chandelles soient allumées. » .
Un jeune auteur de théâtre L’apparition impromptue de ce
« jeune auteur », suivie d’un nouvelliste anonyme à la p. 204 constituent
très certainement la trace d’une précédente strate des
Nouvelles Nouvelles . , qui
a beaucoup de mérite et dont l’adresse n’est pas moins à priser que l’esprit, me
vint voir il y a quelques jours et, comme nous nous entretenions d’une de ses
pièces qu’il était sur le point de faire jouer, il me dit qu’il était bien
assuré qu’elle réussirait.
L’apparition impromptue de ce
« jeune auteur », suivie d’un nouvelliste anonyme à la p. 204 constituent
très certainement la trace d’une précédente strate des
Nouvelles Nouvelles . , qui
a beaucoup de mérite et dont l’adresse n’est pas moins à priser que l’esprit, me
vint voir il y a quelques jours et, comme nous nous entretenions d’une de ses
pièces qu’il était sur le point de faire jouer, il me dit qu’il était bien
assuré qu’elle réussirait.
— Comment le pouvez-vous savoir ? lui repartis-je; c’est une chose qu’il est impossible de deviner et dont le succès est toujours entre les mains du sort.
Il me répondit qu’il savait bien ce qu’il 195195 disait, et tira, en me disant ces paroles, un papier de sa poche, où était écrit : Mémoire de ceux qui m’ont promis de venir voir jouer ma pièce. Ce papier était, par le moyen d’une raie, séparé en trois colonnes. Au-dessus de la première colonne, il y avait : Rôle de ceux qui doivent venir aux loges ; au-dessus de la seconde : Rôle de ceux qui doivent venir au théâtre ; et au-dessus de la troisième : Rôle de ceux qui doivent venir au parterre. Il me lut tous ceux qui étaient écrits sur ce papier, où je remarquai beaucoup de personnes de qualité. Je pris garde toutefois que sur le rôle des loges il y avait beaucoup plus de partisans que d’autres, parce que l’argent leur coûte bien moins qu’aux personnes de qualité.
— Je suis assuré, me dit-il après m’avoir lu tous ces 196196 noms, que tels et tels y viendront à la première représentation, tels et tels à la seconde, et tels et tels à la troisième.
Il trouva à son compte qu’il avait déjà du monde pour huit représentations, sans ceux qui devaient y venir deux ou trois fois. Il me pria après cela de lui prêter des jetons, pour calculer à combien d’argent se pourrait bien monter chaque représentation. Il ajouta quelque chose pour ceux que le hasard devait y faire venir et qui s’y devaient trouver sans être conviés.
— Eh bien ! me dit-il, après avoir bien calculé, ne suis-je pas sûr de la
réussite de ma pièce telle qu’elle puisse être ? Tous ceux qui m’ont promis d’y
venir savent déjà les beaux endroits par cœur Le
motif avait notamment été évoqué dans les Fâcheux
de Molière en 1661., afin de ne les pas
laisser passer sans les applaudir
Le
motif avait notamment été évoqué dans les Fâcheux
de Molière en 1661., afin de ne les pas
laisser passer sans les applaudir Les applaudissements
qu’une pièce est capable de susciter constituent l’un des modes
d’évaluation de la littérature mondaine. La brigue
telle que la dénonce Donneau dévalue ce critère.
197197 et sans montrer qu’ils les connaissent. C’est ainsi,
continua-t-il, comme un homme d’esprit doit faire, et je n’en trouve point de
plus fous que ceux qui abandonnent leurs ouvrages à la bizarrerie du goût de la
plupart des gens de qualité qui, pour un incident qui ne leur plaira pas, ou
pour un vers qu’ils trouveront méchant, bien qu’il soit peut-être bon, perdront entièrement
une pièce.
Les applaudissements
qu’une pièce est capable de susciter constituent l’un des modes
d’évaluation de la littérature mondaine. La brigue
telle que la dénonce Donneau dévalue ce critère.
197197 et sans montrer qu’ils les connaissent. C’est ainsi,
continua-t-il, comme un homme d’esprit doit faire, et je n’en trouve point de
plus fous que ceux qui abandonnent leurs ouvrages à la bizarrerie du goût de la
plupart des gens de qualité qui, pour un incident qui ne leur plaira pas, ou
pour un vers qu’ils trouveront méchant, bien qu’il soit peut-être bon, perdront entièrement
une pièce.
—Voilà justement, lui répliquai-je, ce qui fait réussir tant de méchantes pièces
de théâtre et ce qui fait que nous en voyons tomber tant de bonnes qui, bien
qu’elles soient approuvées du peu de gens que le hasard y conduit, ne sont
suivies de personne, parce que l’on est présentement accoutumé d’être prié pour
aller voir une pièce nouvelle, de mê-198198me que pour aller aux noces et
festins; et si le temps continue, l’on ne se contentera pas des affiches et
les auteurs feront faire des billets En 1663, les affiches
n’étaient plus le seul moyen de promouvoir une pièce comme elles
l’avaient été jusqu’en 1650. La lettre en vers de Loret et celle de Robinet assuraient également la promotion d’événements théâtraux.
, de même que l’on fait pour les enterrements, par lesquels ils
prieront leurs amis de venir approuver leurs pièces. Cette injuste coutume, et
qui ravit au mérite ce qui lui est dû, devrait bien fâcher les comédiens. Elle
est cause qu’il n’y a que deux ou trois auteurs qui réussissent et qui,
vains de leur succès,
les tyrannisent et se font donner ce qu’ils veulent
En 1663, les affiches
n’étaient plus le seul moyen de promouvoir une pièce comme elles
l’avaient été jusqu’en 1650. La lettre en vers de Loret et celle de Robinet assuraient également la promotion d’événements théâtraux.
, de même que l’on fait pour les enterrements, par lesquels ils
prieront leurs amis de venir approuver leurs pièces. Cette injuste coutume, et
qui ravit au mérite ce qui lui est dû, devrait bien fâcher les comédiens. Elle
est cause qu’il n’y a que deux ou trois auteurs qui réussissent et qui,
vains de leur succès,
les tyrannisent et se font donner ce qu’ils veulent Les frères Corneille sont réputés donner leur pièce au plus offrant et
ainsi faire monter les enchères. Donneau s’efforce d’acquérir les bonnes
grâces des comédiens en dénonçant à mots couverts et au passage la
« tyrannie » de cette pratique., parce qu’ils sont les
maîtres du théâtre et que l’on ne peut jouer aucune pièce l’année qui ne tombe, non pour
être méchante, mais parce que,
comme j’ai déjà dit, l’on ne va plus à la comédie si l’on n’en est prié. Sans
cette ridicule habi-199199tude, toutes les bonnes pièces réussiraient,
l’on viendrait plus souvent à la comédie, l’on rendrait justice au
mérite
et, le nombre des auteurs étant plus grand, les comédiens
n’achèteraient pas tant leurs pièces
Les frères Corneille sont réputés donner leur pièce au plus offrant et
ainsi faire monter les enchères. Donneau s’efforce d’acquérir les bonnes
grâces des comédiens en dénonçant à mots couverts et au passage la
« tyrannie » de cette pratique., parce qu’ils sont les
maîtres du théâtre et que l’on ne peut jouer aucune pièce l’année qui ne tombe, non pour
être méchante, mais parce que,
comme j’ai déjà dit, l’on ne va plus à la comédie si l’on n’en est prié. Sans
cette ridicule habi-199199tude, toutes les bonnes pièces réussiraient,
l’on viendrait plus souvent à la comédie, l’on rendrait justice au
mérite
et, le nombre des auteurs étant plus grand, les comédiens
n’achèteraient pas tant leurs pièces Un auteur
peut être rémunéré de deux manières : en touchant des parts sur chaque
représentation (Donneau de Visé ou Marie-Catherine Desjardins avec la
troupe de Molière) ou en vendant la pièce pour une somme forfaitaire
unique (Corneille, Boursault). et en joueraient plus
souvent de nouvelles qui réussiraient, et par ce moyen ils gagneraient plus
qu’ils ne font.
Un auteur
peut être rémunéré de deux manières : en touchant des parts sur chaque
représentation (Donneau de Visé ou Marie-Catherine Desjardins avec la
troupe de Molière) ou en vendant la pièce pour une somme forfaitaire
unique (Corneille, Boursault). et en joueraient plus
souvent de nouvelles qui réussiraient, et par ce moyen ils gagneraient plus
qu’ils ne font.
Pour moi, continuai-je, j’ai une comédie que l’on trouve assez belle et que
l’on veut jouer Cet exemplum est peut-être
également une publicité dissimulée. Donneau de Visé négocie en effet les
représentation de ses Coteaux avec l’Hôtel de
Bourgogne (voir ci-dessous, p. 241-242) ainsi
peut-être que celles de sa Mère coquette. ,
mais je ne veux pas le permettre, parce que je ne suis pas d’humeur d’aller de porte en
porte prier tous les gens de qualité d’y venir et que, si l’on la joue sans que
j’aie brigué, il n’y viendra personne. S’il n’y vient personne,
quoique la pièce soit trouvée bonne d’une poignée de monde que le hasard y aura
fait rencontrer, les comé-200200diens la quitteront avec justice. Ainsi, quoique ma pièce plaise à tous
ceux qui la verront, le manque d’auditeurs ne laissera pas que de la faire
tomber.
Cet exemplum est peut-être
également une publicité dissimulée. Donneau de Visé négocie en effet les
représentation de ses Coteaux avec l’Hôtel de
Bourgogne (voir ci-dessous, p. 241-242) ainsi
peut-être que celles de sa Mère coquette. ,
mais je ne veux pas le permettre, parce que je ne suis pas d’humeur d’aller de porte en
porte prier tous les gens de qualité d’y venir et que, si l’on la joue sans que
j’aie brigué, il n’y viendra personne. S’il n’y vient personne,
quoique la pièce soit trouvée bonne d’une poignée de monde que le hasard y aura
fait rencontrer, les comé-200200diens la quitteront avec justice. Ainsi, quoique ma pièce plaise à tous
ceux qui la verront, le manque d’auditeurs ne laissera pas que de la faire
tomber.
Mais pour retourner au jeune auteur dont je vous parlais auparavant :
— Il faut, me dit-il, en sortant d’une rêverie qui l’avait quelque temps empêché de parler, que
je fasse encore venir telles et telles dames à ma pièce, mais je ne sais comment
faire pour en venir à bout :
ce n’est pas que la comédie ne soit un divertissement qui ne leur plaise
beaucoup, mais elles n’aiment pas à le payer. J’ai trouvé ce que je cherchais !
s’écria-t-il un moment après en s’applaudissant; il faut que fasse en sorte, et
cela n’est pas difficile, que les personnes de qualité qui viennent souvent chez
ces dames louent des 201201 loges pour les y mener. Tout cela aidera à la
faire réussir. Et il y a même longtemps que j’empêche que l’on ne la joue, parce
que tels et tels, qui m’ont promis de venir à la première représentation, ne
sont pas encore de retour de la campagne Le public
disponible pour assister aux pièces varie notamment selon les saisons et
les événements liés à la vie de la cour. Donneau de Visé avait déjà
commenté ce phénomène dans la préface de La Cocue
imaginaire, à propos du Cocu
imaginaire de Molière..
Le public
disponible pour assister aux pièces varie notamment selon les saisons et
les événements liés à la vie de la cour. Donneau de Visé avait déjà
commenté ce phénomène dans la préface de La Cocue
imaginaire, à propos du Cocu
imaginaire de Molière..
Ce n’est pas assez, me dit-il encore, que j’aie des gens qui viennent voir ma
pièce, il faut que j’en aie encore qui en aillent dire du bien sur les autres
théâtres et qui aillent fronder
les pièces nouvelles La nouveauté d’une pièce attire,
permettant parfois à une troupe de doubler le prix des places.
que l’on opposera à la mienne.
La nouveauté d’une pièce attire,
permettant parfois à une troupe de doubler le prix des places.
que l’on opposera à la mienne.
— Je vis, il y a quelque temps, lui dis-je, des gens qui, n’étant venus que pour
perdre une pièce, la firent réussir. Ils en blâmèrent imprudemment les plus beaux
endroits, raillèrent mal à propos, n’écoutèrent rien, ne firent que bâiller (car
c’est la coutume présentement de bâiller Le bâillement
comme signe d’ennui avait été évoqué dans la première scène des
Précieuses ridicules : « Je n'ai jamais vu tant
parler à l'oreille qu'elles ont fait entre elles, tant bâiller, tant se
frotter les yeux et demander tant de fois quelle heure est-il »
202202 pour montrer que l’on n’approuve pas). Toutes ces choses faites à
contretemps firent connaître leur dessein. L’on prit pitié de la pièce, qui
avait plus de beautés que de défauts, l’on vit bien qu’ils n’étaient venus que
pour la perdre, ce qui fut cause que tous les gens d’esprit l’admirèrent et la
firent réussir en dépit d’eux.
Le bâillement
comme signe d’ennui avait été évoqué dans la première scène des
Précieuses ridicules : « Je n'ai jamais vu tant
parler à l'oreille qu'elles ont fait entre elles, tant bâiller, tant se
frotter les yeux et demander tant de fois quelle heure est-il »
202202 pour montrer que l’on n’approuve pas). Toutes ces choses faites à
contretemps firent connaître leur dessein. L’on prit pitié de la pièce, qui
avait plus de beautés que de défauts, l’on vit bien qu’ils n’étaient venus que
pour la perdre, ce qui fut cause que tous les gens d’esprit l’admirèrent et la
firent réussir en dépit d’eux.
— Je sais bien de quelle pièce vous me voulez parler, me répliqua-t-il ; c’est
d’un auteur qui a beaucoup de feu L’expression avait
été utilisée à propos de Boyer dans Les Véritables
Précieuses : « Nous avons encore vu cet hiver le
Fédéric qui a fort réussi et c’est sans doute avec
quelque raison, puisqu’il ne part rien de la veine de son auteur qui ne
soit plein de feu, témoin sa Clotilde où la boutade est
bien exprimée ». Mais plus probablement le propos de Straton a ici une
valeur générale, désignant des discours et des situations types du monde
littéraire ; en l’occurrence, la concurrence de jeunes auteurs vaniteux
entreprenant les uns sur les autres. et qui m’avait fait
une infidélité. Quoique
sa pièce ait eu quelques applaudissements, il s’en faut beaucoup qu’elle ait été
aussi loin que la mienne. Il la voulait, ce disait-il, faire réussir à force de
partisans, mais je lui ai bien fait voir du pays et je lui ai fait connaître que
j’en avais plus que lui. 203203
L’expression avait
été utilisée à propos de Boyer dans Les Véritables
Précieuses : « Nous avons encore vu cet hiver le
Fédéric qui a fort réussi et c’est sans doute avec
quelque raison, puisqu’il ne part rien de la veine de son auteur qui ne
soit plein de feu, témoin sa Clotilde où la boutade est
bien exprimée ». Mais plus probablement le propos de Straton a ici une
valeur générale, désignant des discours et des situations types du monde
littéraire ; en l’occurrence, la concurrence de jeunes auteurs vaniteux
entreprenant les uns sur les autres. et qui m’avait fait
une infidélité. Quoique
sa pièce ait eu quelques applaudissements, il s’en faut beaucoup qu’elle ait été
aussi loin que la mienne. Il la voulait, ce disait-il, faire réussir à force de
partisans, mais je lui ai bien fait voir du pays et je lui ai fait connaître que
j’en avais plus que lui. 203203
— Croyez-moi, lui repartis-je, employez tout le temps que vous mettez à briguer des applaudissements, à faire une belle pièce, et faites que votre mérite et les beautés de vos ouvrages vous servent de partisans. Vous acquerrez beaucoup plus de gloire et l’on ne dira plus que vous triomphez sans combattre et que, sans le bien que vos amis disent de vos pièces, l’on n’en dirait point du tout.
— Monsieur, me repartit-il, le bon droit a besoin d’aide et, si j’étais sûr que
l’on rendît justice à mes ouvrages, je ne me donnerais pas tant de peine que je
fais à leur chercher des protecteurs. Je suis fâché, continua-t-il, en me disant
adieu, de vous quitter si tôt ; mais je vais dîner chez une personne de qualité,
où je dois lire ma pièce après le dîner L’usage est
également tourné en dérision dans La Critique de L’Ecole des
femmes.. Et 204204 d’ici à quinze jours que
l’on la doit jouer, je dois tous les jours dîner en ville pour en faire des
lectures.
L’usage est
également tourné en dérision dans La Critique de L’Ecole des
femmes.. Et 204204 d’ici à quinze jours que
l’on la doit jouer, je dois tous les jours dîner en ville pour en faire des
lectures.
Il me quitta après m’avoir dit ces paroles, et me laissa rêver à ce qu’il m’avait dit Autre vestige d’une précédente strate des
Nouvelles Nouvelles (voir note p. 194).
.
Autre vestige d’une précédente strate des
Nouvelles Nouvelles (voir note p. 194).
.
Un nouvelliste de ma connaissance Autre trace d’une
précédente strate des Nouvelles Nouvelles (voir note p. 200). L’arrivée intempestive de nouvellistes anonymes, alors que chaque
nouvelliste a soigneusement été annoncé dans le volume II, indique
peut-être que le précédent projet était composé de
courtes séquences, peut-être prévues pour une publication
périodique. entra aussitôt dans ma chambre et, après
m’avoir raconté cent nouvelles, tant fausses que véritables, me dit qu’une
certaine pièce de théâtre que l’on était sur le point de jouer était la plus
belle chose du monde. Il m’en dit des biens presque incroyables et m’assura que
c’était le dernier effort de l’esprit humain, que cette pièce allait
effacer tout ce qui avait jamais paru de beau au théâtre et que la réussite en
était infaillible. Je lui demandai d’où il le savait. Il me répondit qu’outre
que l’on le disait, 205205
l’auteur lui en avait récité trente vers
Autre trace d’une
précédente strate des Nouvelles Nouvelles (voir note p. 200). L’arrivée intempestive de nouvellistes anonymes, alors que chaque
nouvelliste a soigneusement été annoncé dans le volume II, indique
peut-être que le précédent projet était composé de
courtes séquences, peut-être prévues pour une publication
périodique. entra aussitôt dans ma chambre et, après
m’avoir raconté cent nouvelles, tant fausses que véritables, me dit qu’une
certaine pièce de théâtre que l’on était sur le point de jouer était la plus
belle chose du monde. Il m’en dit des biens presque incroyables et m’assura que
c’était le dernier effort de l’esprit humain, que cette pièce allait
effacer tout ce qui avait jamais paru de beau au théâtre et que la réussite en
était infaillible. Je lui demandai d’où il le savait. Il me répondit qu’outre
que l’on le disait, 205205
l’auteur lui en avait récité trente vers Cette technique
promotionnelle qui s’apparente aux lectures publiques est
utilisée dans les au tome II des Nouvelles Nouvelles, en
particulier dans la « Conversation des pointes ou pensées
». qu’il trouvait inimitables.
Cette technique
promotionnelle qui s’apparente aux lectures publiques est
utilisée dans les au tome II des Nouvelles Nouvelles, en
particulier dans la « Conversation des pointes ou pensées
». qu’il trouvait inimitables.
— Trente vers, lui repartis-je à demi en colère, doivent-ils faire réussir une
pièce de théâtre dont le sujet sera peut-être aussi méchant qu’il sera mal conduit et qui
n’aura pour toutes beautés que ces trente vers Critique
comparable à celle formulée dans La Précieuse de Pure, à
propos des livres « dont on juge par les extraits d’autrui ». ? et devez-vous croire ce que « on » dit,
vu que c’est le plus grand menteur du monde et que l’Académie française devrait
lui avoir fait son procès il y a
longtemps, comme au plus grand imposteur et au plus grand séducteur qui fut jamais ? Voilà,
continuai-je, pourquoi l’on est si souvent trompé et pourquoi il y a de
certaines pièces dont on ne dit jamais de bien qu’avant la représentation.
Critique
comparable à celle formulée dans La Précieuse de Pure, à
propos des livres « dont on juge par les extraits d’autrui ». ? et devez-vous croire ce que « on » dit,
vu que c’est le plus grand menteur du monde et que l’Académie française devrait
lui avoir fait son procès il y a
longtemps, comme au plus grand imposteur et au plus grand séducteur qui fut jamais ? Voilà,
continuai-je, pourquoi l’on est si souvent trompé et pourquoi il y a de
certaines pièces dont on ne dit jamais de bien qu’avant la représentation.
Ce crédule nouvelliste, ou plutôt cet admirateur d’une pièce 206206 dont
il n’avait encore vu que trente vers, ne fut pas plus tôt sorti de chez moi
qu’il y entra un homme qui n’était pas moins incommode Autre vestige d’une précédente strate des Nouvelles
Nouvelles (voir notes p. 200
et p. 204). La scène de récitateur importun qui suit est une
source possible de la scène du sonnet d’Oronte dans le
Misanthrope (acte I, scène 2). Dans l’économie des
Nouvelles Nouvelles, elle redouble la récitation des
madrigaux, p. 84-89. . C’était un de ces auteurs qui font
peu de choses, mais qui se louent toujours et qui étourdissent sans cesse de
leurs louanges ceux avec qui ils sont.
Autre vestige d’une précédente strate des Nouvelles
Nouvelles (voir notes p. 200
et p. 204). La scène de récitateur importun qui suit est une
source possible de la scène du sonnet d’Oronte dans le
Misanthrope (acte I, scène 2). Dans l’économie des
Nouvelles Nouvelles, elle redouble la récitation des
madrigaux, p. 84-89. . C’était un de ces auteurs qui font
peu de choses, mais qui se louent toujours et qui étourdissent sans cesse de
leurs louanges ceux avec qui ils sont.
— Je viens, me dit-il d’un visage riant, vous montrer un madrigal qui m’a
coûté un mois de temps La plaisanterie est semblable à
celles que fait Mascarille dans Les Précieuses
ridicules (p. ex.
« impromptu à loisir », sc. XII)..
La plaisanterie est semblable à
celles que fait Mascarille dans Les Précieuses
ridicules (p. ex.
« impromptu à loisir », sc. XII)..
Après avoir dit ce peu de paroles, il cracha deux ou trois fois et commença à le réciter avec beaucoup de gravité. Il eut à peine dit deux vers qu’il cessa de parler pour entendre les applaudissements qu’il croyait déjà mériter, mais, comme il vit que je ne faisais qu’un signe de tête :
— Il semble, me dit-il, en me regardant d’un air dédaigneux et qui mar-207207quait assez son dépit, que vous doutiez si vous devez louer ces vers.
— Je les trouve beaux, lui répondis-je.
— Vous louez froidement, continua-t-il, encore plus piqué qu’auparavant de ce que je ne m’emportais pas à le louer. Je viens de la cour, où je l’ai récité. Tout le monde l’a trouvé admirable. On m’en a demandé des copies et l’on m’a pressé de le faire imprimer. Cependant, il semble que vous ne l’approuviez que par force.
— Pour vous parler librement, lui repartis-je, il faut que vous ayez perdu l’esprit, ou du moins que vous ayez mis dans votre madrigal tout ce que vous en aviez, de vouloir m’obliger à dire du bien de deux vers sans avoir vu la suite.
— Vous avez raison, me répondit-il, mais vous pouviez toutefois louer le début, 208208 car je crois avoir bien commencé. Écoutez !
Il récita tout son madrigal, que je ne trouvai ni bon ni méchant. Après avoir achevé :
— Voilà, dit-il, ce que l’on appelle un madrigal La scène
reprend des éléments de celle des Précieuses
ridicules (sc. XIII) où
Mascarille fait l’éloge de son propre sonnet. La répétition comique du
terme « madrigal », quant à elle, s’efforce d’imiter l’effet produit par
les répétitions du marquis dans La Critique de l’Ecole des
femmes (« détestable, morbleu, détestable » et surtout «
tarte à la crème »). Elle éclaire également ce que fera Molière une
année plus tard dans Tartuffe, lorsque Orgon répète
« C’est un homme… » (I, 4). ! C’est un madrigal, morbleu,
c’est un madrigal ! voilà comme l’on doit faire un madrigal ! voilà ce qui se
doit nommer madrigal ! Plusieurs croient en avoir fait, qui ne savent pas
seulement ce que c’est qu’un madrigal. Aussi ce madrigal m’a-t-il beaucoup
coûté. J’ai été longtemps à le faire, mais aussi ai-je l’avantage d’avoir fait
un véritable madrigal. N’est-il pas vrai que c’est un madrigal ? n’y
remarquez-vous pas toutes les parties d’un madrigal ? toutes les règles du
madrigal n’y sont-elles pas bien observées ? Oui, oui, c’est un madrigal ! c’est
un véritable 209209 madrigal ! continua-t-il, en me tirant tantôt par le
bras, tantôt par mon habit, pour l’obliger à le louer. C’est un madrigal ! et
vous pourrez dire aujourd’hui que vous aurez vu un madrigal.
La scène
reprend des éléments de celle des Précieuses
ridicules (sc. XIII) où
Mascarille fait l’éloge de son propre sonnet. La répétition comique du
terme « madrigal », quant à elle, s’efforce d’imiter l’effet produit par
les répétitions du marquis dans La Critique de l’Ecole des
femmes (« détestable, morbleu, détestable » et surtout «
tarte à la crème »). Elle éclaire également ce que fera Molière une
année plus tard dans Tartuffe, lorsque Orgon répète
« C’est un homme… » (I, 4). ! C’est un madrigal, morbleu,
c’est un madrigal ! voilà comme l’on doit faire un madrigal ! voilà ce qui se
doit nommer madrigal ! Plusieurs croient en avoir fait, qui ne savent pas
seulement ce que c’est qu’un madrigal. Aussi ce madrigal m’a-t-il beaucoup
coûté. J’ai été longtemps à le faire, mais aussi ai-je l’avantage d’avoir fait
un véritable madrigal. N’est-il pas vrai que c’est un madrigal ? n’y
remarquez-vous pas toutes les parties d’un madrigal ? toutes les règles du
madrigal n’y sont-elles pas bien observées ? Oui, oui, c’est un madrigal ! c’est
un véritable 209209 madrigal ! continua-t-il, en me tirant tantôt par le
bras, tantôt par mon habit, pour l’obliger à le louer. C’est un madrigal ! et
vous pourrez dire aujourd’hui que vous aurez vu un madrigal.
— Du moins n’oublierai-je pas, lui repartis-je, que j’en aurai ouï parler.
Je fus toutefois obligé de lui donner plus de louanges que je ne croyais qu’il en méritait, parce que je savais bien qu’il n’attendait que cela pour me quitter. Après que je l’eus excessivement loué, pour le chasser plus honnêtement, il sortit et fut ensuite autre part jouer le même personnage.
Je le rencontrai le lendemain, qui écrivait sur des tablettes en plein
Pont-Neuf Le Pont-Neuf est un lieu de circulation
de l’information, mais également un lieu de forte fréquentation. Il est
donc probablement très incommode de s’y arrêter pour écrire sur des
tablettes. et, lui ayant demandé ce qu’il faisait :
Le Pont-Neuf est un lieu de circulation
de l’information, mais également un lieu de forte fréquentation. Il est
donc probablement très incommode de s’y arrêter pour écrire sur des
tablettes. et, lui ayant demandé ce qu’il faisait :
— J’écris, me répondit-il, une pensée qui me vient de venir et 210210 que
je trouve bonne pour faire servir de pointe à la fin d’un sonnet La composition d’une pointe avant le reste du sonnet
participe du discours contre la pointe et raille une poésie fondée sur
l’effet plutôt que sur le sens. Dans
Le Parnasse réformé, Guéret prêtera à certains devisants des
commentaires comparables : « Pourvu qu’on soit assez heureux pour
rencontrer la rime et la mesure, on se persuade que tout le reste n’est
rien » (p. 53).
, et comme je crains de l’oublier, j’ai jugé à propos de la
mettre sur des tablettes que je porte toujours pour mettre en sûreté celles qui
me viennent, de crainte qu’elles ne m’échappent.
La composition d’une pointe avant le reste du sonnet
participe du discours contre la pointe et raille une poésie fondée sur
l’effet plutôt que sur le sens. Dans
Le Parnasse réformé, Guéret prêtera à certains devisants des
commentaires comparables : « Pourvu qu’on soit assez heureux pour
rencontrer la rime et la mesure, on se persuade que tout le reste n’est
rien » (p. 53).
, et comme je crains de l’oublier, j’ai jugé à propos de la
mettre sur des tablettes que je porte toujours pour mettre en sûreté celles qui
me viennent, de crainte qu’elles ne m’échappent.
Lorsque Clorante eut cessé de parler, je lui dis que j'avais pris plaisir à
l'entendre, et surtout lorsqu'il avait parlé de la comédie et de l'auteur
qui ne faisait réussir ses pièces que par ressorts et par brigues La maladresse de cette
transition signale les différentes strates présentes dans les
Nouvelles Nouvelles (voir notes p. 200 et
204)., et qui croyait qu'elles étaient bonnes lorsqu'il y
pouvait entraîner bien du monde.
La maladresse de cette
transition signale les différentes strates présentes dans les
Nouvelles Nouvelles (voir notes p. 200 et
204)., et qui croyait qu'elles étaient bonnes lorsqu'il y
pouvait entraîner bien du monde.
— Mais comme je suis depuis peu de retour de la campagne, continuai-je, où j'ai
demeuré quelques années, je vous prie de m'apprendre qui est un 211211 certain comédien Ici débute un passage consacré à
Molière qui s’étendra jusqu’à la p. 243. L’ampleur du propos est
justifiée par la notoriété exceptionnelle qu’a acquise le comédien
auteur à la suite des Précieuses ridicules et surtout de
L’Ecole des femmes, dont les
représentations sont alors en cours. Pareil développement biographique
et critique consacré à un auteur de théâtre vivant est tout à fait
exceptionnel : il se révèle à la mesure de la fascination qu’exerce
Molière au début des années 1660. Tout au long des
pages qui suivront Donneau de Visé s’ingéniera à éviter l’énonciation du
nom « Molière ». Celui de Corneille, en revanche, sera formulé à
vingt-cinq reprises. de la troupe de Monsieur
Ici débute un passage consacré à
Molière qui s’étendra jusqu’à la p. 243. L’ampleur du propos est
justifiée par la notoriété exceptionnelle qu’a acquise le comédien
auteur à la suite des Précieuses ridicules et surtout de
L’Ecole des femmes, dont les
représentations sont alors en cours. Pareil développement biographique
et critique consacré à un auteur de théâtre vivant est tout à fait
exceptionnel : il se révèle à la mesure de la fascination qu’exerce
Molière au début des années 1660. Tout au long des
pages qui suivront Donneau de Visé s’ingéniera à éviter l’énonciation du
nom « Molière ». Celui de Corneille, en revanche, sera formulé à
vingt-cinq reprises. de la troupe de Monsieur La troupe de Molière porte alors le titre de « troupe de
Monsieur, frère du roi », auquel elle substituera par décision de Louis
XIV, à partir de juin 1665, celui de « Troupe du roi ».,
dont les pièces font tant de bruit et dont l'on parle partout comme d'un homme
qui a infiniment d'esprit
La troupe de Molière porte alors le titre de « troupe de
Monsieur, frère du roi », auquel elle substituera par décision de Louis
XIV, à partir de juin 1665, celui de « Troupe du roi ».,
dont les pièces font tant de bruit et dont l'on parle partout comme d'un homme
qui a infiniment d'esprit C’est là la principale qualité
attribuée à Molière et dont il sera de nouveau question plus loin («
l’adresse », p.212 ; « fort galant homme », p. 213)..
C’est là la principale qualité
attribuée à Molière et dont il sera de nouveau question plus loin («
l’adresse », p.212 ; « fort galant homme », p. 213)..
Je disais cela à dessein de savoir son sentiment et ne feignais d'avoir été à la campagne que pour avoir le plaisir de l'entendre discourir.
— Tout ce que je vous puis dire, me répondit-il froidement et avec un
souris
dédaigneux L’attitude de Clorante est semblable à celle
de l’auteur Lysidas dans La Critique de L’Ecole des femmes.
Elle trouve un antécédent dans le comportement du poète Picotin,
protagoniste des Véritables Précieuses de Baudeau de Somaize., c'est qu'il a réussi
et que vous n'ignorez pas que
L’attitude de Clorante est semblable à celle
de l’auteur Lysidas dans La Critique de L’Ecole des femmes.
Elle trouve un antécédent dans le comportement du poète Picotin,
protagoniste des Véritables Précieuses de Baudeau de Somaize., c'est qu'il a réussi
et que vous n'ignorez pas que
Quand on a réussi, on est justifié, Reformulation d’une
idée énoncée dans la préface de L’Ecole des femmes : « « je m’en tiens
assez vengé par la réussite de ma comédie ». Cet alexandrin n’est pas
attesté en-dehors de cette occurrence.
Reformulation d’une
idée énoncée dans la préface de L’Ecole des femmes : « « je m’en tiens
assez vengé par la réussite de ma comédie ». Cet alexandrin n’est pas
attesté en-dehors de cette occurrence.
quelque mal que l'on ait fait et quelque mal que l'on continue de faire. C'est
pourquoi j'aurais mauvaise grâce de ne vous pas dire du bien de ses ouvrages,
puisque tout le monde en dit Molière est accusé de
bénéficier, comme Corneille, de l’effet de préoccupation. Même
constat dans Zélinde (« Quoique tout ce que vous dites soit véritable, la
réputation d’Élomire est si bien établie que, si un autre avait fait
quelques pièces sur ces matières du temps beaucoup plus belles que les
siennes, l’on dirait d’abord que ce ne sont que des copies ») et dans
La Guerre comique de La Croix (« Il a rempli la place, Madame, on ne pourrait
souffrir les autres quand ils seraient mieux que lui ; on ne trouve rien
bon que ce qui vient de Molière »)., et 212212 je ne
puis, sans hasarder ma réputation, vous en dire du mal, quand même je dirais la
vérité, ni m'opposer au torrent des applaudissements qu'il reçoit tous les
jours.
Molière est accusé de
bénéficier, comme Corneille, de l’effet de préoccupation. Même
constat dans Zélinde (« Quoique tout ce que vous dites soit véritable, la
réputation d’Élomire est si bien établie que, si un autre avait fait
quelques pièces sur ces matières du temps beaucoup plus belles que les
siennes, l’on dirait d’abord que ce ne sont que des copies ») et dans
La Guerre comique de La Croix (« Il a rempli la place, Madame, on ne pourrait
souffrir les autres quand ils seraient mieux que lui ; on ne trouve rien
bon que ce qui vient de Molière »)., et 212212 je ne
puis, sans hasarder ma réputation, vous en dire du mal, quand même je dirais la
vérité, ni m'opposer au torrent des applaudissements qu'il reçoit tous les
jours.
Je vous dirai toutefois que l'on doit plutôt estimer l'adresse de ceux qui
réussissent en ce temps que la grandeur de leur esprit. Et comme, loin de
combattre les mauvais goûts du siècle et de s'opposer à ses appétits déréglés
pour lui faire reconnaître son erreur, ils s'accommodent à sa
faiblesse Cf Zélinde : « accommodez-vous au goût du siècle, et vous verrez si
l’on ne dira pas que vous aurez autant de mérite qu’Élomire ». Clorante
expose une des raisons qui font que Molière doit être envisagé comme un
gâte-métier., il
ne faut pas s'étonner si ce même siècle leur donne des louanges que la postérité
ne leur donnera sans doute pas.
Cf Zélinde : « accommodez-vous au goût du siècle, et vous verrez si
l’on ne dira pas que vous aurez autant de mérite qu’Élomire ». Clorante
expose une des raisons qui font que Molière doit être envisagé comme un
gâte-métier., il
ne faut pas s'étonner si ce même siècle leur donne des louanges que la postérité
ne leur donnera sans doute pas.
Mais pour retourner au fameux comédien dont vous m'avez parlé, ses ouvrages
n'ayant pas tout le mérite de sa personne, vous me permet-213213trez de
ne vous en dire rien autre chose sinon que c'est un fort galant
homme Cf. Zélinde : « Il faut avouer que c’est un galant homme ; et qu’il
est louable de savoir si bien se servir de tout ce qu’il lit de bon
». . Je vous en dirais davantage si je ne craignais qu'il
se tînt offensé de ce que je vous pourrais dire et si je n'appréhendais de
passer pour ridicule aux yeux de ceux qui n'adorent que les bagatelles
Cf. Zélinde : « Il faut avouer que c’est un galant homme ; et qu’il
est louable de savoir si bien se servir de tout ce qu’il lit de bon
». . Je vous en dirais davantage si je ne craignais qu'il
se tînt offensé de ce que je vous pourrais dire et si je n'appréhendais de
passer pour ridicule aux yeux de ceux qui n'adorent que les bagatelles Le mot est à la mode. Il sera souvent utilisé pour qualifier les comédies de
Molière et dénoncer le déclin de la qualité des spectacles français
qu’elles occasionnent. Les propos de Clorante font écho à ceux de
Lysidas dans La Critique de L’Ecole des femmes, qui déplorera
que « on ne court plus qu’à cela, et l’on voit une solitude effroyable aux grands ouvrages,
lorsque des sottises ont tout Paris »., qui n'osent
démentir la voix publique lorsqu'elle a une fois approuvé une chose et qui, pour
donner des louanges à un homme, opinent du bonnet parce qu'ils voient que c'est
le sentiment des autres.
Le mot est à la mode. Il sera souvent utilisé pour qualifier les comédies de
Molière et dénoncer le déclin de la qualité des spectacles français
qu’elles occasionnent. Les propos de Clorante font écho à ceux de
Lysidas dans La Critique de L’Ecole des femmes, qui déplorera
que « on ne court plus qu’à cela, et l’on voit une solitude effroyable aux grands ouvrages,
lorsque des sottises ont tout Paris »., qui n'osent
démentir la voix publique lorsqu'elle a une fois approuvé une chose et qui, pour
donner des louanges à un homme, opinent du bonnet parce qu'ils voient que c'est
le sentiment des autres.
— Vous êtes cause, repartit Ariste à Clorante, aussi bien que beaucoup d'autres, de cet abus que l'on voit tous les jours augmenter de plus en plus dans le monde. Les applaudissements se donnent présentement par complaisance et peu de person-214214nes approuvent aujourd'hui ce qu'elles louent. Chacun craint de passer pour ridicule en n'approuvant pas ce qu'il entend approuver à un autre, chacun parle contre son sentiment et aide de la sorte à se tromper soi-même, ce qui fait que les pièces qui paraissent généralement approuvées sont souvent celles que chacun condamne en particulier. Cette grande et timide foule d'admirateurs, volontaires et forcés tout ensemble, range insensiblement à son parti les plus opiniâtres, qui croiraient passer pour stupides et pour ignorants s'ils n'approuvaient pas ce que les autres approuvent, bien qu'ils ne soient pas de leur sentiment.
— Tout ce que vous dites est véritable, lui répondit Clorante, mais je ne suis pas 215215 tout seul cause de ces abus et, pour m'y opposer, je me suis souvent efforcé de louer des pièces de théâtre qui, quoiqu'elles fussent bonnes, ont été condamnées par les mêmes raisons que vous venez de dire, ceux qui connaissaient la bonté de ces pièces n'osant les protéger, de crainte de passer pour ridicules, et disant par complaisance qu'elles ne valaient rien.
Comme il y a des critiques, continua-t-il, qui n'approuvent jamais rien et qui
entraînent les opinions de quelques gens faciles qui croiraient mal faire et
devoir être raillés de ne pas témoigner qu'ils sont de leur sentiment, bien
qu'ils n'en soient point, il y en a d'autres qui approuvent tout ce qu'ils
voient : je connais un des plus galants abbés du siècle Le
galant abbé ici désigné est peut-être Charles Cotin, qui fait
paraître en 1663 (achevé d’imprimer : 16 décembre 1662) ses Oeuvres
galantes en prose et en vers, mêlées de quelques pièces composées par
des dames de qualité : dans l'avis au lecteur, il fait un éloge bienveillant à l’extrême de la production
féminine qu’il reproduit dans son recueil personnel. Mais il peut s’agir
également de l’abbé d’Aubignac, très sourcilleux sur ce type de
déférence : dans sa Défense de la Sophonisbe, Donneau de Visé le
fustigera d’avoir tenu rigueur à Corneille de ne pas lui être venu lui
présenter sa pièce. Ou encore de l’abbé du Buisson, dont Somaize dit qu’il
est « un des introducteurs des ruelles et protecteur des jeux du cirque ». , et à 216216 qui je puis sans injustice donner
le nom d'obligeant, puisque, par une bonté naturelle, il loue indifféremment
tous les ouvrages qu'il voit et tous ceux que l'on lui montre en
particulier ; aussi dit-on de
lui dans le monde que l'on ne saurait connaître s'il dit la vérité et qu'il ne
fait point de jaloux, puisqu'il met tous les auteurs en même degré et qu'il loue
également leurs productions en public et en particulier, sans crainte de hasarder sa
gloire.
Cependant il est constant qu'il a
le goût fin et délicat, qu'il connaît bien les défauts de tout ce qu'il voit, et
qu'il n'estime pas tout ce qu'il approuve ou qu'il feint d'approuver.
Le
galant abbé ici désigné est peut-être Charles Cotin, qui fait
paraître en 1663 (achevé d’imprimer : 16 décembre 1662) ses Oeuvres
galantes en prose et en vers, mêlées de quelques pièces composées par
des dames de qualité : dans l'avis au lecteur, il fait un éloge bienveillant à l’extrême de la production
féminine qu’il reproduit dans son recueil personnel. Mais il peut s’agir
également de l’abbé d’Aubignac, très sourcilleux sur ce type de
déférence : dans sa Défense de la Sophonisbe, Donneau de Visé le
fustigera d’avoir tenu rigueur à Corneille de ne pas lui être venu lui
présenter sa pièce. Ou encore de l’abbé du Buisson, dont Somaize dit qu’il
est « un des introducteurs des ruelles et protecteur des jeux du cirque ». , et à 216216 qui je puis sans injustice donner
le nom d'obligeant, puisque, par une bonté naturelle, il loue indifféremment
tous les ouvrages qu'il voit et tous ceux que l'on lui montre en
particulier ; aussi dit-on de
lui dans le monde que l'on ne saurait connaître s'il dit la vérité et qu'il ne
fait point de jaloux, puisqu'il met tous les auteurs en même degré et qu'il loue
également leurs productions en public et en particulier, sans crainte de hasarder sa
gloire.
Cependant il est constant qu'il a
le goût fin et délicat, qu'il connaît bien les défauts de tout ce qu'il voit, et
qu'il n'estime pas tout ce qu'il approuve ou qu'il feint d'approuver.
— Ces critiques perpétuels et ces trop faciles admirateurs, repartit Ariste, portent 217217 les choses dans un excès qui doit être condamné. Les uns disent trop de mal, les autres trop de bien ; les uns blâment quelquefois ce qui est bon, et les autres louent ce qui est méchant ; et les uns et les autres obscurcissent tellement la vérité qu'il est impossible d'y rien connaître, lorsqu'ils se sont une fois mêlés de dire leur sentiment.
— Je crois, dit alors Straton, que c'est à mon tour de parler, et je ne prends
la parole que pour entretenir Pallante C’est le nom du
narrateur de la nouvelle des « Nouvellistes », qui est indique pour la
première et unique fois., dit-il en s'adressant à moi, de
l'auteur de L'École des maris, dont Clorante s'est malicieusement défendu de dire ce qu'il
savait. Je ne ferai point comme ceux dont on vient de parler, qui louent et qui
blâment excessivement. Je dirai la vérité, sans que ce fameux auteur
s'en 218218 doive offenser. Et certes il aurait grand tort de le faire,
puisqu'il fait profession ouverte de publier en plein théâtre
C’est le nom du
narrateur de la nouvelle des « Nouvellistes », qui est indique pour la
première et unique fois., dit-il en s'adressant à moi, de
l'auteur de L'École des maris, dont Clorante s'est malicieusement défendu de dire ce qu'il
savait. Je ne ferai point comme ceux dont on vient de parler, qui louent et qui
blâment excessivement. Je dirai la vérité, sans que ce fameux auteur
s'en 218218 doive offenser. Et certes il aurait grand tort de le faire,
puisqu'il fait profession ouverte de publier en plein théâtre Cf. La Critique de L’Ecole des femmes, où Molière
affirme que le but de la comédie est d’ »’entrer comme il faut dans le
ridicule des hommes, et de rendre agréablement sur le théâtre les
défauts de tout le monde » (sc. VI) et que « toutes les peintures
ridicules qu’on expose sur les théâtres doivent être regardées sans
chagrin de tout le monde. Ce sont miroirs publics » » (id.).
les vérités de tout le monde. Cette raison m'oblige à publier les siennes plus
librement que je ne ferais. Je n'irai point toutefois jusqu'à la satire, et tout
ce que je dirai sera tant soit peu plus à sa gloire qu'à son désavantage.
Cf. La Critique de L’Ecole des femmes, où Molière
affirme que le but de la comédie est d’ »’entrer comme il faut dans le
ridicule des hommes, et de rendre agréablement sur le théâtre les
défauts de tout le monde » (sc. VI) et que « toutes les peintures
ridicules qu’on expose sur les théâtres doivent être regardées sans
chagrin de tout le monde. Ce sont miroirs publics » » (id.).
les vérités de tout le monde. Cette raison m'oblige à publier les siennes plus
librement que je ne ferais. Je n'irai point toutefois jusqu'à la satire, et tout
ce que je dirai sera tant soit peu plus à sa gloire qu'à son désavantage.
Je dirai d'abord que, si son esprit ne l'avait pas rendu un des plus illustres
du siècle, je serais ridicule de vous en entretenir aussi longtemps et aussi
sérieusement que je vais faire, et que je mériterais d'être raillé. Mais comme
il peut passer pour le Térence de notre siècle L’idée est
dans l’air du temps. Elle est énoncée dans dans la « Lettre à
Maucroix » de La Fontaine (restée à l’état de manuscrit au XVIIe
siècle), ainsi que dans les « Stances sur L'Ecole des femmes » de Boileau. On la retrouvera dans La Guerre
comique de La Croix :« un esprit bien fait quoi qu’on die,/ Doit
admirer sa comédie,/ Et le prendre tout bien compté, /Pour Térence
ressuscité. » (p. 95), qu'il est grand auteur et grand
comédien lorsqu'il joue ses pièces, et que ceux qui ont excellé dans ces deux
219219 choses ont toujours eu place en l'histoire
L’idée est
dans l’air du temps. Elle est énoncée dans dans la « Lettre à
Maucroix » de La Fontaine (restée à l’état de manuscrit au XVIIe
siècle), ainsi que dans les « Stances sur L'Ecole des femmes » de Boileau. On la retrouvera dans La Guerre
comique de La Croix :« un esprit bien fait quoi qu’on die,/ Doit
admirer sa comédie,/ Et le prendre tout bien compté, /Pour Térence
ressuscité. » (p. 95), qu'il est grand auteur et grand
comédien lorsqu'il joue ses pièces, et que ceux qui ont excellé dans ces deux
219219 choses ont toujours eu place en l'histoire Peut-être Straton fait-il allusion à Livius Andronicus,
fondateur du théâtre romain, qui « donna publiquement dans Rome des
fables qu’il jouait lui-même » (d’Aubignac, Dissertation sur la
condamnation des théâtres, 1666, p. 167) ? Plaute qui, selon les recherches actuelles, aurait lui
aussi été acteur, ne semble pas pouvoir entrer ici en considération. Les
contemporains de Donneau ignorent, selon toute apparence, cette activité
du poète comique latin (voir, par exemple, la « Vie de Plaute », qui précède l’édition de ses comédies par Marolles en
1658). , je puis bien vous faire ici un abrégé de
l'abrégé de sa vie
Peut-être Straton fait-il allusion à Livius Andronicus,
fondateur du théâtre romain, qui « donna publiquement dans Rome des
fables qu’il jouait lui-même » (d’Aubignac, Dissertation sur la
condamnation des théâtres, 1666, p. 167) ? Plaute qui, selon les recherches actuelles, aurait lui
aussi été acteur, ne semble pas pouvoir entrer ici en considération. Les
contemporains de Donneau ignorent, selon toute apparence, cette activité
du poète comique latin (voir, par exemple, la « Vie de Plaute », qui précède l’édition de ses comédies par Marolles en
1658). , je puis bien vous faire ici un abrégé de
l'abrégé de sa vie La formule est inédite. Elle présente un
caractère ironique justifié par la nature particulière des propos
sur Molière qu’offrent les Nouvelles Nouvelles. et vous
entretenir de celui dont l'on s'entretient presque dans toute l'Europe, et qui
fait si souvent retourner à l'école tout ce qu'il y a de gens d'esprit à
Paris.
La formule est inédite. Elle présente un
caractère ironique justifié par la nature particulière des propos
sur Molière qu’offrent les Nouvelles Nouvelles. et vous
entretenir de celui dont l'on s'entretient presque dans toute l'Europe, et qui
fait si souvent retourner à l'école tout ce qu'il y a de gens d'esprit à
Paris.
Ce fameux auteur de L'École des maris, ayant eu dès sa jeunesse une inclination
toute particulière pour le théâtre, se jeta dans la comédie Le récit des origines que propose Straton fait l’impasse
complète sur la période de L’Illustre Théâtre (années 1643-1645) : ni le
premier établissement à Paris, ni la faillite de l’entreprise ne sont
mentionnés. , quoiqu'il se pût bien passer de cette
occupation et qu'il eût assez de bien pour vivre honorablement dans le monde. Il
fit quelque temps la comédie à la campagne et, quoiqu'il jouât fort mal
le sérieux
Le récit des origines que propose Straton fait l’impasse
complète sur la période de L’Illustre Théâtre (années 1643-1645) : ni le
premier établissement à Paris, ni la faillite de l’entreprise ne sont
mentionnés. , quoiqu'il se pût bien passer de cette
occupation et qu'il eût assez de bien pour vivre honorablement dans le monde. Il
fit quelque temps la comédie à la campagne et, quoiqu'il jouât fort mal
le sérieux Première apparition de cette idée dans un
document imprimé. Elle sera souvent reprise dans les années
suivantes. Voir
également plus bas, p. 221 et p. 230. et que dans le
comique il ne fût qu'une copie de Trivelin et de Scaramouche
Première apparition de cette idée dans un
document imprimé. Elle sera souvent reprise dans les années
suivantes. Voir
également plus bas, p. 221 et p. 230. et que dans le
comique il ne fût qu'une copie de Trivelin et de Scaramouche Donneau de Visé reprend une affirmation des Véritables
Précieuses de Somaize, que les Nouvelles Nouvelles contribueront à
transformer en lieu commun de la première réception des pièces de
Molière., il ne laissa pas que 220220 de devenir en peu
de temps, par son adresse et par son esprit, le chef de sa troupe et de
l'obliger à porter son nom
Donneau de Visé reprend une affirmation des Véritables
Précieuses de Somaize, que les Nouvelles Nouvelles contribueront à
transformer en lieu commun de la première réception des pièces de
Molière., il ne laissa pas que 220220 de devenir en peu
de temps, par son adresse et par son esprit, le chef de sa troupe et de
l'obliger à porter son nom La pratique n’est pas en
usage parmi les comédiens : « Si le séjour des républiques n’est pas le
fait des comédiens, le gouvernement républicain leur plaît fort entre
eux ; ils n’admettent point de supérieur, le nom seul les blesse ; ils
veulent tous être égaux et se nomment camarades » (Chappuzeau, Le
Théâtre français, 1674, III, 17). Aucun document ne confirme que les contemporains
désignaient la troupe de Molière autrement que par le nom de son
protecteur.. Cette troupe, ayant un chef si spirituel et si
adroit, effaça en peu de temps toutes les troupes de la campagne, et il n'y
avait point de comédiens dans les autres qui ne briguassent des places dans la
sienne.
La pratique n’est pas en
usage parmi les comédiens : « Si le séjour des républiques n’est pas le
fait des comédiens, le gouvernement républicain leur plaît fort entre
eux ; ils n’admettent point de supérieur, le nom seul les blesse ; ils
veulent tous être égaux et se nomment camarades » (Chappuzeau, Le
Théâtre français, 1674, III, 17). Aucun document ne confirme que les contemporains
désignaient la troupe de Molière autrement que par le nom de son
protecteur.. Cette troupe, ayant un chef si spirituel et si
adroit, effaça en peu de temps toutes les troupes de la campagne, et il n'y
avait point de comédiens dans les autres qui ne briguassent des places dans la
sienne.
Il fit des farces L’idée que le succès de Molière repose
sur sa pratique de la farce constituera un des
griefs les plus souvent énoncés par ses adversaires., qui
réussirent un peu plus que des farces et qui furent un peu plus estimées dans
toutes les villes que celles que les autres comédiens jouaient. Ensuite il
voulut faire une pièce en cinq actes et, les Italiens ne lui plaisant pas
seulement dans leur jeu, mais encore dans leurs comédies, il en fit une qu'il
tira de plusieurs des leurs, à laquelle il donna pour titre L'Étourdi ou
les 221221 Contretemps
L’idée que le succès de Molière repose
sur sa pratique de la farce constituera un des
griefs les plus souvent énoncés par ses adversaires., qui
réussirent un peu plus que des farces et qui furent un peu plus estimées dans
toutes les villes que celles que les autres comédiens jouaient. Ensuite il
voulut faire une pièce en cinq actes et, les Italiens ne lui plaisant pas
seulement dans leur jeu, mais encore dans leurs comédies, il en fit une qu'il
tira de plusieurs des leurs, à laquelle il donna pour titre L'Étourdi ou
les 221221 Contretemps L'Étourdi
ou les Contretemps a été proposé au public dès la première saison de la troupe
de Molière à Paris, au cours de l’hiver 1658-1659. Au moment où sont
publiées les Nouvelles Nouvelles, la comédie compte déjà une quarantaine
de représentations. Donneau désigne la pièce par le titre apparaissant
sur l’ouvrage imprimé et non par sa désignation d’usage
courant.. Ensuite il fit le Dépit amoureux
L'Étourdi
ou les Contretemps a été proposé au public dès la première saison de la troupe
de Molière à Paris, au cours de l’hiver 1658-1659. Au moment où sont
publiées les Nouvelles Nouvelles, la comédie compte déjà une quarantaine
de représentations. Donneau désigne la pièce par le titre apparaissant
sur l’ouvrage imprimé et non par sa désignation d’usage
courant.. Ensuite il fit le Dépit amoureux Le Dépit amoureux, joué une
cinquantaine de fois entre 1658 et 1663, est également une pièce
figurant au répertoire de la troupe de Molière dès son établissement à
Paris., qui valait beaucoup moins que la première, mais qui
réussit toutefois à cause d'une scène qui plut à tout le monde et qui fut vue
comme un tableau naturellement représenté de certains dépits qui prennent souvent à ceux qui
s'aiment le mieux. Et, après avoir fait jouer ces deux pièces à la campagne, il
voulut les faire voir à Paris, où il emmena sa troupe.
Le Dépit amoureux, joué une
cinquantaine de fois entre 1658 et 1663, est également une pièce
figurant au répertoire de la troupe de Molière dès son établissement à
Paris., qui valait beaucoup moins que la première, mais qui
réussit toutefois à cause d'une scène qui plut à tout le monde et qui fut vue
comme un tableau naturellement représenté de certains dépits qui prennent souvent à ceux qui
s'aiment le mieux. Et, après avoir fait jouer ces deux pièces à la campagne, il
voulut les faire voir à Paris, où il emmena sa troupe.
Comme il avait de l'esprit et qu'il savait ce qu'il fallait faire pour réussir,
il n'ouvrit son théâtre qu'après avoir fait plusieurs visites et
brigué
quantité d'approbateurs L’accusation trouve son origine
dans Les Véritables Précieuses (1660) de Somaize (voir p. 46 et 53). Dans le t. III des
Nouvelles Nouvelles, la pratique de la « brigue » dans les milieux
littéraires est dénoncé à plusieurs reprises (voir p. 194, 199,
203).. Il fut trouvé incapable de jouer aucunes pièces
sérieuses, mais l'estime que l'on commençait à avoir pour lui fut cause que l'on
le souffrit.
L’accusation trouve son origine
dans Les Véritables Précieuses (1660) de Somaize (voir p. 46 et 53). Dans le t. III des
Nouvelles Nouvelles, la pratique de la « brigue » dans les milieux
littéraires est dénoncé à plusieurs reprises (voir p. 194, 199,
203).. Il fut trouvé incapable de jouer aucunes pièces
sérieuses, mais l'estime que l'on commençait à avoir pour lui fut cause que l'on
le souffrit.
Après avoir quelque 222222 temps joué de vieilles pièces et s'être en quelque façon établi à Paris, il joua son Étourdi et son Dépit amoureux, qui réussirent autant par la préoccupation que l'on commençait à avoir pour lui que par les applaudissements qu'il reçut de ceux qu'il avait priés de les venir voir.
Après le succès de ces deux pièces, son théâtre commença à se trouver continuellement rempli de gens de qualité, non pas tant pour le divertissement qu'ils y prenaient (car l'on n'y jouait que de vieilles pièces), que parce que, le monde ayant pris l'habitude d'y aller, ceux qui aimaient la compagnie et qui aimaient à se faire voir y trouvaient amplement de quoi se contenter. Ainsi l'on y venait par coutume, sans dessein d'écouter la comédie et 223223 sans savoir ce que l'on y jouait.
Pendant cela, notre auteur fit réflexion sur ce qui se passait dans le monde, et
surtout parmi les gens de qualité, pour en reconnaître les défauts. Mais comme
il n'était encore ni assez hardi pour entreprendre une satire, ni assez capable
pour en venir à bout, il eut recours aux Italiens, ses bons amis, et
accommoda les précieuses au théâtre français, qui avaient été
jouées sur le leur L’accusation avait été
formulée par Somaize dans Les Véritables Précieuses. et qui
leur avaient été données par un abbé des plus galants
L’accusation avait été
formulée par Somaize dans Les Véritables Précieuses. et qui
leur avaient été données par un abbé des plus galants L’abbé de Pure, auteur de La Précieuse (1656). Le qualificatif d’abbé galant est ici mis au service
de la désignation d’un individu. . Il les habilla
admirablement bien à la française et la réussite qu'elles eurent lui fit
connaître que l'on aimait la satire et la bagatelle
L’abbé de Pure, auteur de La Précieuse (1656). Le qualificatif d’abbé galant est ici mis au service
de la désignation d’un individu. . Il les habilla
admirablement bien à la française et la réussite qu'elles eurent lui fit
connaître que l'on aimait la satire et la bagatelle Le
terme sera utilisé à plusieurs reprises au début des années 1660
pour disqualifier les pièces de Molière.. Il connut par là
les goûts du siècle, il vit bien qu'il était malade et que les bonnes choses ne
lui plaisaient 224224 pas.
Le
terme sera utilisé à plusieurs reprises au début des années 1660
pour disqualifier les pièces de Molière.. Il connut par là
les goûts du siècle, il vit bien qu'il était malade et que les bonnes choses ne
lui plaisaient 224224 pas.
Il apprit que les gens de qualité ne voulaient rire qu'à leurs dépens, qu'ils
voulaient que l'on fît voir leurs défauts en public, qu'ils étaient les plus
dociles du monde et qu'ils auraient été bons du temps où l'on faisait pénitence
à la porte des temples, puisque, loin de se fâcher de ce que l'on
publiait leurs
sottises, ils s'en glorifiaient Le phénomène sera à
nouveau décrit dans Zélinde de Donneau de Visé (« n’est-ce pas une chose étrange, que
des gens de qualité souffrent que l’on les joue en plein Théâtre, et
qu’ils aillent admirer les portraits de leurs actions les plus ridicules ? », sc. III) et dans Le Portrait du peintre de Boursault (« J’en sais vingt trop heureux de se laisser
jouer / Oui, j’en sais de ravis qu’on leur fasse la guerre / Témoins
trois l’autre jour qu’on nommait du parterre, / Et qui dans une loge où
chacun les voyait / Riaient comme des fous de ce qu’on les jouait. », p. 21). . Et de fait, après que l'on eut joué Les Précieuses,
où ils étaient et bien représentés et bien raillés, ils donnèrent
eux-mêmes
Le phénomène sera à
nouveau décrit dans Zélinde de Donneau de Visé (« n’est-ce pas une chose étrange, que
des gens de qualité souffrent que l’on les joue en plein Théâtre, et
qu’ils aillent admirer les portraits de leurs actions les plus ridicules ? », sc. III) et dans Le Portrait du peintre de Boursault (« J’en sais vingt trop heureux de se laisser
jouer / Oui, j’en sais de ravis qu’on leur fasse la guerre / Témoins
trois l’autre jour qu’on nommait du parterre, / Et qui dans une loge où
chacun les voyait / Riaient comme des fous de ce qu’on les jouait. », p. 21). . Et de fait, après que l'on eut joué Les Précieuses,
où ils étaient et bien représentés et bien raillés, ils donnèrent
eux-mêmes Les modalités de cette collaboration du
public, entre autres par le biais de mémoires, sont expliquées p. 226-228., avec beaucoup d'empressement, à l'auteur dont je
vous entretiens, des mémoires de tout ce qui se passait dans le monde et
des portraits de leurs propres défauts et de ceux de leurs meilleurs amis,
croyant qu'il y avait de la gloire pour eux que 225225 l'on reconnût
leurs impertinences dans ses
ouvrages et que l'on dît même qu'il avait voulu parler d'eux. Car vous saurez
qu'il y a de certains défauts de qualité dont ils font gloire et qu'ils seraient bien fâchés que
l'on crût qu'ils ne les eussent pas.
Les modalités de cette collaboration du
public, entre autres par le biais de mémoires, sont expliquées p. 226-228., avec beaucoup d'empressement, à l'auteur dont je
vous entretiens, des mémoires de tout ce qui se passait dans le monde et
des portraits de leurs propres défauts et de ceux de leurs meilleurs amis,
croyant qu'il y avait de la gloire pour eux que 225225 l'on reconnût
leurs impertinences dans ses
ouvrages et que l'on dît même qu'il avait voulu parler d'eux. Car vous saurez
qu'il y a de certains défauts de qualité dont ils font gloire et qu'ils seraient bien fâchés que
l'on crût qu'ils ne les eussent pas.
Notre auteur, ayant derechef connu ce qu'ils aimaient, vit bien qu'il fallait
qu'il s'accommodât au temps ; ce qu'il a si bien fait depuis, qu'il en a mérité
toutes les louanges que l'on a jamais données aux plus grands auteurs. Jamais
homme ne s'est si bien su servir de l'occasion La formule
sera reprise à la p. 237. La Guerre comique (1663) de La Croix placera cette idée dans la bouche d’un
des personnages : « Qui aurait pu s’imaginer que le comique dût
supplanter le sérieux ? Molière est heureux et c’est tout. - Il peut
bien se servir de l’occasion ; la fortune ne lui rira pas toujours » (p. 88)., jamais homme n'a su si naturellement décrire ni
représenter les actions humaines et jamais homme n'a su si bien faire son profit
des conseils d'autrui.
La formule
sera reprise à la p. 237. La Guerre comique (1663) de La Croix placera cette idée dans la bouche d’un
des personnages : « Qui aurait pu s’imaginer que le comique dût
supplanter le sérieux ? Molière est heureux et c’est tout. - Il peut
bien se servir de l’occasion ; la fortune ne lui rira pas toujours » (p. 88)., jamais homme n'a su si naturellement décrire ni
représenter les actions humaines et jamais homme n'a su si bien faire son profit
des conseils d'autrui.
Il fit, après Les Précieuses, Le Cocu imaginaire, qui 226226 est, à mon
sentiment et à celui de beaucoup d'autres, la meilleure de toutes ses pièces et
la mieux écrite. Je ne vous en entretiendrai pas davantage et je me contenterai
de vous faire savoir que vous en apprendrez beaucoup plus que je ne vous en
pourrais dire, si vous voulez prendre la peine de lire la prose que vous
trouverez dans l'imprimé au-dessus de chaque scène Donneau
de Visé en est l’auteur (voir Molière, Œuvres complètes, Paris,
Gallimard, 2010, vol. I, p. 1230), raison pour laquelle il présente
Le Cocu imaginaire comme la meilleure
pièce de Molière (voir l’éloge qu’il en fait dans l’épître « A un
ami » placée au début de son édition de la
pièce)..
Donneau
de Visé en est l’auteur (voir Molière, Œuvres complètes, Paris,
Gallimard, 2010, vol. I, p. 1230), raison pour laquelle il présente
Le Cocu imaginaire comme la meilleure
pièce de Molière (voir l’éloge qu’il en fait dans l’épître « A un
ami » placée au début de son édition de la
pièce)..
Notre auteur, ou, pour ne pas répéter ce mot si souvent, le héros de ce petit récit, après avoir fait cette pièce, reçut des gens de qualité plus de mémoires que jamais, dont l'on le pria de se servir dans celles qu'il devait faire ensuite, et je le vis bien embarrassé, un soir, après la comédie, qui cherchait partout des tablettes pour écrire ce que lui 227227 disaient plusieurs personnes de condition dont il était environné ; tellement que l'on peut dire qu'il travaillait sous les gens de qualité, pour leur apprendre après à vivre à leurs dépens, et qu'il était en ce temps, et est encore présentement, leur écolier et leur maître tout ensemble.
Ces messieurs lui donnent souvent à dîner, pour avoir le temps de l'instruire, en dînant, de tout ce qu'ils veulent lui faire mettre dans ses pièces. Mais comme ceux qui croient avoir du mérite ne manquent jamais de vanité, il rend tous les repas qu'il reçoit, son esprit le faisant aller de pair avec beaucoup de gens qui sont beaucoup au-dessus de lui. L'on ne doit point après cela s'étonner pourquoi l'on voit tant de monde à ses pièces : 228228 tous ceux qui lui donnent des mémoires veulent voir s'il s'en sert bien. Tel y va pour un vers, tel pour un demi-vers, tel pour un mot et tel pour une pensée dont il l'aura prié de se servir, ce qui fait croire justement que la quantité d'auditeurs intéressés qui vont voir ses pièces les font réussir, et non pas leur bonté toute seule, comme quelques-uns se persuadent.
L'École des maris fut celle qui sortit de sa plume après Le Cocu imaginaire.
C'est encore un de ces tableaux des choses que l'on voit le plus fréquemment
arriver dans le monde, ce qui a fait qu'elle n'a pas été moins suivie que les
précédentes. Les vers en sont moins bons que ceux du Cocu imaginaire, mais le
sujet en est tout à fait bien conduit et, si cette pièce 229229 avait eu
cinq actes, elle pourrait tenir rang dans la postérité après Le Menteur et
Les Visionnaires Ces deux pièces sont des classiques du
répertoire de la troupe de Molière. Le Menteur de Corneille sera joué à
vingt-trois reprises entre 1659 et 1666. Les Visionnaires de Desmarets
de Saint-Sorlin seront proposés au public vingt fois durant la même
période..
Ces deux pièces sont des classiques du
répertoire de la troupe de Molière. Le Menteur de Corneille sera joué à
vingt-trois reprises entre 1659 et 1666. Les Visionnaires de Desmarets
de Saint-Sorlin seront proposés au public vingt fois durant la même
période..
Notre auteur, après avoir fait ces deux pièces, reçut des mémoires en telle confusion que, de ceux qui lui restaient et de ceux qu'il recevait tous les jours, il en aurait eu de quoi travailler toute sa vie, s'il ne se fût avisé, pour satisfaire les gens de qualité et pour les railler ainsi qu'ils le souhaitaient, de faire une pièce où il pût mettre quantité de leurs portraits. Il fit donc la comédie des Fâcheux, dont le sujet est autant méchant que l'on puisse imaginer, et qui ne doit pas être appelée une pièce de théâtre. Ce n'est qu'un amas de portraits détachés et tirés de ces mémoires, mais qui sont si naturellement représentés, si bien tou-230230chés et si bien finis, qu'il en a mérité beaucoup de gloire. Et ce qui fait voir que les gens de qualité sont non seulement bien aises d'être raillés, mais qu'ils souhaitent que l'on connaisse que c'est d'eux que l'on parle, c'est qu'il s'en trouvait qui faisaient en plein théâtre, lorsque l'on les jouait, les mêmes actions que les comédiens faisaient pour les contrefaire.
Le peu de succès qu'a eu son Don Garcie ou le Prince jaloux Don Garcie de Navarre est la seule des pièces
de Molière évoquées jusqu’ici qui n’est pas disponible sous forme
imprimée en 1663, raison pour laquelle peut-être Donneau de Visé,
n’ayant pas assisté aux représentations, est dans l’incapacité d’en
parler. Son propos reprend les termes qui avaient été utilisés trois ans
auparavant dans Les Véritables Précieuses : « Ma foi si nous consultons son dessein il a prétendu
faire une pièce sérieuse ; mais si nous en consultons le sens commun,
c’est une fort méchante comédie ». m'a fait oublier de vous
en parler à son rang. Mais je crois qu'il suffit de vous dire que
c'était une pièce sérieuse et qu'il en avait le premier rôle pour vous faire
connaître que l'on ne s'y devait pas beaucoup divertir.
Don Garcie de Navarre est la seule des pièces
de Molière évoquées jusqu’ici qui n’est pas disponible sous forme
imprimée en 1663, raison pour laquelle peut-être Donneau de Visé,
n’ayant pas assisté aux représentations, est dans l’incapacité d’en
parler. Son propos reprend les termes qui avaient été utilisés trois ans
auparavant dans Les Véritables Précieuses : « Ma foi si nous consultons son dessein il a prétendu
faire une pièce sérieuse ; mais si nous en consultons le sens commun,
c’est une fort méchante comédie ». m'a fait oublier de vous
en parler à son rang. Mais je crois qu'il suffit de vous dire que
c'était une pièce sérieuse et qu'il en avait le premier rôle pour vous faire
connaître que l'on ne s'y devait pas beaucoup divertir.
La dernière de ses comédies, et celle dont vous souhaitez le plus que 231231 je vous entretienne, parce que c'est celle qui fait le plus
de bruit L’Ecole des femmes occasionne une
querelle. Au printemps 1663 toutefois aucun des textes produits à
cette occasion n’a encore paru. Donneau de Visé invoque ici des
réactions qui ne sont pas encore traduites dans l’imprimé.,
s'appelle L'École des femmes. Cette pièce a cinq actes. Tous ceux qui l'ont vue
sont demeurés d'accord qu'elle est mal nommée
L’Ecole des femmes occasionne une
querelle. Au printemps 1663 toutefois aucun des textes produits à
cette occasion n’a encore paru. Donneau de Visé invoque ici des
réactions qui ne sont pas encore traduites dans l’imprimé.,
s'appelle L'École des femmes. Cette pièce a cinq actes. Tous ceux qui l'ont vue
sont demeurés d'accord qu'elle est mal nommée Cf. Zélinde : « Son auteur a avoué lui-même que ce nom ne lui convient
point et qu’il ne l’a nommée ainsi que pour attirer le monde, en
l’éblouissant par un nom spécieux.« Dans la même pièce, l’argument est
repris à propos de La Critique de L’Ecole des femmes : « Puisque vous
voulez savoir mon sentiment touchant La Critique de l’École des femmes,
du fameux Élomire, je vous dirai d’abord, que cette pièce est mal
nommée, et que c’est la défense, et non La Critique de l’École des
femmes » et que c'est plutôt L'École des maris que L'École
des femmes. Mais comme il en a déjà fait une sous ce titre, il n'a pu lui donner
le même nom. Elles ont beaucoup de rapport ensemble et, dans la première, il
garde une femme dont il veut faire son épouse qui, bien qu'il la croie
ignorante, en sait plus qu'il ne croit, ainsi que l'Agnès de la dernière, qui
joue, aussi bien que lui, le même personnage et dans L'École des maris et dans
L'École des femmes ; et toute la différence que l'on y trouve, c'est que l'Agnès
de L'École des femmes est 232232 un peu plus sotte et plus ignorante que
l'Isabelle de L'École des maris.
Cf. Zélinde : « Son auteur a avoué lui-même que ce nom ne lui convient
point et qu’il ne l’a nommée ainsi que pour attirer le monde, en
l’éblouissant par un nom spécieux.« Dans la même pièce, l’argument est
repris à propos de La Critique de L’Ecole des femmes : « Puisque vous
voulez savoir mon sentiment touchant La Critique de l’École des femmes,
du fameux Élomire, je vous dirai d’abord, que cette pièce est mal
nommée, et que c’est la défense, et non La Critique de l’École des
femmes » et que c'est plutôt L'École des maris que L'École
des femmes. Mais comme il en a déjà fait une sous ce titre, il n'a pu lui donner
le même nom. Elles ont beaucoup de rapport ensemble et, dans la première, il
garde une femme dont il veut faire son épouse qui, bien qu'il la croie
ignorante, en sait plus qu'il ne croit, ainsi que l'Agnès de la dernière, qui
joue, aussi bien que lui, le même personnage et dans L'École des maris et dans
L'École des femmes ; et toute la différence que l'on y trouve, c'est que l'Agnès
de L'École des femmes est 232232 un peu plus sotte et plus ignorante que
l'Isabelle de L'École des maris.
Le sujet de ces deux pièces n'est point de son invention  Donneau de Visé étend à L’Ecole des femmes l’accusation de plagiat
formulée dans Les Véritables Précieuses de Somaize à propos des
Précieuses ridicules (voir plus haut p. 223-224). Les indications qui
suivent sur les sources de la pièce seront reprises dans
Zélinde (« Pour ce qui est de L’École des femmes, tout le monde
sait bien qu’Élomire n’a rien mis de lui dans le sujet, que La
Précaution inutile lui en a fourni les premières idées ») et dans
La Guerre comique de Lacroix (p. 78-79). Des accusations semblables seront
formulées dans Le Panégyrique de L'Ecole des femmes de Robinet (p. 52-53)., il est tiré de divers
endroits, à savoir de Boccace, des contes de d’Ouville, de La Précaution inutile
de Scarron. Et ce qu'il y a de plus beau dans la dernière est tiré d'un livre
intitulé Les Nuits facétieuses du seigneur Straparole, dans une histoire duquel
un rival vient tous les jours faire confidence à son ami, sans savoir qu'il est
son rival, des faveurs qu'il obtient de sa maîtresse, ce qui fait tout le sujet
et la beauté de L'École des femmes.
Donneau de Visé étend à L’Ecole des femmes l’accusation de plagiat
formulée dans Les Véritables Précieuses de Somaize à propos des
Précieuses ridicules (voir plus haut p. 223-224). Les indications qui
suivent sur les sources de la pièce seront reprises dans
Zélinde (« Pour ce qui est de L’École des femmes, tout le monde
sait bien qu’Élomire n’a rien mis de lui dans le sujet, que La
Précaution inutile lui en a fourni les premières idées ») et dans
La Guerre comique de Lacroix (p. 78-79). Des accusations semblables seront
formulées dans Le Panégyrique de L'Ecole des femmes de Robinet (p. 52-53)., il est tiré de divers
endroits, à savoir de Boccace, des contes de d’Ouville, de La Précaution inutile
de Scarron. Et ce qu'il y a de plus beau dans la dernière est tiré d'un livre
intitulé Les Nuits facétieuses du seigneur Straparole, dans une histoire duquel
un rival vient tous les jours faire confidence à son ami, sans savoir qu'il est
son rival, des faveurs qu'il obtient de sa maîtresse, ce qui fait tout le sujet
et la beauté de L'École des femmes.
Cette pièce a produit des effets tout nouveaux, tout le monde l'a trouvée
méchante et tout le
monde y a couru Idée qui apparaissait déjà dans le
compte-rendu de Loret : « Pièce, dont Molière est auteur, Et, même, principal
acteur, Pièce qu’en plusieurs lieux on fronde ; Mais où pourtant va tant
de monde, » . Les dames l'ont blâmée et l'ont été voir.
233233 Elle a réussi sans avoir plu et elle a plu à plusieurs qui ne
l'ont pas trouvée bonne. Mais, pour vous en dire mon sentiment, c'est le sujet
le plus mal conduit qui fût jamais et je suis prêt de soutenir qu'il n'y a point
de scène où l'on ne puisse faire voir une infinité de fautes
Idée qui apparaissait déjà dans le
compte-rendu de Loret : « Pièce, dont Molière est auteur, Et, même, principal
acteur, Pièce qu’en plusieurs lieux on fronde ; Mais où pourtant va tant
de monde, » . Les dames l'ont blâmée et l'ont été voir.
233233 Elle a réussi sans avoir plu et elle a plu à plusieurs qui ne
l'ont pas trouvée bonne. Mais, pour vous en dire mon sentiment, c'est le sujet
le plus mal conduit qui fût jamais et je suis prêt de soutenir qu'il n'y a point
de scène où l'on ne puisse faire voir une infinité de fautes La sc. VI de La Critique de l’Ecole des femmes
sera en partie consacrée à la déclinaison de ces fautes et à la
dénonciation des erreurs de « conduite »de la pièce. Les commentaires
sur ces « fautes » alimenteront les pièces de la « querelle »..
La sc. VI de La Critique de l’Ecole des femmes
sera en partie consacrée à la déclinaison de ces fautes et à la
dénonciation des erreurs de « conduite »de la pièce. Les commentaires
sur ces « fautes » alimenteront les pièces de la « querelle »..
Je suis toutefois obligé d'avouer, pour rendre justice à ce que son auteur a de
mérite, que cette pièce
est un monstre qui a de belles parties et que jamais l'on ne vit tant de si
bonnes et de si méchantes
choses ensemble. Il y en a de si naturelles Les lignes qui
suivent replient l’éloge de L’Ecole des femmes sur la principale qualité
que valorise l’esthétique mondaine : le naturel. qu'il semble
que la nature ait elle-même travaillé à les faire. Il y a des endroits qui sont
inimitables et qui sont si bien exprimés que je manque de termes assez forts et
assez significatifs pour vous les bien faire con-234234cevoir. Il n'y a
personne au monde qui les pût si bien exprimer, à moins qu'il n'eût son
génie, quand
il serait un siècle à les tourner. Ce sont des portraits de la nature qui peuvent
passer pour originaux. Il semble qu'elle y parle elle-même. Ces endroits ne se
rencontrent pas seulement dans ce que joue Agnès, mais dans les rôles de tous
ceux qui jouent à cette pièce. Jamais comédie ne fut si bien représentée, ni
avec tant d'art : chaque acteur sait combien il y doit faire de pas
Les lignes qui
suivent replient l’éloge de L’Ecole des femmes sur la principale qualité
que valorise l’esthétique mondaine : le naturel. qu'il semble
que la nature ait elle-même travaillé à les faire. Il y a des endroits qui sont
inimitables et qui sont si bien exprimés que je manque de termes assez forts et
assez significatifs pour vous les bien faire con-234234cevoir. Il n'y a
personne au monde qui les pût si bien exprimer, à moins qu'il n'eût son
génie, quand
il serait un siècle à les tourner. Ce sont des portraits de la nature qui peuvent
passer pour originaux. Il semble qu'elle y parle elle-même. Ces endroits ne se
rencontrent pas seulement dans ce que joue Agnès, mais dans les rôles de tous
ceux qui jouent à cette pièce. Jamais comédie ne fut si bien représentée, ni
avec tant d'art : chaque acteur sait combien il y doit faire de pas Dans les arguments accompagnant la version imprimée du
Cocu imaginaire, Donneau de Visé
avait déjà attiré l’attention sur le jeu théâtral du comédien Molière.
Mais l’éloge formulé ici est remarquable par sa nouveauté : c’est la
première fois, dans l’histoire du théâtre français, qu’une direction
d’acteurs fait l’objet d’un discours d’évaluation spécifique. Les
compétences de Molière comme metteur en scène seront à nouveau relevées
plus bas, p. 235. et toutes ses œillades
sont comptées.
Dans les arguments accompagnant la version imprimée du
Cocu imaginaire, Donneau de Visé
avait déjà attiré l’attention sur le jeu théâtral du comédien Molière.
Mais l’éloge formulé ici est remarquable par sa nouveauté : c’est la
première fois, dans l’histoire du théâtre français, qu’une direction
d’acteurs fait l’objet d’un discours d’évaluation spécifique. Les
compétences de Molière comme metteur en scène seront à nouveau relevées
plus bas, p. 235. et toutes ses œillades
sont comptées.
Après le succès de cette pièce, on peut dire que son auteur mérite beaucoup de louanges pour avoir choisi, entre tous les sujets que Straparole lui fournissait, celui qui venait le mieux au temps, 235235 pour s'être servi à propos des mémoires que l'on lui donne tous les jours, pour n'en avoir tiré que ce qu'il fallait et l'avoir si bien mis en vers et si bien cousu à son sujet, pour avoir si bien joué son rôle, pour avoir si judicieusement distribué tous les autres et pour avoir enfin pris le soin de faire si bien jouer ses compagnons que l'on peut dire que tous les acteurs qui jouent dans sa pièce sont des originaux que les plus habiles maîtres de ce bel art pourront difficilement imiter.
— Tout ce que vous venez de dire est véritable, repartit Clorante ; mais si vous
voulez savoir pourquoi presque dans toutes ses pièces il raille tant les cocus
et dépeint si naturellement les jaloux, c'est qu'il est du nombre de ces
derniers Première occurrence d’une plaisanterie, qui
sera ensuite reprise dans Elomire hypocondre en 1670 : Molière est
tellement habile à représenter au naturel le cocuage et la jalousie
qu’il a forcément vécu dans sa chair les affres de ces tourments. Ce
n’est qu’à partir de 1676 (factum de Guichard) que l’idée de
l’infidélité conjugale d’Armande Béjart prendra le tour d’une accusation
sérieuse et calomnieuse.. Ce 236236 n'est pas que je
ne doive dire, pour lui rendre justice, qu'il ne témoigne pas sa jalousie hors
du théâtre : il a trop de prudence et ne voudrait pas s'exposer à la raillerie publique.
Mais il voudrait faire en sorte, par le moyen de ses pièces, que tous les hommes
pussent devenir jaloux et témoigner leur jalousie sans être blâmés, afin de
pouvoir faire comme les autres et témoigner la sienne sans crainte d'être
raillé. Nous verrons dans peu, continua le même, une pièce de lui intitulée La
Critique de L'École des femmes, où il dit toutes les fautes que l'on reprend
dans sa pièce et les excuse en même temps
Première occurrence d’une plaisanterie, qui
sera ensuite reprise dans Elomire hypocondre en 1670 : Molière est
tellement habile à représenter au naturel le cocuage et la jalousie
qu’il a forcément vécu dans sa chair les affres de ces tourments. Ce
n’est qu’à partir de 1676 (factum de Guichard) que l’idée de
l’infidélité conjugale d’Armande Béjart prendra le tour d’une accusation
sérieuse et calomnieuse.. Ce 236236 n'est pas que je
ne doive dire, pour lui rendre justice, qu'il ne témoigne pas sa jalousie hors
du théâtre : il a trop de prudence et ne voudrait pas s'exposer à la raillerie publique.
Mais il voudrait faire en sorte, par le moyen de ses pièces, que tous les hommes
pussent devenir jaloux et témoigner leur jalousie sans être blâmés, afin de
pouvoir faire comme les autres et témoigner la sienne sans crainte d'être
raillé. Nous verrons dans peu, continua le même, une pièce de lui intitulée La
Critique de L'École des femmes, où il dit toutes les fautes que l'on reprend
dans sa pièce et les excuse en même temps la formule
semble confirmer que le contenu de La Critique de L’Ecole des
femmes est connu de Donneau de Visé. Néanmoins la pièce, qui sera
créée le 1er juin, est annoncée au futur..
la formule
semble confirmer que le contenu de La Critique de L’Ecole des
femmes est connu de Donneau de Visé. Néanmoins la pièce, qui sera
créée le 1er juin, est annoncée au futur..
— Elle n'est pas de lui, repartit Straton, elle est de l'abbé Du
Buisson Dans la préface
de L’Ecole des femmes, parue le 17 mars, Molière donne de l’épisode un
récit concordant, mais légèrement différent, et s’abstient de nommer
l’auteur de la pièce inspiratrice de La Critique. Zélinde proposera encore une autre version de la genèse de la pièce
(« Cela n’empêche pas que vous n’ayez de grandes obligations au
Chevalier Doriste dont vous avez si bien tourné les vers en prose »),
laquelle sera reprise dans La Vengeance des marquis (p. 70). C’est uniquement dans les Nouvelles Nouvelles que
l’abbé du Buisson est désigné comme
auteur., qui est un des plus galants hommes du siècle.
237237
Dans la préface
de L’Ecole des femmes, parue le 17 mars, Molière donne de l’épisode un
récit concordant, mais légèrement différent, et s’abstient de nommer
l’auteur de la pièce inspiratrice de La Critique. Zélinde proposera encore une autre version de la genèse de la pièce
(« Cela n’empêche pas que vous n’ayez de grandes obligations au
Chevalier Doriste dont vous avez si bien tourné les vers en prose »),
laquelle sera reprise dans La Vengeance des marquis (p. 70). C’est uniquement dans les Nouvelles Nouvelles que
l’abbé du Buisson est désigné comme
auteur., qui est un des plus galants hommes du siècle.
237237
— J'avoue, lui répondit Clorante, que cet illustre abbé en a fait une et que, l'ayant portée à l'auteur dont nous parlons, il trouva des raisons pour ne la point jouer, encore qu'il avouât qu'elle fût bonne. Cependant, comme son esprit consiste principalement à se savoir bien servir de l'occasion, et que cette idée lui a plu, il a fait une pièce sur le même sujet, croyant qu'il était seul capable de se donner des louanges.
— Cette critique avantageuse, ou plutôt cette ingénieuse apologie de sa pièce,
répliqua Straton, ne la fera pas croire meilleure qu'elle est, et ce n'est pas
d'aujourd'hui que tout le monde est persuadé que l'on peut, et même avec quelque
sorte de succès, attaquer de beaux ouvrages et en défendre de mé-238238chants, et que
l'esprit paraît plus en défendant ce qui est méchant qu'en attaquant ce qui est
beau. C'est pourquoi l'auteur de L'École des femmes pourra, en défendant sa
pièce, donner d'amples preuves de son esprit. Je pourrais encore dire qu'il
connaît les ennemis qu'il a à combattre, qu'il sait l'ordre de la bataille,
qu'il ne les attaquera que par des endroits dont il sera sûr de sortir à son
honneur, et qu'il se mettra en état de ne recevoir aucun coup qu'il ne puisse
parer. Il sera, de plus, chef d'un des partis et juge du combat tout ensemble,
et ne manquera pas de favoriser les siens cf
Zélinde : « l’on n’y parle pas de la sixième partie des fautes que
l’on pourrait reprendre, et Lysidas l’attaque si faiblement que l’on
connaît bien que l’auteur parle par sa bouche« . Ces indications
confirment que Donneau de Visé a connaissance du contenu de La
Critique de L’Ecole des femmes.
C'est avoir autant d'adresse que d'esprit que d'agir de la sorte ; c'est
aller au-devant du coup, mais seulement pour le parer, ou 239239 plutôt,
c'est feindre de se maltraiter soi-même, pour éviter de l'être d'un autre, qui
pourrait frapper plus rudement.
cf
Zélinde : « l’on n’y parle pas de la sixième partie des fautes que
l’on pourrait reprendre, et Lysidas l’attaque si faiblement que l’on
connaît bien que l’auteur parle par sa bouche« . Ces indications
confirment que Donneau de Visé a connaissance du contenu de La
Critique de L’Ecole des femmes.
C'est avoir autant d'adresse que d'esprit que d'agir de la sorte ; c'est
aller au-devant du coup, mais seulement pour le parer, ou 239239 plutôt,
c'est feindre de se maltraiter soi-même, pour éviter de l'être d'un autre, qui
pourrait frapper plus rudement.
— Quoique cet auteur soit assez fameux, lui dis-je alors, pour obliger les
personnes d'esprit à parler de lui, c'est assez nous entretenir sur un même
sujet. J'avouerai toutefois, avant que de le quitter, que vous m'avez fait
concevoir beaucoup d'estime pour le peintre ingénieux de tant de beaux tableaux
du siècle. Tout ce que vous avez dit de lui m'a paru fort sincère, car vous
l'avez dit d'une manière à me faire croire que tout ce que vous avez dit à
sa gloire Donneau de Visé adoptera à nouveau une précaution
similaire à la fin de sa « Lettre sur les affaires du théâtre »
(p. 74-75) est véritable, et les ombres que vous avez
placées en quelques endroits de votre portrait n'ont fait que relever l'éclat de
vos couleurs. Et 240240 s'il vient à savoir tout ce que vous avez dit à
son avantage, il sera bien délicat s'il ne vous en est obligé, et je connais
beaucoup de personnes qui se tiendraient glorieuses que l'on pût dire d'elles ce que vous avez dit à sa
gloire.
Donneau de Visé adoptera à nouveau une précaution
similaire à la fin de sa « Lettre sur les affaires du théâtre »
(p. 74-75) est véritable, et les ombres que vous avez
placées en quelques endroits de votre portrait n'ont fait que relever l'éclat de
vos couleurs. Et 240240 s'il vient à savoir tout ce que vous avez dit à
son avantage, il sera bien délicat s'il ne vous en est obligé, et je connais
beaucoup de personnes qui se tiendraient glorieuses que l'on pût dire d'elles ce que vous avez dit à sa
gloire.
Mais pour nous entretenir d'autre chose, je vous prie de me dire ce que c'est que
Le Baron de la Crasse Comédie de Raymond Poisson
publiée le 13 mars 1662. Le nombre d’éditions pirates et de rééditions
répertoriées par Alain Riffaud
suggère effectivement le succès de la pièce. Pour expliquer cet encart
publicitaire, on peut rappeler que Donneau cherche alors à représenter
ses Coteaux ou les Marquis friands à l’Hôtel de
Bourgogne., car l'on en parle à la campagne beaucoup plus
que de toutes les pièces dont vous venez de m'entretenir .
Comédie de Raymond Poisson
publiée le 13 mars 1662. Le nombre d’éditions pirates et de rééditions
répertoriées par Alain Riffaud
suggère effectivement le succès de la pièce. Pour expliquer cet encart
publicitaire, on peut rappeler que Donneau cherche alors à représenter
ses Coteaux ou les Marquis friands à l’Hôtel de
Bourgogne., car l'on en parle à la campagne beaucoup plus
que de toutes les pièces dont vous venez de m'entretenir .
— Aussi, me repartit Clorante, est-ce un des plus plaisants et des plus beaux tableaux de
campagne que l'on puisse jamais voir, puisque c'est le portrait d'un baron
campagnard. O dieux ! s'écria-t-il en continuant, qu'il est naturellement
représenté dans cette pièce ! Aussi cette comé-241241die n'a-t-elle pas
fait comme celles qui éblouissaient d'abord L’éblouissement provoqué par la nouveauté fait partie des critiques
couramment formulées à son encontre. et qui ne laissent à
ceux qui les ont vues que le dépit d'avoir été trompés et de les avoir approuvées.
Plus on la voit, plus on la veut voir
L’éblouissement provoqué par la nouveauté fait partie des critiques
couramment formulées à son encontre. et qui ne laissent à
ceux qui les ont vues que le dépit d'avoir été trompés et de les avoir approuvées.
Plus on la voit, plus on la veut voir La capacité d’un
ouvrage à séduire de façon récurrente fait partie des critères
d’évaluation de la littérature. En 1670,
l’ambassadeur d’Angleterre en France départagera les
Bérénice de Corneille et Racine sur ce critère : « la
différence entre une honnête carrière et un grand succès tient au
phénomène de la seconde vision : tandis que Tite et
Bérénice faisait rapidement le plein des spectateurs
potentiels de Paris en 1670, Bérénice invitait ces mêmes
spectateurs à revenir plusieurs fois. » (G. Forestier dans Racine,
Œuvres complètes, Gallimard, « La Pléiade », 1999,
p. 1451-1452)., et quoique, depuis tantôt un an qu'elle est
faite, l'on l'ait jouée presque tous les jours de comédie, chaque représentation
y fait découvrir de nouvelles beautés, et si cet auteur continue comme il a
commencé, il y en aura peu qui le puissent égaler.
La capacité d’un
ouvrage à séduire de façon récurrente fait partie des critères
d’évaluation de la littérature. En 1670,
l’ambassadeur d’Angleterre en France départagera les
Bérénice de Corneille et Racine sur ce critère : « la
différence entre une honnête carrière et un grand succès tient au
phénomène de la seconde vision : tandis que Tite et
Bérénice faisait rapidement le plein des spectateurs
potentiels de Paris en 1670, Bérénice invitait ces mêmes
spectateurs à revenir plusieurs fois. » (G. Forestier dans Racine,
Œuvres complètes, Gallimard, « La Pléiade », 1999,
p. 1451-1452)., et quoique, depuis tantôt un an qu'elle est
faite, l'on l'ait jouée presque tous les jours de comédie, chaque représentation
y fait découvrir de nouvelles beautés, et si cet auteur continue comme il a
commencé, il y en aura peu qui le puissent égaler.
L'on dit, continua le même en haussant la voix La
précision a une fonction publicitaire. Elle invite à accorder une
attention maximale à la pièce de Donneau, aux dépens des précédentes
annonces., que l'on doit jouer un de ces jours une pièce à
l'Hôtel de Bourgogne, pleine de ces tableaux du temps, qui sont présentement en
grande estime. Elle est, à ce que l'on assure, de celui qui a fait les
Nouvelles Nou-242242velles
La
précision a une fonction publicitaire. Elle invite à accorder une
attention maximale à la pièce de Donneau, aux dépens des précédentes
annonces., que l'on doit jouer un de ces jours une pièce à
l'Hôtel de Bourgogne, pleine de ces tableaux du temps, qui sont présentement en
grande estime. Elle est, à ce que l'on assure, de celui qui a fait les
Nouvelles Nou-242242velles Il s’agit
des Coteaux ou les Marquis friands, petite comédie
finalement créée en 10 janvier 1665. L’annonce des Nouvelles
Nouvelles intervient donc prématurément, ce qui s’explique
probablement par une tentative de Donneau de Visé de forcer la main aux
comédiens de l’Hôtel de Bourgogne. Sur l’utilisation toute particulière
de la publicité théâtrale par Donneau de Visé, voir C. Schuwey,
Un entrepreneur des lettres au XVIIe siècle, Paris,
Classiques Garnier, 2020, p. 135-149. .
Il s’agit
des Coteaux ou les Marquis friands, petite comédie
finalement créée en 10 janvier 1665. L’annonce des Nouvelles
Nouvelles intervient donc prématurément, ce qui s’explique
probablement par une tentative de Donneau de Visé de forcer la main aux
comédiens de l’Hôtel de Bourgogne. Sur l’utilisation toute particulière
de la publicité théâtrale par Donneau de Visé, voir C. Schuwey,
Un entrepreneur des lettres au XVIIe siècle, Paris,
Classiques Garnier, 2020, p. 135-149. .
— Si elle est de lui, repartit Ariste, il n'a qu'à se bien tenir, et les nouvellistes ne l'épargneront non plus qu'il les a épargnés.
— Ce sera tant mieux pour lui, repartit Straton, et c'est ce qui fera réussir sa
pièce. Il voudrait que la moitié de Paris en vînt dire du mal, ce serait un
signe qu'elle ne serait pas tout à fait méchante, et que l'autre moitié en viendrait ensuite dire
du bien. Quand on veut fronder une comédie et que l'on en parle beaucoup, les
divers discours que l'on en tient y font venir du monde Commentaire similaire dans La Critique de l’Ecole des
femmes, sc. VI : « je
connais son humeur ; il ne se soucie pas qu’on fronde ses pièces, pourvu
qu’il y vienne du monde. » Le mécanisme décrit dans les lignes qui
suivent correspond précisément à la stratégie mise en place par Molière
avec L’Ecole des femmes et sa Critique
(voir l’article de G. Forestier et Cl. Bourqui). Il s’agit d’une manière nouvelle d’exploiter un principe
commercial plus général, celui de la concurrence. Dès 1629, les troupes
parisiennes programmèrent en effet simultanément des pièces rivales pour
créer un conflit et inviter les spectateurs à assister aux deux ouvrages
afin de les départager (voir S. Blondet, Les Pièces rivales des
répertoires de l’Hôtel de Bourgogne, du Théâtre du Marais et de
l’Illustre Théâtre, Paris, Champion, 2017)., et
ceux qui vont rarement à la comédie ne peuvent s'empêcher d'y aller, afin de
pouvoir parler d'une chose dont on les entretient si souvent, et afin de voir
qui a raison, ou de ceux qui blâment ou de ceux qui louent. Cependant, com243243me la foule qui se trouve à toutes les représentations d'une pièce
en fait la bonté, comme nous avons vu à L'École des femmes, l'on peut dire que
ceux qui ne vont voir les pièces que pour les blâmer et qui en parlent
continuellement sont cause qu'elles réussissent
Commentaire similaire dans La Critique de l’Ecole des
femmes, sc. VI : « je
connais son humeur ; il ne se soucie pas qu’on fronde ses pièces, pourvu
qu’il y vienne du monde. » Le mécanisme décrit dans les lignes qui
suivent correspond précisément à la stratégie mise en place par Molière
avec L’Ecole des femmes et sa Critique
(voir l’article de G. Forestier et Cl. Bourqui). Il s’agit d’une manière nouvelle d’exploiter un principe
commercial plus général, celui de la concurrence. Dès 1629, les troupes
parisiennes programmèrent en effet simultanément des pièces rivales pour
créer un conflit et inviter les spectateurs à assister aux deux ouvrages
afin de les départager (voir S. Blondet, Les Pièces rivales des
répertoires de l’Hôtel de Bourgogne, du Théâtre du Marais et de
l’Illustre Théâtre, Paris, Champion, 2017)., et
ceux qui vont rarement à la comédie ne peuvent s'empêcher d'y aller, afin de
pouvoir parler d'une chose dont on les entretient si souvent, et afin de voir
qui a raison, ou de ceux qui blâment ou de ceux qui louent. Cependant, com243243me la foule qui se trouve à toutes les représentations d'une pièce
en fait la bonté, comme nous avons vu à L'École des femmes, l'on peut dire que
ceux qui ne vont voir les pièces que pour les blâmer et qui en parlent
continuellement sont cause qu'elles réussissent Depuis le
début des années 1660, ce constat a été illustré à plusieurs reprises
par le phénomène Molière. Au moment de la parution des Nouvelles
Nouvelles, L’École des femmes en est le
meilleur exemple., puisque leurs discours obligent les
autres à les aller voir.
Depuis le
début des années 1660, ce constat a été illustré à plusieurs reprises
par le phénomène Molière. Au moment de la parution des Nouvelles
Nouvelles, L’École des femmes en est le
meilleur exemple., puisque leurs discours obligent les
autres à les aller voir.
— Tout ce que vous dites est véritable, lui repartit Arimant, et nous en voyons
tous les jours des exemples. Mais, pour changer de discours, je vous prie de me
dire si vous avez vu la Sophonisbe Par cette phrase débute
un long passage d’une trentaine de pages consacré à la « critique
de Sophonisbe ». La
nouvelle pièce de Corneille a été créée avant le 20
janvier 1663 : le compte-rendu de Loret, paru à cette date dans
La Muse historique, parle d’une oeuvre qui a déjà été présentée au public.
.
Par cette phrase débute
un long passage d’une trentaine de pages consacré à la « critique
de Sophonisbe ». La
nouvelle pièce de Corneille a été créée avant le 20
janvier 1663 : le compte-rendu de Loret, paru à cette date dans
La Muse historique, parle d’une oeuvre qui a déjà été présentée au public.
.
— Oui, répondit Clorante.
— Eh bien ! qu'en dites-vous ? repartit Arimant.
— Je la trouve… Mêmes réticences de Lysidas au début de la
sc. VI de La Critique de L’Ecole des femmes
(première représentation le 1er juin 1663) : « je n’ai rien à dire
là-dessus », « je la trouve fort belle ». répliqua Straton.
Il s'arrêta après avoir dit ces trois paroles.
Mêmes réticences de Lysidas au début de la
sc. VI de La Critique de L’Ecole des femmes
(première représentation le 1er juin 1663) : « je n’ai rien à dire
là-dessus », « je la trouve fort belle ». répliqua Straton.
Il s'arrêta après avoir dit ces trois paroles.
— Encore, qu'y trouvez-vous ? lui dit Arimant, en le pressant de dire son senti-244244ment.
— Je voudrais l'avoir vue encore une fois, repartit Straton, avant que de
vous dire ce que j'en pense Cette remarque introductive, de
même que la réponse d’Arimant, ainsi que d’autres passages du texte
(notamment p. 244-245) servent avant tout à présenter ce discours sur la
Sophonisbe comme une forme de critique
dramatique. En fondant son
propos sur l’expérience éprouvée par Straton, Donneau de Visé présente
cette critique comme une impression de spectateur mondain adressée aux
amateurs de théâtre, par opposition à un texte à vocation théorique
destiné aux doctes. En outre, le dialogue entre Straton et Arimant
inscrit le propos dans une pratique familière du lecteur mondain : les
deux interlocuteurs parlent de cette pièce comme on s’en entretiendrait
à la sortie du théâtre. .
Cette remarque introductive, de
même que la réponse d’Arimant, ainsi que d’autres passages du texte
(notamment p. 244-245) servent avant tout à présenter ce discours sur la
Sophonisbe comme une forme de critique
dramatique. En fondant son
propos sur l’expérience éprouvée par Straton, Donneau de Visé présente
cette critique comme une impression de spectateur mondain adressée aux
amateurs de théâtre, par opposition à un texte à vocation théorique
destiné aux doctes. En outre, le dialogue entre Straton et Arimant
inscrit le propos dans une pratique familière du lecteur mondain : les
deux interlocuteurs parlent de cette pièce comme on s’en entretiendrait
à la sortie du théâtre. .
— Pour moi, dit alors Arimant, l'on m'a dit qu'elle n'avait pas répondu à
l'attente que l'on en avait La mention d’un contexte
polémique (qu’il soit réel ou imaginaire) doit susciter l’intérêt du
lecteur. Donneau de Visé avait déjà eu recours à ce procédé dans les «
Arguments de chaque scène » du Cocu imaginaire afin de
susciter l’intérêt pour la pièce Molière et son édition (voir par
exemple l’argument de la scène X). .
La mention d’un contexte
polémique (qu’il soit réel ou imaginaire) doit susciter l’intérêt du
lecteur. Donneau de Visé avait déjà eu recours à ce procédé dans les «
Arguments de chaque scène » du Cocu imaginaire afin de
susciter l’intérêt pour la pièce Molière et son édition (voir par
exemple l’argument de la scène X). .
— L'on vous a, ma foi, dit vrai, répondit Straton. Mais comme elle vient de
Corneille, je ne vous en osais dire ce que j'en pensais, avant que de savoir
votre sentiment, ou du moins ce que l'on vous en a dit, de crainte de passer
pour ridicule en ne disant pas du bien de tout ce que fait un si fameux auteur,
et dont l'on doit, ce semble, admirer les pièces sans les examiner Le compte-rendu de Loret du 20 janvier se termine par la formule « Qui dit Corneille dit tout ». Sur
la « préoccupation » à l’égard des auteurs réputés, voir p.
179sq.., aussi bien que de juger de la
bonté de celles qu'il doit faire par le mérite de celles qu'il a faites.
Le compte-rendu de Loret du 20 janvier se termine par la formule « Qui dit Corneille dit tout ». Sur
la « préoccupation » à l’égard des auteurs réputés, voir p.
179sq.., aussi bien que de juger de la
bonté de celles qu'il doit faire par le mérite de celles qu'il a faites.
— Puisque vous l'avez vue, lui répliqua Arimant, et que, par ce que je 245245 vous ai dit que l'on m'avait rapporté, vous avez connu que vous ne vous êtes pas trompé, vous pouvez présentement nous découvrir ce que vous en pensez.
— Je le veux bien, répondit Straton ; après quoi il parla de la sorte.
Bien que vous m'ayez engagé Ici commence un deuxième
mouvement du texte, constitué par la critique de
Sophonisbe à proprement parler. Les louanges données
aux acteurs servent à la fois à démontrer que l’échec de la
représentation n’est pas dû à la troupe, mais également, à s’attirer les
bonnes grâce des comédiens de l’Hôtel de Bourgogne auxquels Donneau de
Visé doit prochainement confier deux pièces : Les Coteaux ou
les Marquis friands et La Mère
coquette.
à vous entretenir de la Sophonisbe, je vous en dirai néanmoins
peu de choses, ne voulant pas que ce discours passe pour des remarques
Ici commence un deuxième
mouvement du texte, constitué par la critique de
Sophonisbe à proprement parler. Les louanges données
aux acteurs servent à la fois à démontrer que l’échec de la
représentation n’est pas dû à la troupe, mais également, à s’attirer les
bonnes grâce des comédiens de l’Hôtel de Bourgogne auxquels Donneau de
Visé doit prochainement confier deux pièces : Les Coteaux ou
les Marquis friands et La Mère
coquette.
à vous entretenir de la Sophonisbe, je vous en dirai néanmoins
peu de choses, ne voulant pas que ce discours passe pour des remarques C’est précisément sous le titre de Remarques sur la
tragédie de Sophonisbe de Monsieur Corneille que d’Aubignac
fait paraître son jugement sur la pièce, à une date inconnue (le volume,
pourvu d’un privilège du 8 février 1663, ne comporte pas d’achevé
d’imprimer). Donneau présente sa démarche comme une alternative
ressortissant à un nouveau type de critique dramatique.
, mais bien pour des sentiments particuliers expliqués avec beaucoup de
confusion et conçus après avoir vu jouer cette pièce une fois seulement.
C’est précisément sous le titre de Remarques sur la
tragédie de Sophonisbe de Monsieur Corneille que d’Aubignac
fait paraître son jugement sur la pièce, à une date inconnue (le volume,
pourvu d’un privilège du 8 février 1663, ne comporte pas d’achevé
d’imprimer). Donneau présente sa démarche comme une alternative
ressortissant à un nouveau type de critique dramatique.
, mais bien pour des sentiments particuliers expliqués avec beaucoup de
confusion et conçus après avoir vu jouer cette pièce une fois seulement.
Je vous dirai donc, pour satisfaire à votre désir, que si cette comédie était
d'un autre que Corneille, elle serait trouvée très méchante, encore qu'il y ait des vers
inimitables, parce que, n'ayant 246246 point l'appui d'un nom si
avantageux, elle serait traitée avec beaucoup plus de rigueur Sur la préoccupation, voir p. 179sq., que l'on en blâmerait jusqu'aux beautés
et que l'on ne pourrait souffrir ce que l'on cherche à excuser, parce que l'on
sait qu'elle vient de Corneille et que l'on ne saurait se persuader qu'il puisse
mal faire, ce qui est cause que l'on croit rêver en voyant cette pièce et que
chacun a de la peine à se persuader si ses yeux et ses oreilles lui font un
fidèle rapport
Sur la préoccupation, voir p. 179sq., que l'on en blâmerait jusqu'aux beautés
et que l'on ne pourrait souffrir ce que l'on cherche à excuser, parce que l'on
sait qu'elle vient de Corneille et que l'on ne saurait se persuader qu'il puisse
mal faire, ce qui est cause que l'on croit rêver en voyant cette pièce et que
chacun a de la peine à se persuader si ses yeux et ses oreilles lui font un
fidèle rapport La primauté donnée à la représentation sur
le texte amène à considérer ce texte comme étant l’une des
premières critiques dramatiques. .
La primauté donnée à la représentation sur
le texte amène à considérer ce texte comme étant l’une des
premières critiques dramatiques. .
Mais, pour vous entretenir avec un peu d'ordre, je vais vous dire un mot de
chaque personnage et commencer par celui de Sophonisbe. Je crois vous devoir
dire, avant que de passer outre, que ce rôle, qui est le plus considérable de la
pièce, est joué par Mademoiselle Des Œillets Alix Faviot
(1620-1670). En 1663, elle est considérée comme la meilleure tragédienne
de France. Lors du relâche de Pâques 1662, elle était passée du Théâtre
du Marais, où elle venait de jouer le rôle de Viriate dans
Sertorius de Corneille, à l’Hôtel de Bourgogne, où
elle s’illustrera dans les tragédies de Racine (Axiane dans
Alexandre, Hermione dans Andromaque,
Agrippine dans Britannicus)., qui est une
des pre-247247mières actrices du monde et qui soutient bien la haute
réputation qu'elle s'est acquise depuis longtemps. Je ne lui donne point
d'éloges, parce que je ne lui en pourrais assez donner. Je me contenterai
seulement de dire qu'elle joue divinement ce rôle, et au-delà de tout ce que
l'on se peut imaginer, que Monsieur de Corneille lui en doit être obligé et que,
quand vous n'iriez voir cette pièce que pour voir jouer cette inimitable
comédienne, vous en sortiriez le plus satisfait du monde.
Alix Faviot
(1620-1670). En 1663, elle est considérée comme la meilleure tragédienne
de France. Lors du relâche de Pâques 1662, elle était passée du Théâtre
du Marais, où elle venait de jouer le rôle de Viriate dans
Sertorius de Corneille, à l’Hôtel de Bourgogne, où
elle s’illustrera dans les tragédies de Racine (Axiane dans
Alexandre, Hermione dans Andromaque,
Agrippine dans Britannicus)., qui est une
des pre-247247mières actrices du monde et qui soutient bien la haute
réputation qu'elle s'est acquise depuis longtemps. Je ne lui donne point
d'éloges, parce que je ne lui en pourrais assez donner. Je me contenterai
seulement de dire qu'elle joue divinement ce rôle, et au-delà de tout ce que
l'on se peut imaginer, que Monsieur de Corneille lui en doit être obligé et que,
quand vous n'iriez voir cette pièce que pour voir jouer cette inimitable
comédienne, vous en sortiriez le plus satisfait du monde.
Mais pour passer de cette actrice à ce qu'elle représente, je vous dirai que
Sophonisbe n'a point de caractère parfait dans cette pièce, qu'elle explique ses sentiments
avec beaucoup de confusion, qu'on ne la saurait connaître, qu'on ne 248248 sait si
c'est l'amour ou l'ambition ou la crainte du triomphe qui la font agir, ce qui
fait que l'auditeur ne saurait entrer dans ses intérêts Même observation dans les Remarques de d’Aubignac (« les
spectateurs n’en sont point émus », p. 13). Or « c’est une maxime infaillible que, pour bien réussir,
il faut intéresser l’auditoire pour les premiers acteurs » (Corneille,
« Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique » (1660), éd.
B. Louvat et M. Escola, GF-Flammarion, 1999, p. 81).Donneau, par les
propos de Straton, traduit un sentiment qu’ont pu éprouver les
spectateurs de la Sophonisbe de Corneille face à la
singularité de son héroïne, dont les motivations s’écartaient de ce qui
était défini par la tradition du sujet., qu'il ne saurait
prendre son parti ni se déclarer entièrement contre elle. Cependant, outre que
de semblables pièces ne sont jamais bonnes, elles ne divertissent jamais les
auditeurs : ils veulent ou aimer, ou haïr, ou plaindre quelqu'un, et si l'on ne
trouve moyen de les attacher, de leur faire prendre parti dans une pièce et de
leur faire, pour ainsi dire, jouer en eux-mêmes un rôle muet qui les occupe, qui
les rende attentifs et qui leur fasse toujours souhaiter d'apprendre ce que
deviendront ceux qu'ils plaignent ou ceux qu'ils haïssent, il est bien difficile
qu'une pièce réussisse.
Même observation dans les Remarques de d’Aubignac (« les
spectateurs n’en sont point émus », p. 13). Or « c’est une maxime infaillible que, pour bien réussir,
il faut intéresser l’auditoire pour les premiers acteurs » (Corneille,
« Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique » (1660), éd.
B. Louvat et M. Escola, GF-Flammarion, 1999, p. 81).Donneau, par les
propos de Straton, traduit un sentiment qu’ont pu éprouver les
spectateurs de la Sophonisbe de Corneille face à la
singularité de son héroïne, dont les motivations s’écartaient de ce qui
était défini par la tradition du sujet., qu'il ne saurait
prendre son parti ni se déclarer entièrement contre elle. Cependant, outre que
de semblables pièces ne sont jamais bonnes, elles ne divertissent jamais les
auditeurs : ils veulent ou aimer, ou haïr, ou plaindre quelqu'un, et si l'on ne
trouve moyen de les attacher, de leur faire prendre parti dans une pièce et de
leur faire, pour ainsi dire, jouer en eux-mêmes un rôle muet qui les occupe, qui
les rende attentifs et qui leur fasse toujours souhaiter d'apprendre ce que
deviendront ceux qu'ils plaignent ou ceux qu'ils haïssent, il est bien difficile
qu'une pièce réussisse.
Sophonisbe 249249 n'a pas été blâmée de tous ceux qui l'ont vue parce
qu'elle fait concevoir de l'horreur pour elle en quelques endroits, mais parce
qu'elle n'en fait pas assez concevoir. Quoique la Cléopâtre de Rodogune soit une
femme aussi méchante que l'on puisse imaginer L’exemple
compte parmi les favoris de Corneille lui-même : « Cléopâtre dans
Rodogune est très méchante, il n’y a point de
parricide qui lui fasse horreur [...] mais tous ses crimes ont quelque
chose de si haut qu’en même temps qu’on déteste ses actions on admire la
source dont elles partent » (« Discours de l’utilité », éd. cit., p. 78-79). , elle n'a pas laissé que de plaire à tout le
monde, parce que l'on a une parfaite connaissance de son caractère et que la
haine qu'elle fait concevoir pour elle attache les auditeurs et qu'ils prennent
plaisir à la haïr. Si Sophonisbe, comme quelques-uns ont voulu dire, est une
personne généreuse, que la crainte de se voir captive et l'intérêt de sa
gloire font agir, pourquoi choquer son devoir et blesser sa vertu pour avoir soin de sa
gloire ? Est-ce être véritablement gé-250250néreuse que d'en user de
la sorte
L’exemple
compte parmi les favoris de Corneille lui-même : « Cléopâtre dans
Rodogune est très méchante, il n’y a point de
parricide qui lui fasse horreur [...] mais tous ses crimes ont quelque
chose de si haut qu’en même temps qu’on déteste ses actions on admire la
source dont elles partent » (« Discours de l’utilité », éd. cit., p. 78-79). , elle n'a pas laissé que de plaire à tout le
monde, parce que l'on a une parfaite connaissance de son caractère et que la
haine qu'elle fait concevoir pour elle attache les auditeurs et qu'ils prennent
plaisir à la haïr. Si Sophonisbe, comme quelques-uns ont voulu dire, est une
personne généreuse, que la crainte de se voir captive et l'intérêt de sa
gloire font agir, pourquoi choquer son devoir et blesser sa vertu pour avoir soin de sa
gloire ? Est-ce être véritablement gé-250250néreuse que d'en user de
la sorte C’est l’« inégalité de moeurs » de Sophonisbe, qui
est ici en cause. Straton accuse Corneille de contrevenir à un principe
édicté dans son propre « Discours de l’utilité… » (éd. cit.
p. 83). ?
C’est l’« inégalité de moeurs » de Sophonisbe, qui
est ici en cause. Straton accuse Corneille de contrevenir à un principe
édicté dans son propre « Discours de l’utilité… » (éd. cit.
p. 83). ?
Je sais que l'on me dira qu'elle était réduite, ou à souffrir d'être menée en
captive à Rome, ou à manquer de foi à son mari en épousant Massinisse. Mais elle
n'aurait fait l'un que par force, ce n'aurait pas été sa faute (elle n'aurait
fait qu'obéir au sort, qui seul en aurait été blâmé), au lieu qu'en manquant de
foi à son mari pour épouser Massinisse, toute la faute vient d'elle, et
qu'elle fait un crime sans y être contrainte La
péripétie dont Straton conteste ici le bien-fondé est constitutive du
sujet depuis la version de Mairet. Pour les dramaturges français,
l’intérêt de l’histoire de Sophonisbe réside précisément dans cette
possibilité de faire commettre une faute à l’héroïne et de s’écarter
ainsi du modèle de la tragédie de déploration. pour éviter
une chose à quoi elle aurait été forcée, qui ne blessait ni son devoir ni sa
vertu, que bien des reines ont soufferte avant elle et qui aurait été imputée à
sa mauvaise fortune.
La
péripétie dont Straton conteste ici le bien-fondé est constitutive du
sujet depuis la version de Mairet. Pour les dramaturges français,
l’intérêt de l’histoire de Sophonisbe réside précisément dans cette
possibilité de faire commettre une faute à l’héroïne et de s’écarter
ainsi du modèle de la tragédie de déploration. pour éviter
une chose à quoi elle aurait été forcée, qui ne blessait ni son devoir ni sa
vertu, que bien des reines ont soufferte avant elle et qui aurait été imputée à
sa mauvaise fortune.
Je veux toutefois, pour ne
paraître point sévère, que son grand courage dût l'empor-251251ter
par-dessus son devoir et qu'elle dût faire un crime pour éviter la honte de
suivre le char de son vainqueur. Ne pouvait-elle pas faire connaître à Siphax,
avec des paroles plus douces qu'elle ne fait, que la crainte de se voir captive
est cause qu'elle l'abandonne, et devait-elle pas lui faire avaler cette
amertume autrement qu'en le bravant et en lui disant : « Plus de roi, plus
d'époux La formule n’apparaît pas telle quelle dans le
texte de Sophonisbe publié en avril 1663. Mais elle
correspond à la substance des v. 1048 sq., sc. III, 6. » ?
Elle le traite de lâche parce qu'il n'est pas mort ; mais elle le devait avertir
de l'amour qu'elle avait pour Massinisse, afin qu'il se tuât pour lui donner
lieu de l'épouser avec moins de honte. Après l'avoir ainsi bravé, il semble
qu'elle lui veuille témoigner qu'elle l'aime encore, en lui disant que, s'il
peut sortir de ses fers et la délivrer, qu'elle 252252
abandonnera Massinisse
La formule n’apparaît pas telle quelle dans le
texte de Sophonisbe publié en avril 1663. Mais elle
correspond à la substance des v. 1048 sq., sc. III, 6. » ?
Elle le traite de lâche parce qu'il n'est pas mort ; mais elle le devait avertir
de l'amour qu'elle avait pour Massinisse, afin qu'il se tuât pour lui donner
lieu de l'épouser avec moins de honte. Après l'avoir ainsi bravé, il semble
qu'elle lui veuille témoigner qu'elle l'aime encore, en lui disant que, s'il
peut sortir de ses fers et la délivrer, qu'elle 252252
abandonnera Massinisse V. 1099-1104.. Mais
c'est plutôt le railler que de lui témoigner de l'amour, et il n'y a rien qui
doive plus faire de dépit à un homme que lorsque l'on lui demande des choses qu'il
sait bien qui lui sont impossibles et que l'on sait bien qu'il ne peut faire.
V. 1099-1104.. Mais
c'est plutôt le railler que de lui témoigner de l'amour, et il n'y a rien qui
doive plus faire de dépit à un homme que lorsque l'on lui demande des choses qu'il
sait bien qui lui sont impossibles et que l'on sait bien qu'il ne peut faire.
Je puis encore ajouter, pour montrer que le caractère de Sophonisbe n'est
pas assez connu, que ce n'est point la crainte du
triomphe qui la fait mépriser son mari, comme l'auteur a voulu faire croire dans
les derniers actes, puisque dès l'ouverture de la pièce l'on connaît
l'ardente amour qu'elle a pour Massinisse En réalité,
Sophonisbe exprime au début de la pièce (I, 2) sa jalousie à l’égard de
sa rivale Eryxe qui est en passe d’obtenir un cœur qu’elle-même a
dédaigné mais qu’elle souhaite néanmoins conserver en son pouvoir.
Comportement de précieuse, que Corneille a pris soin de distinguer de
motivations fondées sur une « ardente amour ». et que sa
passion est assez violente pour lui faire abandonner Siphax et épouser
Massinisse, quand même elle n'appréhenderait point d'être 253253 menée à
Rome, ce qui empêche de bien connaître son caractère, l'amour qu'elle a pour son
vainqueur et la crainte de l'esclavage partageant tellement toutes ses actions
que l'on ne saurait dire laquelle la fait le plus agir.
En réalité,
Sophonisbe exprime au début de la pièce (I, 2) sa jalousie à l’égard de
sa rivale Eryxe qui est en passe d’obtenir un cœur qu’elle-même a
dédaigné mais qu’elle souhaite néanmoins conserver en son pouvoir.
Comportement de précieuse, que Corneille a pris soin de distinguer de
motivations fondées sur une « ardente amour ». et que sa
passion est assez violente pour lui faire abandonner Siphax et épouser
Massinisse, quand même elle n'appréhenderait point d'être 253253 menée à
Rome, ce qui empêche de bien connaître son caractère, l'amour qu'elle a pour son
vainqueur et la crainte de l'esclavage partageant tellement toutes ses actions
que l'on ne saurait dire laquelle la fait le plus agir.
Je finis ce que j'avais à vous dire de ce rôle en répondant à ceux qui ont dit
que Sophonisbe n'était ni bonne ni méchante, et que par cette raison elle était
selon les règles d'Aristote La
Poétique, chap. XIII. La distinction que Straton émet dans la
phrase suivante semble exploiter une éventualité envisagée par Aristote
(53a 16-17).. Mais ce n'est pas de ceux qui ressemblent à
Sophonisbe, qui fait presque horreur, dont Aristote entend parler ; il veut
qu'un héros ne soit ni bon ni méchant, mais il veut qu'il soit plus vertueux que
méchant, et il ne faut pas qu'il soit criminel, puisqu'il faut qu'il soit
toujours plaint et aimé et que l'on s'intéresse pour lui. Cin-254254na
peut nous servir d'exemple
La
Poétique, chap. XIII. La distinction que Straton émet dans la
phrase suivante semble exploiter une éventualité envisagée par Aristote
(53a 16-17).. Mais ce n'est pas de ceux qui ressemblent à
Sophonisbe, qui fait presque horreur, dont Aristote entend parler ; il veut
qu'un héros ne soit ni bon ni méchant, mais il veut qu'il soit plus vertueux que
méchant, et il ne faut pas qu'il soit criminel, puisqu'il faut qu'il soit
toujours plaint et aimé et que l'on s'intéresse pour lui. Cin-254254na
peut nous servir d'exemple Le cas de Cinna, souvent
invoqué par Corneille dans ses « Discours » de 1660, n’est pas exploité
dans le développement qu’il consacre aux « moeurs » des héros. Donneau
comble la lacune en un geste ironique qui, sur la base d’un exemple
cornélien, démontre le défaut de conception d’un héros cornélien, au nom
d’un des principes que Corneille avait repris d’Aristote.
: il n'est pas le plus honnête homme du monde, puisqu'il conspire,
cependant il est plus vertueux que méchant. Sa conspiration contre un tyran ne
fait pas d'horreur et, après le sanglant et l'inimitable portrait du
Triumvirat
Le cas de Cinna, souvent
invoqué par Corneille dans ses « Discours » de 1660, n’est pas exploité
dans le développement qu’il consacre aux « moeurs » des héros. Donneau
comble la lacune en un geste ironique qui, sur la base d’un exemple
cornélien, démontre le défaut de conception d’un héros cornélien, au nom
d’un des principes que Corneille avait repris d’Aristote.
: il n'est pas le plus honnête homme du monde, puisqu'il conspire,
cependant il est plus vertueux que méchant. Sa conspiration contre un tyran ne
fait pas d'horreur et, après le sanglant et l'inimitable portrait du
Triumvirat sc. I, 3, v. 157-260 qu'il fait
à Émilie, il semble que l'on le doive louer d'entreprendre contre la vie
d'Auguste. Mais comme, lorsque l'auditeur commence à reconnaître les bontés que
ce prince a pour lui et qu'il doit passer pour un perfide de s'attaquer à la vie
d'un homme qui lui fait tant d'honneur et de bien, les remords qu'il
conçoit du crime qu'il est prêt de commettre
sc. I, 3, v. 157-260 qu'il fait
à Émilie, il semble que l'on le doive louer d'entreprendre contre la vie
d'Auguste. Mais comme, lorsque l'auditeur commence à reconnaître les bontés que
ce prince a pour lui et qu'il doit passer pour un perfide de s'attaquer à la vie
d'un homme qui lui fait tant d'honneur et de bien, les remords qu'il
conçoit du crime qu'il est prêt de commettre sc. III,
2 le font passer pour honnête homme, ils sont cause qu'il
ne cesse point de l'estimer et qu'il entre toujours dans ses intérêts. 255255 Voilà quel est mon sentiment touchant le personnage de Sophonisbe,
que vous ne devez pas prendre pour une règle.
sc. III,
2 le font passer pour honnête homme, ils sont cause qu'il
ne cesse point de l'estimer et qu'il entre toujours dans ses intérêts. 255255 Voilà quel est mon sentiment touchant le personnage de Sophonisbe,
que vous ne devez pas prendre pour une règle.
Je passe à celui de Siphax, dont je ne vous dirai qu'un mot. Ce rôle est joué
par Monsieur de Montfleury Zacharie Jacob (1608-1667) est,
avec Floridor, le comédien le plus prestigieux de l’Hôtel de Bourgogne,
où il est entré dès 1637. Molière le parodiera dans L’Impromptu
de Versailles, quelques mois après la parution des
Nouvelles Nouvelles, en soulignant lui aussi sa
propension à l’emphase dans le jeu théâtral. En 1668, un passage du
Parnasse réformé de
Guéret exploitera à nouveau ce filon comique., qui fait
beaucoup paraître tout ce qu'il
dit, qui joue avec jugement, qui pousse tout à fait bien les grandes passions et
qui ne manque jamais de faire remarquer tous les beaux endroits de ses rôles. Il
représente dans cette pièce celui de Siphax, c'est-à-dire d'un esclave
couronné
Zacharie Jacob (1608-1667) est,
avec Floridor, le comédien le plus prestigieux de l’Hôtel de Bourgogne,
où il est entré dès 1637. Molière le parodiera dans L’Impromptu
de Versailles, quelques mois après la parution des
Nouvelles Nouvelles, en soulignant lui aussi sa
propension à l’emphase dans le jeu théâtral. En 1668, un passage du
Parnasse réformé de
Guéret exploitera à nouveau ce filon comique., qui fait
beaucoup paraître tout ce qu'il
dit, qui joue avec jugement, qui pousse tout à fait bien les grandes passions et
qui ne manque jamais de faire remarquer tous les beaux endroits de ses rôles. Il
représente dans cette pièce celui de Siphax, c'est-à-dire d'un esclave
couronné Même critique dans les
Remarques de d’Aubignac, p. 18 : Syphax est un
personnage falot, soumis à l’autorité de sa femme., d'un
homme qui ne voit que par les yeux de sa femme et qui ne prend point d'autres
conseils que les siens. Il dit plusieurs vers
Même critique dans les
Remarques de d’Aubignac, p. 18 : Syphax est un
personnage falot, soumis à l’autorité de sa femme., d'un
homme qui ne voit que par les yeux de sa femme et qui ne prend point d'autres
conseils que les siens. Il dit plusieurs vers Sc. I, 4, v.
369-377 pour faire voir que les vieillards ne tâchent
qu'à plaire à leurs femmes
Sc. I, 4, v.
369-377 pour faire voir que les vieillards ne tâchent
qu'à plaire à leurs femmes IV, 2, v.
1193-1200, et quantité d'autres choses qui 256256 seraient
meilleures dans une pièce comique que dans une tragédie de cette importance. Son
malheur n'excite point de pitié
IV, 2, v.
1193-1200, et quantité d'autres choses qui 256256 seraient
meilleures dans une pièce comique que dans une tragédie de cette importance. Son
malheur n'excite point de pitié Cf d’Aubignac,
ibid. : « Quant à Syphax, c’est un prince malheureux
et néanmoins on ne le plaint pas ». De fait, Corneille lui donne à
dessein toutes les caractéristiques du cocu, ce qui explique que Donneau
puisse considérer qu’il aurait mieux sa place « dans une pièce comique
»., parce qu'il ne lui arrive aucune disgrâce qu'il n'ait bien méritée. Je ne
dirai rien de ses chaînes
Cf d’Aubignac,
ibid. : « Quant à Syphax, c’est un prince malheureux
et néanmoins on ne le plaint pas ». De fait, Corneille lui donne à
dessein toutes les caractéristiques du cocu, ce qui explique que Donneau
puisse considérer qu’il aurait mieux sa place « dans une pièce comique
»., parce qu'il ne lui arrive aucune disgrâce qu'il n'ait bien méritée. Je ne
dirai rien de ses chaînes A la sc. III, 6, Syphax fait son
entrée couvert de chaînes, ainsi que le révèlent les remarques de
Sophonisbe sur l’humiliation que cette situation représente (v. 1012,
1015). De même, à la sc. IV, 2, qui débute par l’ordre de Lelius
(« Détachez-lui ces fers »). L’utilisation de cet accessoire n’a plus
cours au début des années 1660 (voir M. Vuillermoz, Le Système
des objets dans les années 1625-1650, Genève, Droz,
2000)., on sait assez qu'elles pèsent présentement à tous
ceux qui les voient, et que l'on ne les peut plus souffrir, si ce n'est aux
tragédies de collège.
A la sc. III, 6, Syphax fait son
entrée couvert de chaînes, ainsi que le révèlent les remarques de
Sophonisbe sur l’humiliation que cette situation représente (v. 1012,
1015). De même, à la sc. IV, 2, qui débute par l’ordre de Lelius
(« Détachez-lui ces fers »). L’utilisation de cet accessoire n’a plus
cours au début des années 1660 (voir M. Vuillermoz, Le Système
des objets dans les années 1625-1650, Genève, Droz,
2000)., on sait assez qu'elles pèsent présentement à tous
ceux qui les voient, et que l'on ne les peut plus souffrir, si ce n'est aux
tragédies de collège.
Ce personnage a quelque chose de si bas que, de crainte de vous en dire plus que
je ne voudrais, je passe à celui d'Éryxe, que représente Mademoiselle de
Beauchâteau Madeleine du Pouget, épouse du comédien
Beauchâteau, une des plus anciennes comédiennes de l’Hôtel de Bourgogne
(elle avait joué l’Infante dans la distribution originale du
Cid en 1637). Son jeu caractéristique sera parodié
par Molière dans L’Impromptu de Versailles. Sa réputation de femme d’esprit (c’est-à-dire capable de
productions intellectuelles) est bien attestée parmi les contemporains :
Scarron, dans l’avis au lecteur de sa Précaution inutile, lui attribue un
rôle décisif dans la composition des Coups d’amour et de
fortune (1656) de Quinault.. Sa réputation est
assez établie et je ne puis rien dire à son avantage que tout le monde ne sache.
Je vous entretiendrais de son esprit, si je ne craignais de sortir de mon sujet
et si je n'appréhendais que la 257257 quantité de choses que j'aurais à
vous en raconter ne me fît demeurer trop longtemps sur une si riche et si vaste
matière. C'est pourquoi je quitte l'entretien de sa personne pour vous parler de
celle qu'elle joue dans la Sophonisbe.
Madeleine du Pouget, épouse du comédien
Beauchâteau, une des plus anciennes comédiennes de l’Hôtel de Bourgogne
(elle avait joué l’Infante dans la distribution originale du
Cid en 1637). Son jeu caractéristique sera parodié
par Molière dans L’Impromptu de Versailles. Sa réputation de femme d’esprit (c’est-à-dire capable de
productions intellectuelles) est bien attestée parmi les contemporains :
Scarron, dans l’avis au lecteur de sa Précaution inutile, lui attribue un
rôle décisif dans la composition des Coups d’amour et de
fortune (1656) de Quinault.. Sa réputation est
assez établie et je ne puis rien dire à son avantage que tout le monde ne sache.
Je vous entretiendrais de son esprit, si je ne craignais de sortir de mon sujet
et si je n'appréhendais que la 257257 quantité de choses que j'aurais à
vous en raconter ne me fît demeurer trop longtemps sur une si riche et si vaste
matière. C'est pourquoi je quitte l'entretien de sa personne pour vous parler de
celle qu'elle joue dans la Sophonisbe.
Éryxe, qu'elle y représente comme je vous viens de dire, est un personnage
entièrement inutile à la pièce Cf Remarques
de d’Aubignac, p. 19 : « ‘c’est une actrice inutilement produite sur la
scène, une personne postiche dont on n’avait pas grand besoin [...] Je
ne puis souffrir qu’elle soit comme l’Infante du Cid que
personne n’a jamais approuvée » et l'on ne croyait pas que
Monsieur de Corneille dût donner de compagne à l'Infante du Cid ; et il est
d'autant moins excusable qu'il a avoué lui-même
Cf Remarques
de d’Aubignac, p. 19 : « ‘c’est une actrice inutilement produite sur la
scène, une personne postiche dont on n’avait pas grand besoin [...] Je
ne puis souffrir qu’elle soit comme l’Infante du Cid que
personne n’a jamais approuvée » et l'on ne croyait pas que
Monsieur de Corneille dût donner de compagne à l'Infante du Cid ; et il est
d'autant moins excusable qu'il a avoué lui-même Corneille
effectivement reconnaîtra dans la préface de Sophonisbe :
« C’est une reine de ma façon, de qui ce poème reçoit grand ornement et
qui pourrait toutefois y passer en quelque sorte pour inutile ». La pièce
est achevée d’imprimer le 10 avril 1663 : soit Donneau, au moment où il
écrit, a eu connaissance du contenu de cette publication (avant ou après
parution), soit il se réfère à des propos que Corneille aurait tenus
oralement. La préface en tout cas n’évoque pas le critère mondain de
la nouveauté à propos d’Eryxe. que ce personnage est
inutile et qu'il a dit qu'il s'était persuadé qu'Éryxe plairait à cause de la
nouveauté de son caractère. Mais ce n'est pas imiter l'ancien Corneille que de
travailler de la sorte : il regardait ce qui était bon, non ce qui 258258
était nouveau ; il travaillait pour la postérité, et non pour le temps présent.
C'est pourquoi j'en appelle de lui-même à lui-même et je le condamne de s'être
accommodé à un siècle qui, grâce aux farces, ne saurait plus goûter les
bons et solides ouvrages
Corneille
effectivement reconnaîtra dans la préface de Sophonisbe :
« C’est une reine de ma façon, de qui ce poème reçoit grand ornement et
qui pourrait toutefois y passer en quelque sorte pour inutile ». La pièce
est achevée d’imprimer le 10 avril 1663 : soit Donneau, au moment où il
écrit, a eu connaissance du contenu de cette publication (avant ou après
parution), soit il se réfère à des propos que Corneille aurait tenus
oralement. La préface en tout cas n’évoque pas le critère mondain de
la nouveauté à propos d’Eryxe. que ce personnage est
inutile et qu'il a dit qu'il s'était persuadé qu'Éryxe plairait à cause de la
nouveauté de son caractère. Mais ce n'est pas imiter l'ancien Corneille que de
travailler de la sorte : il regardait ce qui était bon, non ce qui 258258
était nouveau ; il travaillait pour la postérité, et non pour le temps présent.
C'est pourquoi j'en appelle de lui-même à lui-même et je le condamne de s'être
accommodé à un siècle qui, grâce aux farces, ne saurait plus goûter les
bons et solides ouvrages Les mêmes récriminations se retrouveront dans la bouche de l’auteur Lysidas à la
scène VI de La Critique de L’Ecole des femmes (créée le
1er juin 1663)..
Les mêmes récriminations se retrouveront dans la bouche de l’auteur Lysidas à la
scène VI de La Critique de L’Ecole des femmes (créée le
1er juin 1663)..
Mais, pour retourner au rôle d'Éryxe, il a été regardé comme nouveau, ainsi que
son auteur se l'est imaginé, et l'est en effet, puisque c'est une femme qui
affecte pendant toute la pièce de servir sa rivale, afin de ne point passer pour
jalouse et de gagner l'esprit de Massinisse, qu'elle aime et qui aime
Sophonisbe. Mais quoi qu'elle fasse, on voit bien que la prudence de l'auteur agit plus
qu'elle. L'on voit peu de femmes si modérées lorsqu'elles ont de si justes et de
259259 si visibles sujets d'être jalouses. Je veux toutefois qu'il s'en trouve ;
mais, comme l'intérêt leur fait jouer ce personnage, il ne demande pas toujours
qu'elles le jouent, et la raison veut que l'on cesse de se nuire et de
servir une rivale Autrement dit les « moeurs » d’Eryxe ne
sont pas « convenables », si l’on suit le développement de Corneille sur
cette question dans son « Discours de l’utilité… » de 1660 (éd. cit., p.
81). Donneau fait semblant de ne pas comprendre que ce nouveau
personnage contribue à l’équilibre de l’ensemble du système axiologique
de la pièce en proposant un modèle de comportement féminin alternatif à
celui de Sophonisbe, lorsqu'elle sait profiter des services
que l'on lui rend, et que ce que l'on craint est près de s'accomplir. Il faut
alors agir autrement qu'en obligeant et cesser de rendre des services, lorsqu'on
voit que l'on n'en peut tirer le fruit que l'on s'était proposé d'en recueillir.
Autrement dit les « moeurs » d’Eryxe ne
sont pas « convenables », si l’on suit le développement de Corneille sur
cette question dans son « Discours de l’utilité… » de 1660 (éd. cit., p.
81). Donneau fait semblant de ne pas comprendre que ce nouveau
personnage contribue à l’équilibre de l’ensemble du système axiologique
de la pièce en proposant un modèle de comportement féminin alternatif à
celui de Sophonisbe, lorsqu'elle sait profiter des services
que l'on lui rend, et que ce que l'on craint est près de s'accomplir. Il faut
alors agir autrement qu'en obligeant et cesser de rendre des services, lorsqu'on
voit que l'on n'en peut tirer le fruit que l'on s'était proposé d'en recueillir.
Si Éryxe toutefois croyait qu'il y eût de la honte à suivre l'exemple de toutes les femmes en faisant trop éclater sa jalousie, et qu'elle se ferait par ce moyen railler et mépriser tout ensemble, elle pouvait la cacher sans servir sa ri-260260vale ; elle pouvait affecter de l'indifférence et, puisqu'elle avait tant de pouvoir sur elle-même, retenir les éclats impérieux de la plus déréglée des passions, et de celle qui tourmente le plus une femme et a le plus d'empire sur son esprit. Enfin Éryxe agit si mollement pour elle-même qu'elle n'oblige point l'auditeur d'entrer dans ses intérêts. Mais l'on ne doit pas s'en étonner, puisque l'on pourrait bien jouer la pièce sans elle et qu'elle ne contribue en rien, ni au nœud ni au dénouement.
Après l'inutile rôle d'Éryxe, voyons si celui de Massinisse, qui est plus
nécessaire à la pièce, y apporte quelques beautés. Oui ; mais elles ne viennent
pas de l'auteur, mais de celui qui le représente, puisque c'est Mon-261261sieur de Floridor Josias de Soulas
(1608-1671), chef de la troupe de l’Hôtel de Bourgogne depuis 1647. Les
contemporains opposent sa délicatesse dans les nuances du jeu à
l’emphase de Montfleury et lui reconnaissent des qualités de séduction
particulières (« Floridor, / Qui de grâce et d’esprit abonde », Loret,
Muse historique, 12 juillet 1659, à propos du
Bélisaire de La Calprenède)., qui a un
air si dégagé et qui joue
de si bonne grâce que les personnes d'esprit ne se peuvent lasser de dire qu'il
joue en honnête homme. Il paraît véritablement ce qu'il représente dans toutes
les pièces qu'il joue. Tous les auditeurs souhaiteraient de le voir sans cesse,
et sa démarche, son air et ses actions ont quelque chose de si naturel qu'il
n'est pas nécessaire qu'il parle pour attirer l'admiration de tout le monde.
Pour lui donner enfin beaucoup de louanges, il suffit de le nommer, puisque son
nom porte avec soi tous les éloges que l'on lui pourrait donner. Je puis dire
hardiment toutes ces choses, sans craindre de donner de la jalousie à ceux qui
sont de la même profession : il y a longtemps qu'il est 262262 au-dessus
de l’envie et que tout le monde avoue que c'est le plus grand comédien du monde
et un des plus galants hommes et de la plus agréable conversation.
Josias de Soulas
(1608-1671), chef de la troupe de l’Hôtel de Bourgogne depuis 1647. Les
contemporains opposent sa délicatesse dans les nuances du jeu à
l’emphase de Montfleury et lui reconnaissent des qualités de séduction
particulières (« Floridor, / Qui de grâce et d’esprit abonde », Loret,
Muse historique, 12 juillet 1659, à propos du
Bélisaire de La Calprenède)., qui a un
air si dégagé et qui joue
de si bonne grâce que les personnes d'esprit ne se peuvent lasser de dire qu'il
joue en honnête homme. Il paraît véritablement ce qu'il représente dans toutes
les pièces qu'il joue. Tous les auditeurs souhaiteraient de le voir sans cesse,
et sa démarche, son air et ses actions ont quelque chose de si naturel qu'il
n'est pas nécessaire qu'il parle pour attirer l'admiration de tout le monde.
Pour lui donner enfin beaucoup de louanges, il suffit de le nommer, puisque son
nom porte avec soi tous les éloges que l'on lui pourrait donner. Je puis dire
hardiment toutes ces choses, sans craindre de donner de la jalousie à ceux qui
sont de la même profession : il y a longtemps qu'il est 262262 au-dessus
de l’envie et que tout le monde avoue que c'est le plus grand comédien du monde
et un des plus galants hommes et de la plus agréable conversation.
Vous vous étonnerez peut-être pourquoi je vous entretiens si longtemps de
l'acteur, au lieu de vous entretenir de son rôle. Mais votre étonnement cessera
lorsque vous saurez que je n'en ai presque rien à dire. C'est un homme qui
s'emporte souvent en plaintes superflues En particulier, à
la sc. IV, 3, où il s’efforce en vain d’infléchir la rigueur romaine par
des lamentations sur son sort et des déclarations de
soumission. et qui dit force paroles inutiles. Il envoie du
poison à Sophonisbe sans qu'elle lui en ait demandé, comme elle fait dans
la pièce de Monsieur de Mairet
En particulier, à
la sc. IV, 3, où il s’efforce en vain d’infléchir la rigueur romaine par
des lamentations sur son sort et des déclarations de
soumission. et qui dit force paroles inutiles. Il envoie du
poison à Sophonisbe sans qu'elle lui en ait demandé, comme elle fait dans
la pièce de Monsieur de Mairet Chez Mairet, en effet, c’est
Sophonisbe elle-même qui demande à Massinisse de lui faire parvenir le
« présent » qu’il lui a promis (V, 3). La situation est clairement
différente dans la pièce de Corneille : l’envoi du poison n’est pas
sollicité et appelle un commentaire désabusé de l’héroïne (V, 2, v.
1591 sq.). La lâcheté est une composante du comportement de Massinisse qui
fait partie de la signification de la pièce de 1663 : Donneau encore une
fois feint de ne pas s’en rendre compte. qui porte le même
nom, et il l'envoie d'une manière qui lui peut faire croire que ce n'est que
pour se défaire d'elle et pour avoir 263263 lieu de favoriser sa rivale.
Ces funestes et mortels présents ne se font jamais si crûment, surtout à une
maîtresse : il faut ou qu'elle les demande, ou que l'on fasse voir que l'on s'en
réserve la moitié et que l'on en veut goûter le premier.
Chez Mairet, en effet, c’est
Sophonisbe elle-même qui demande à Massinisse de lui faire parvenir le
« présent » qu’il lui a promis (V, 3). La situation est clairement
différente dans la pièce de Corneille : l’envoi du poison n’est pas
sollicité et appelle un commentaire désabusé de l’héroïne (V, 2, v.
1591 sq.). La lâcheté est une composante du comportement de Massinisse qui
fait partie de la signification de la pièce de 1663 : Donneau encore une
fois feint de ne pas s’en rendre compte. qui porte le même
nom, et il l'envoie d'une manière qui lui peut faire croire que ce n'est que
pour se défaire d'elle et pour avoir 263263 lieu de favoriser sa rivale.
Ces funestes et mortels présents ne se font jamais si crûment, surtout à une
maîtresse : il faut ou qu'elle les demande, ou que l'on fasse voir que l'on s'en
réserve la moitié et que l'on en veut goûter le premier.
Le dernier rôle considérable dont je vous parlerai et dont je ne vous
entretiendrai pas longtemps, est celui de Lélius, que joue Monsieur de La
Fleur François Juvenon (1623-1674). Il vient d’entrer à
l’Hôtel de Bourgogne au relâche de Pâques 1662., qui peut
passer pour un grand comédien et qui s'est fait
admirer de tout le monde dans Commode et dans Stilicon. Il ne paraît dans
cette pièce que pour dire à Massinisse qu'il se doit divertir avec Sophonisbe et
non la prendre pour femme
François Juvenon (1623-1674). Il vient d’entrer à
l’Hôtel de Bourgogne au relâche de Pâques 1662., qui peut
passer pour un grand comédien et qui s'est fait
admirer de tout le monde dans Commode et dans Stilicon. Il ne paraît dans
cette pièce que pour dire à Massinisse qu'il se doit divertir avec Sophonisbe et
non la prendre pour femme IV, 3, v.
1369sq... Il veut autoriser ce qu'il avance par des
menteries, en disant que les dieux n'ont jamais eu de 264264
femmes
IV, 3, v.
1369sq... Il veut autoriser ce qu'il avance par des
menteries, en disant que les dieux n'ont jamais eu de 264264
femmes A la sc. IV, 3 du texte imprimé de la
Sophonisbe figure effectivement un passage où Lelius
se livre à des considérations sur la vie amoureuse des divinités de
l’Olympe (v. 1363-1368). Mais le dignitaire romain ne prétend pas que
« les dieux n’ont jamais eu de femme ». Il affirme simplement que leurs
choix et leurs comportements ne sont pas soumis aux mêmes contraintes
que celles que subissent les humains. Si l’on se fie aux propos de
Donneau, le texte aurait donc connu une modification en cours de
représentations, ou au plus tard au moment de la publication (10 avril
1663). , en quoi il s'abuse grossièrement. On dit
qu'il a retranché
quelque chose de cet endroit, ce qui fait voir que plusieurs l'ont condamné
aussi bien que moi. Quoique son emploi principal soit de faire tout son possible
pour conserver Sophonisbe aux Romains, il fait si mal son devoir qu'il lui donne
le temps de prendre du poison, bien qu'il pût y mettre ordre de meilleure
heure
A la sc. IV, 3 du texte imprimé de la
Sophonisbe figure effectivement un passage où Lelius
se livre à des considérations sur la vie amoureuse des divinités de
l’Olympe (v. 1363-1368). Mais le dignitaire romain ne prétend pas que
« les dieux n’ont jamais eu de femme ». Il affirme simplement que leurs
choix et leurs comportements ne sont pas soumis aux mêmes contraintes
que celles que subissent les humains. Si l’on se fie aux propos de
Donneau, le texte aurait donc connu une modification en cours de
représentations, ou au plus tard au moment de la publication (10 avril
1663). , en quoi il s'abuse grossièrement. On dit
qu'il a retranché
quelque chose de cet endroit, ce qui fait voir que plusieurs l'ont condamné
aussi bien que moi. Quoique son emploi principal soit de faire tout son possible
pour conserver Sophonisbe aux Romains, il fait si mal son devoir qu'il lui donne
le temps de prendre du poison, bien qu'il pût y mettre ordre de meilleure
heure Reproche également formulé par d’Aubignac, éd.
cit. p. 12, comme son devoir l'exigeait.
Reproche également formulé par d’Aubignac, éd.
cit. p. 12, comme son devoir l'exigeait.
Je ne parlerai point des suivantes et de plusieurs autres personnages de peu de
conséquence, ni même d'un Romain Il s’agit de Lépide. Voir
sc. III, 7 et V, 7. dont le principal emploi est d'empêcher
que Massinisse et Sophonisbe ne couchent ensemble et de faire le récit de la
mort de cette reine, qui est une pièce aussi belle 265265 que pleine
d'ornements peu nécessaires au sujet.
Il s’agit de Lépide. Voir
sc. III, 7 et V, 7. dont le principal emploi est d'empêcher
que Massinisse et Sophonisbe ne couchent ensemble et de faire le récit de la
mort de cette reine, qui est une pièce aussi belle 265265 que pleine
d'ornements peu nécessaires au sujet.
Après vous avoir ébauché les caractères de tous les principaux personnages, je crois vous devoir parler de la pièce en général.
Tout y ennuie, rien n'y attache Cf. d’Aubignac, éd. cit.,
p. 3 : « durant tout le spectacle, le théâtre n’éclata que
quatre ou cinq fois au plus et en tout le reste il demeura froid et sans
émotion », personne n'y fait assez de pitié pour être
plaint et aimé, ni assez d'horreur pour exciter beaucoup de haine, mais
plusieurs s'y font railler et mépriser tout ensemble. Elle produit des effets
contraires à la grande tragédie et fait rire en beaucoup d'endroits, et fait
même en quelques autres concevoir des pensées que la bienséance me défend
d'expliquer
Cf. d’Aubignac, éd. cit.,
p. 3 : « durant tout le spectacle, le théâtre n’éclata que
quatre ou cinq fois au plus et en tout le reste il demeura froid et sans
émotion », personne n'y fait assez de pitié pour être
plaint et aimé, ni assez d'horreur pour exciter beaucoup de haine, mais
plusieurs s'y font railler et mépriser tout ensemble. Elle produit des effets
contraires à la grande tragédie et fait rire en beaucoup d'endroits, et fait
même en quelques autres concevoir des pensées que la bienséance me défend
d'expliquer Cf. d’Aubignac, p. 16-17 : « Il y a bien des choses qui ne se peuvent faire justement
et sans honte et que l’on ne peut expliquer ni même toucher sans blesser
la bienséance ». L’abbé fait allusion à la proposition cavalière de
Massinisse, qui demande à Sophonisbe de devenir sa femme sur-le-champ
(II, 4). Les effets comiques que dénonce Donneau concernent sans doute
le personnage de Siphax qui se livre à un véritable esclandre de cocu à
la sc.III, 6, v. 1025 sq...
Cf. d’Aubignac, p. 16-17 : « Il y a bien des choses qui ne se peuvent faire justement
et sans honte et que l’on ne peut expliquer ni même toucher sans blesser
la bienséance ». L’abbé fait allusion à la proposition cavalière de
Massinisse, qui demande à Sophonisbe de devenir sa femme sur-le-champ
(II, 4). Les effets comiques que dénonce Donneau concernent sans doute
le personnage de Siphax qui se livre à un véritable esclandre de cocu à
la sc.III, 6, v. 1025 sq...
Chaque entracte peut fournir du sujet pour faire plusieurs pièces de machines et
il ne se passe rien sur la scène qui puisse attacher et divertir tout ensem-266266ble l'auditeur. Les femmes y font souvent des scènes avec leurs
suivantes, qui sont d'autant plus ennuyeuses qu'elles n'ont point d'intérêt
en la pièce Cf. d’Aubignac, éd. cit. p. 7-8 : « Ces deux suivantes [Herminie et Barcée] savent fort
bien ce que les deux reines leur content, et ces deux reines n’ignorent
rien de ce que ces deux suivantes leur répondent, si bien qu’elles [les
scènes concernées] paraissent manifestement affectées, pour faire
entendre aux spectateurs ce qu’ils ne doivent pas ignorer ».
. L'on peut dire avec justice qu'il y a de beaux vers, mais ils
y sont plus rares que dans toutes ses autres pièces, et il y en a même beaucoup
de méchants, de durs et
d'obscurs
Cf. d’Aubignac, éd. cit. p. 7-8 : « Ces deux suivantes [Herminie et Barcée] savent fort
bien ce que les deux reines leur content, et ces deux reines n’ignorent
rien de ce que ces deux suivantes leur répondent, si bien qu’elles [les
scènes concernées] paraissent manifestement affectées, pour faire
entendre aux spectateurs ce qu’ils ne doivent pas ignorer ».
. L'on peut dire avec justice qu'il y a de beaux vers, mais ils
y sont plus rares que dans toutes ses autres pièces, et il y en a même beaucoup
de méchants, de durs et
d'obscurs Cf. d’Aubignac, p. 19 : « Je pourrais bien encore ajouter quelques autres légères
observations touchant les expressions qui sont obscures » [...] « vers
rudes et mal tournés ».. Le trop d'art est cause que
l'on en découvre trop l'art
; car Sophonisbe et Éryxe se disent des choses, dans le premier acte, qui font
deviner trop clairement que la fortune changera
Cf. d’Aubignac, p. 19 : « Je pourrais bien encore ajouter quelques autres légères
observations touchant les expressions qui sont obscures » [...] « vers
rudes et mal tournés ».. Le trop d'art est cause que
l'on en découvre trop l'art
; car Sophonisbe et Éryxe se disent des choses, dans le premier acte, qui font
deviner trop clairement que la fortune changera Cf. I, 3,
v. 238., et les choses qui sont préparées par une espèce de
prédiction sont maintenant connues d'abord des personnes qui ont l'esprit le moins pénétrant.
Cf. I, 3,
v. 238., et les choses qui sont préparées par une espèce de
prédiction sont maintenant connues d'abord des personnes qui ont l'esprit le moins pénétrant.
L'auditeur n'est point content de voir finir la pièce comme elle fi-267267nit et il voudrait revoir Siphax et Massinisse après la mort de
Sophonisbe Même reproche chez d’Aubignac, éd. cit.,
p. 13., ou savoir du moins ce que dit l'un après la
mort de sa femme et l'autre après la mort de sa maîtresse.
Même reproche chez d’Aubignac, éd. cit.,
p. 13., ou savoir du moins ce que dit l'un après la
mort de sa femme et l'autre après la mort de sa maîtresse.
L'on peut dire, si l'on compare la Sophonisbe de Monsieur de Mairet avec cette
dernière, qu'il a mieux fait que Monsieur de Corneille, d'avoir, par les droits
que donne la poésie, fait mourir Siphax, pour n'y pas faire voir Sophonisbe
avec deux maris vivants Idem chez d’Aubignac, p.
17. Corneille y répondra dans la préface de
Sophonisbe, et d'avoir, par la même
autorité, fait mourir Massinisse
Idem chez d’Aubignac, p.
17. Corneille y répondra dans la préface de
Sophonisbe, et d'avoir, par la même
autorité, fait mourir Massinisse Cf d’Aubignac, p. 13-14 :
« Monsieur de Mairet avait sans doute mieux achevé cette catastrophe, car
il fait que Massinisse se tue sur le corps de Sophonisbe et c’était la
seule chose que le théâtre pouvait faire pour rétablir le désordre de
l’histoire qui laisse Massinisse vivant après tant d’événements autant
horribles qu’extraordinaires ». Cet argument trouvera lui aussi une
réponse de Corneille dans la préface de la pièce. qui,
après la mort de Sophonisbe, ne peut vivre ni avec plaisir ni avec honneur.
Cette mort aurait fait crier contre les Romains, elle en aurait fait blâmer la
cruelle politique et elle aurait fait 268268 prendre pitié de Massinisse
(car l'on n'en conçoit point pour Sophonisbe, après ce que l'on lui a vu faire),
la tragédie en aurait été mieux finie, elle aurait excité de la pitié et
l'auditeur s'en serait retourné plus satisfait.
Cf d’Aubignac, p. 13-14 :
« Monsieur de Mairet avait sans doute mieux achevé cette catastrophe, car
il fait que Massinisse se tue sur le corps de Sophonisbe et c’était la
seule chose que le théâtre pouvait faire pour rétablir le désordre de
l’histoire qui laisse Massinisse vivant après tant d’événements autant
horribles qu’extraordinaires ». Cet argument trouvera lui aussi une
réponse de Corneille dans la préface de la pièce. qui,
après la mort de Sophonisbe, ne peut vivre ni avec plaisir ni avec honneur.
Cette mort aurait fait crier contre les Romains, elle en aurait fait blâmer la
cruelle politique et elle aurait fait 268268 prendre pitié de Massinisse
(car l'on n'en conçoit point pour Sophonisbe, après ce que l'on lui a vu faire),
la tragédie en aurait été mieux finie, elle aurait excité de la pitié et
l'auditeur s'en serait retourné plus satisfait.
Il faut toutefois avouer qu'elle a des beautés que peu d'autres seraient capables de faire, et l'on peut dire à son avantage qu'elle est pleine de beaux endroits et que ce sont de belles pierreries qui ne sont pas partout également bien mises en œuvre, ou, si l'on veut, que c'est un tableau rempli de plusieurs personnages, mais qui ne composent point une histoire et qui, pour la beauté et la régularité de l'art qui se trouve dans les uns et les défauts qui se trouvent dans les autres, semble 269269 avoir été fait par de bons et de méchants peintres.
Voilà quels sont mes sentiments Ici commence le troisième
et dernier mouvement du texte : Donneau fait acte de contrition en
reconnaissant respectivement son statut d’auteur débutant et celui de
Corneille, prince des poètes. Il négocie ainsi habilement son droit à la
critique, conformément aux recommandations formulées par Mlle de Scudéry
: « il n’est rien qu’on ne puisse dire en conversation [ici, critiquer
la Sophonisbe], pourvu qu’on ait de l’esprit et du
jugement et qu’on considère bien où l’on est, à qui l’on parle et qui
l’on est soi-même [ici, un jeune auteur qui n’a pas de légitimité pour
critiquer Corneille] » (Artamène ou le Grand Cyrus,
1656, t. X, livre II, p. 431)., qui ne sont pas conçus
par règles, mais
par un peu de sens commun
Ici commence le troisième
et dernier mouvement du texte : Donneau fait acte de contrition en
reconnaissant respectivement son statut d’auteur débutant et celui de
Corneille, prince des poètes. Il négocie ainsi habilement son droit à la
critique, conformément aux recommandations formulées par Mlle de Scudéry
: « il n’est rien qu’on ne puisse dire en conversation [ici, critiquer
la Sophonisbe], pourvu qu’on ait de l’esprit et du
jugement et qu’on considère bien où l’on est, à qui l’on parle et qui
l’on est soi-même [ici, un jeune auteur qui n’a pas de légitimité pour
critiquer Corneille] » (Artamène ou le Grand Cyrus,
1656, t. X, livre II, p. 431)., qui ne sont pas conçus
par règles, mais
par un peu de sens commun Donneau de Visé réitère ici
l'orientation fondamentalement mondaine de cette critique : il ne s'agit
pas d'obscures théorie de doctes, mais un propos fondé sur l'impression
d'un spectateur et sur l'expérience du spectacle.La même opposition sera
formulée à plusieurs reprises à la sc. VI de La Critique de L’Ecole des femmes : « Tu es donc, Marquis, de ces messieurs
du bel air, qui ne veulent pas que le parterre ait du sens commun, et
qui seraient fâchés d’avoir ri avec lui, fût-ce de la meilleure chose du
monde ? » « Je me fierais assez à l’approbation du parterre, par la raison
qu’entre ceux qui le composent, il y en a plusieurs qui sont capables de
juger d’une pièce selon les règles, et que les autres en jugent par la
bonne façon d’en juger, qui est de se laisser prendre aux choses, et de
n’avoir ni prévention aveugle, ni complaisance affectée, ni délicatesse
ridicule. » « Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles dont vous
embarrassez les ignorants, et nous étourdissez tous les jours. Il
semble, à vous ouïr parler, que ces règles de l’art soient les plus
grands mystères du monde, et cependant ce ne sont que quelques
observations aisées que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le
plaisir que l’on prend à ces sortes de poèmes ; et le même bon sens qui
a fait autrefois ces observations, les fait aisément tous les jours,
sans le secours d’Horace et d’Aristote. . Je sais bien que
j'ai oublié beaucoup de choses, mais je n'ai pas prétendu faire des
remarques
Donneau de Visé réitère ici
l'orientation fondamentalement mondaine de cette critique : il ne s'agit
pas d'obscures théorie de doctes, mais un propos fondé sur l'impression
d'un spectateur et sur l'expérience du spectacle.La même opposition sera
formulée à plusieurs reprises à la sc. VI de La Critique de L’Ecole des femmes : « Tu es donc, Marquis, de ces messieurs
du bel air, qui ne veulent pas que le parterre ait du sens commun, et
qui seraient fâchés d’avoir ri avec lui, fût-ce de la meilleure chose du
monde ? » « Je me fierais assez à l’approbation du parterre, par la raison
qu’entre ceux qui le composent, il y en a plusieurs qui sont capables de
juger d’une pièce selon les règles, et que les autres en jugent par la
bonne façon d’en juger, qui est de se laisser prendre aux choses, et de
n’avoir ni prévention aveugle, ni complaisance affectée, ni délicatesse
ridicule. » « Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles dont vous
embarrassez les ignorants, et nous étourdissez tous les jours. Il
semble, à vous ouïr parler, que ces règles de l’art soient les plus
grands mystères du monde, et cependant ce ne sont que quelques
observations aisées que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le
plaisir que l’on prend à ces sortes de poèmes ; et le même bon sens qui
a fait autrefois ces observations, les fait aisément tous les jours,
sans le secours d’Horace et d’Aristote. . Je sais bien que
j'ai oublié beaucoup de choses, mais je n'ai pas prétendu faire des
remarques Allusion aux Remarques de
d’Aubignac (voir p. 245). La suite du passage stigmatise l’abbé comme un
pédant en reprenant les stéréotypes énoncés dans la préface des
Précieuses ridicules de Molière.. Si
ç'avait été mon dessein, j'en aurais dit vingt fois autant : je n'aurais
parlé que livres et qu'auteurs, que grec et que latin
Allusion aux Remarques de
d’Aubignac (voir p. 245). La suite du passage stigmatise l’abbé comme un
pédant en reprenant les stéréotypes énoncés dans la préface des
Précieuses ridicules de Molière.. Si
ç'avait été mon dessein, j'en aurais dit vingt fois autant : je n'aurais
parlé que livres et qu'auteurs, que grec et que latin Donneau de Visé réitère ce qu’il avait fait annoncer par Straton et
Arimant au début du texte (voir note supra, p. 244) : il
ne s’agit pas d’un discours à visée théorique, mais une critique fondée
sur l’expérience du spectacle., j'aurais repris la pièce de
scène en scène et vers à vers, j'aurais fait enfin tout ce qu'il faut pour faire
des remarques dans les formes. Mais bien que j'en eusse pu faire et que le rôle
de Sophonisbe seul me pût fournir assez de matière pour en faire un volume
considérable, je ne suis pas encore assez ami de l'auteur, bien que je sois
son 270270 serviteur, pour me donner tant de peine afin de faire valoir
sa pièce
Donneau de Visé réitère ce qu’il avait fait annoncer par Straton et
Arimant au début du texte (voir note supra, p. 244) : il
ne s’agit pas d’un discours à visée théorique, mais une critique fondée
sur l’expérience du spectacle., j'aurais repris la pièce de
scène en scène et vers à vers, j'aurais fait enfin tout ce qu'il faut pour faire
des remarques dans les formes. Mais bien que j'en eusse pu faire et que le rôle
de Sophonisbe seul me pût fournir assez de matière pour en faire un volume
considérable, je ne suis pas encore assez ami de l'auteur, bien que je sois
son 270270 serviteur, pour me donner tant de peine afin de faire valoir
sa pièce Ironie à l’égard de l’entreprise de d’Aubignac :
la polémique a pour effet en définitive d’attirer l’attention sur une
oeuvre ; le geste de d’Aubignac va dès lors à l’encontre de ce qu’il
cherche à obtenir..
Ironie à l’égard de l’entreprise de d’Aubignac :
la polémique a pour effet en définitive d’attirer l’attention sur une
oeuvre ; le geste de d’Aubignac va dès lors à l’encontre de ce qu’il
cherche à obtenir..
C'est pourquoi je crois ne lui avoir fait que du bien lorsque j'en ai dit mon
sentiment. Il est au-dessus de la critique, il rend raison de tout ce qu'il
fait Allusion aux Examens et aux trois Discours, qui
accompagnent l’édition des Oeuvres de Corneille en
1660., mais quoiqu'il soit le premier à faire voir ses
fautes, il devait du moins faire en sorte que son dernier ouvrage fût si achevé
qu'il ne fût point obligé de faire une préface pour en faire voir lui-même les
défauts et pour montrer qu'il les connaît
Allusion aux Examens et aux trois Discours, qui
accompagnent l’édition des Oeuvres de Corneille en
1660., mais quoiqu'il soit le premier à faire voir ses
fautes, il devait du moins faire en sorte que son dernier ouvrage fût si achevé
qu'il ne fût point obligé de faire une préface pour en faire voir lui-même les
défauts et pour montrer qu'il les connaît La préface de
Sophonisbe accompagne la pièce lors de sa parution le
10 avril 1663. Donneau a-t-il eu connaissance de ce texte avant sa
publication ? ou doit-on en conclure que le tome III des
Nouvelles Nouvelles est postérieur à cette date ?
autre explication possible : Straton fait allusion ici à l’ »avis au
lecteur » de Sertorius (juillet 1662)..
La préface de
Sophonisbe accompagne la pièce lors de sa parution le
10 avril 1663. Donneau a-t-il eu connaissance de ce texte avant sa
publication ? ou doit-on en conclure que le tome III des
Nouvelles Nouvelles est postérieur à cette date ?
autre explication possible : Straton fait allusion ici à l’ »avis au
lecteur » de Sertorius (juillet 1662)..
Je ne crois pas que ce que j'ai dit puisse plus nuire aux comédiens qu'à
l'auteur, puisque, outre que cette tragédie a jeté tout son feu, il est certain que
l'on court aux fautes de Corneille et que l'on les va voir avec plus de
plaisir que les chefs-d'œuvre des autres Allusion à la
querelle du Cid, dont l’Académie avait reconnu l’attrait
et le succès public tout en remarquant les fautes.. 271271 D'ailleurs, l'on ne doit pas croire que la Sophonisbe soit
méchante parce que j'ai,
ce semble, dit quelque chose à son désavantage : l'on ne parle jamais contre une
pièce qu'elle n'ait du
mérite, parce que celles qui sont absolument méchantes ne sont pas dignes
d'avoir cet honneur, et que ce serait perdre son temps que de vouloir faire
remarquer des fautes dans des choses qui en sont toutes remplies et où l'on ne
peut rien trouver de beau. Toutes ces choses font voir que ni l'auteur ni les
comédiens ne se peuvent plaindre de moi avec justice, et que je n'ai pas cru
effleurer seulement la réputation de Monsieur de Corneille en disant librement
ce que je pense de sa Sophonisbe.
Allusion à la
querelle du Cid, dont l’Académie avait reconnu l’attrait
et le succès public tout en remarquant les fautes.. 271271 D'ailleurs, l'on ne doit pas croire que la Sophonisbe soit
méchante parce que j'ai,
ce semble, dit quelque chose à son désavantage : l'on ne parle jamais contre une
pièce qu'elle n'ait du
mérite, parce que celles qui sont absolument méchantes ne sont pas dignes
d'avoir cet honneur, et que ce serait perdre son temps que de vouloir faire
remarquer des fautes dans des choses qui en sont toutes remplies et où l'on ne
peut rien trouver de beau. Toutes ces choses font voir que ni l'auteur ni les
comédiens ne se peuvent plaindre de moi avec justice, et que je n'ai pas cru
effleurer seulement la réputation de Monsieur de Corneille en disant librement
ce que je pense de sa Sophonisbe.
Je confesse avec tout le monde qu'il est le prince 272272 des poètes français, et je n'ai cité Rodogune et Cinna que pour faire voir que l'on ne peut rien trouver d'achevé que parmi ses ouvrages ; qu'il n'y a que lui seul qui ne puisse fournir des exemples de pièces parfaites et qu'il a pris un vol si haut que l'âge l'oblige malgré lui de descendre un peu.
Je sais qu'il a l'honneur d'avoir introduit la belle comédie en France, d'avoir purgé le théâtre de quantité de choses que l'on y veut faire remonter. Je sais, de plus, que ses pièces ont eu le glorieux avantage d'avoir formé quantité d'honnêtes gens, qu'elles sont dignes d'être conservées dans les cabinets des princes, des ministres et des rois, qu'elles sont plutôt faites pour instruire que pour divertir et que, quoique nous en 273273 ayons vu depuis un temps de fort brillantes, leur éclat n'a servi qu'à faire découvrir plus de beautés dans celles de ce grand homme et qu'à les faire voir dans leur jour.
Après cet aveu, je ne crois pas passer pour critique, mais peut-être que je ne
me pourrai exempter du nom de téméraire. L'on me fera toujours beaucoup
d'honneur de me le donner : la témérité appartient aux jeunes gens et ceux qui
n'en ont pas, loin de s'acquérir de l'estime, devraient être blâmés de tout
le monde Cette posture se fonde sur la valeur que Louis XIV
et Colbert accordent dans les années 1660 à l’esprit d’entreprise et aux
prises de risques calculées (voir C. Schuwey, Un entrepreneur des lettres, Paris, Classiques Garnier, 2020). La préface des Nouvelles Nouvelles fait également
l’éloge de cette qualité à propos du protagoniste de la nouvelle du t.
I, « Les Succès de l’indiscrétion » dont le « héros, quoique
téméraire, est beaucoup plus éclairé [que les étourdis de Molière et
de Quinault] : il n’entreprend rien sans savoir le péril où il
s’expose, il veut tenter la fortune pour voir si elle lui sera favorable
et faire quelque chose d’extraordinaire » (Textes liminaires, p. XVIII). .
Cette posture se fonde sur la valeur que Louis XIV
et Colbert accordent dans les années 1660 à l’esprit d’entreprise et aux
prises de risques calculées (voir C. Schuwey, Un entrepreneur des lettres, Paris, Classiques Garnier, 2020). La préface des Nouvelles Nouvelles fait également
l’éloge de cette qualité à propos du protagoniste de la nouvelle du t.
I, « Les Succès de l’indiscrétion » dont le « héros, quoique
téméraire, est beaucoup plus éclairé [que les étourdis de Molière et
de Quinault] : il n’entreprend rien sans savoir le péril où il
s’expose, il veut tenter la fortune pour voir si elle lui sera favorable
et faire quelque chose d’extraordinaire » (Textes liminaires, p. XVIII). .
Lorsque Straton eut cessé de parler, Arimant lui dit qu'il avait pris tant de plaisir à l'entendre qu'il n'avait pas voulu parler pendant son récit, de crainte de l'interrompre. Toute la compagnie s'entretint ensuite 274274 de ce que Straton avait raconté et Arimant dit que Monsieur de Corneille aurait fait une pièce qui n'eût pas cédé à toutes les siennes, s'il eût fait de Sophonisbe une femme généreuse, au lieu d'une emportée qui se laisse gouverner à son amour, s'il eût fait mourir Siphax, pour ne pas laisser à Sophonisbe deux maris vivants, s'il eût donné beaucoup d'amour à Massinisse et beaucoup d'indifférence à Sophonisbe, et que l'horreur qu'il lui eût fait avoir pour l'esclavage l'eût contrainte d'épouser Massinisse pour éviter d'être menée à Rome en esclave. Il ajouta que l'un et l'autre auraient paru vertueux, que l'un et l'autre auraient fait pitié, que Sophonisbe, après son mari mort, aurait pu, sans blesser son devoir, 275275 s'accommoder au temps et suivre les lois de la nécessité, que la violence qu'elle se serait faite pour épouser Massinisse, afin d'éviter les fers, l'aurait fait plaindre doublement, que Massinisse d'un autre côté aurait été plaint d'aimer si ardemment une personne dont il n'aurait pas été réciproquement aimé et que la sévère politique des Romains l'aurait encore fait plaindre.
Il continua en disant que toutes ces choses eussent produit des effets merveilleux et qu'elles eussent obligé l'auditeur à s'intéresser pour eux.
- Quelqu'un me dira peut-être, poursuivit-il, que c'était beaucoup entreprendre.
Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que Monsieur de Corneille a fait de hardies
entreprises sur
l'histoire La formule est de Corneille lui-même dans la
préface d’Héraclius. et qu'il est en
passe de tout 276276 faire, et il avait plus de privilège que jamais de se servir de
ses droits dans cet ouvrage, puisqu'il fallait, s'il nous voulait faire voir
quelque chose de nouveau, qu'il fît autre chose que Monsieur de Mairet, qui
avait déjà fait la même pièce.
La formule est de Corneille lui-même dans la
préface d’Héraclius. et qu'il est en
passe de tout 276276 faire, et il avait plus de privilège que jamais de se servir de
ses droits dans cet ouvrage, puisqu'il fallait, s'il nous voulait faire voir
quelque chose de nouveau, qu'il fît autre chose que Monsieur de Mairet, qui
avait déjà fait la même pièce.
Chacun demeura d'accord de ce qu'Arimant avait dit et je dis à mon tour que tout
le monde s'était persuadé que Monsieur de Corneille ne refaisait Sophonisbe que
pour en faire une honnête femme Le jugement final du
narrateur, reflétant à ses dires l’opinion générale des spectateurs,
identifie clairement la signification profonde de l’entreprise de
Corneille. Sa Sophonisbe ambitionne en effet de
problématiser la question du comportement féminin idoine face aux
épreuves de l’amour..
Le jugement final du
narrateur, reflétant à ses dires l’opinion générale des spectateurs,
identifie clairement la signification profonde de l’entreprise de
Corneille. Sa Sophonisbe ambitionne en effet de
problématiser la question du comportement féminin idoine face aux
épreuves de l’amour..
Après quoi, Straton, qui n'était point las de parler et qui avait coutume d'entretenir seul toutes les compagnies où il se rencontrait, dit en riant :
— J'ai oublié de vous dire de plaisantes choses que l'on me raconta hier au
Palais L’incipit se présente comme une suite de la
Conversation des nouvellistes du tome II. Les plaisanteries qui suivent en reprennent
également la structure : ils prennent la forme d’une suite de bons mots
agencés à la manière des recueils facétieux., de ces
curieux qui perdent tout leur temps à débiter et à 277277 demander des
nouvelles. Comme j'étais avec eux et que je voyais qu'ils en disaient non
seulement quantité de fausses, mais encore d'autres qui n'étaient pas
seulement vraisemblables, je
demandai à une personne avec qui j'étais, qui n'est (à ce qu'il tâche de faire
croire) nouvelliste que par rencontre, s'il était possible que tant de gens qui
paraissaient déjà sur l'âge
pussent croire les extravagances qu'ils disaient.
L’incipit se présente comme une suite de la
Conversation des nouvellistes du tome II. Les plaisanteries qui suivent en reprennent
également la structure : ils prennent la forme d’une suite de bons mots
agencés à la manière des recueils facétieux., de ces
curieux qui perdent tout leur temps à débiter et à 277277 demander des
nouvelles. Comme j'étais avec eux et que je voyais qu'ils en disaient non
seulement quantité de fausses, mais encore d'autres qui n'étaient pas
seulement vraisemblables, je
demandai à une personne avec qui j'étais, qui n'est (à ce qu'il tâche de faire
croire) nouvelliste que par rencontre, s'il était possible que tant de gens qui
paraissaient déjà sur l'âge
pussent croire les extravagances qu'ils disaient.
— Vraiment, Monsieur, me repartit-il, ils en croient bien d'autres. Comme je
voyais dernièrement qu'ils manquaient de nouvelles, quoique cela ne leur arrive
pas souvent et qu'ils en fassent plutôt que d'en manquer, je leur dis que
j'avais vu et lu des lettres qui disaient que deux arches du Pont-Euxin 278278 étaient tombées Le terme de Pont-Euxin (Mer
noire) se prête naturellement à des plaisanteries de cet ordre. On en
retrouve un autre exemple dans les Contes aux heures
perdues de d’Ouville (1643), où un astrologue, alors que l’on «
vint à parler du Pont-Euxin », « s’enquit s’il était de pierre ou de
bois » (p. 195) ou encore dans le Dictionnaire Universel en 1690,
à l’article « Pont ». et que soixante mille Turcs, qui étaient
dessus, avaient péri dans la mer. Ils crurent ce que je leur avais dit pendant
plus de deux mois et l'écrivirent à leurs amis
Le terme de Pont-Euxin (Mer
noire) se prête naturellement à des plaisanteries de cet ordre. On en
retrouve un autre exemple dans les Contes aux heures
perdues de d’Ouville (1643), où un astrologue, alors que l’on «
vint à parler du Pont-Euxin », « s’enquit s’il était de pierre ou de
bois » (p. 195) ou encore dans le Dictionnaire Universel en 1690,
à l’article « Pont ». et que soixante mille Turcs, qui étaient
dessus, avaient péri dans la mer. Ils crurent ce que je leur avais dit pendant
plus de deux mois et l'écrivirent à leurs amis En exposant
le fonctionnement des réseaux d’information et la facilité avec laquelle
une fausse nouvelle se répand, Donneau invite le public à se méfier des
informations dans une perspective de contrôle. ; et si un des provinciaux à qui ils en
avaient fait part n’eût eu plus d’esprit qu’eux et n’eût mandé que cette nouvelle était bien
inventée, et qu’il s’était raillé de quantité de gens de sa province qui avaient
donné dans le panneau, ils la croiraient encore présentement.
En exposant
le fonctionnement des réseaux d’information et la facilité avec laquelle
une fausse nouvelle se répand, Donneau invite le public à se méfier des
informations dans une perspective de contrôle. ; et si un des provinciaux à qui ils en
avaient fait part n’eût eu plus d’esprit qu’eux et n’eût mandé que cette nouvelle était bien
inventée, et qu’il s’était raillé de quantité de gens de sa province qui avaient
donné dans le panneau, ils la croiraient encore présentement.
Un nouvelliste du Palais, ajouta-t-il, vint il y a quelque temps dire à un
peloton de ses confrères : « Je viens d’apprendre une grande nouvelle : la reine
d’Espagne est grosse de ce matin d’un garçon ». Ils dirent d’abord tout ce que la
politique leur put faire trouver sur ce sujet, ils parlèrent 279279
du dépit que cette
nouvelle ferait à bien des gens et du plaisir qu’elle causerait à d’autres, et
ne reconnurent leur aveuglement que lorsque cette nouvelle ne leur put plus
fournir de quoi s’entretenir La reine d’Espagne Marie-Anne
d’Autriche a accouché de Charles en 1661. La plaisanterie porte ainsi
sur l’impossibilité d’apprendre une nouvelle d’Espagne « de ce matin »,
encore moins de connaître le sexe de l’enfant avant la naissance, et
fustige la précipitation à s’entretenir de tout avant même de contrôler
la vraisemblance d’une nouvelle. .
La reine d’Espagne Marie-Anne
d’Autriche a accouché de Charles en 1661. La plaisanterie porte ainsi
sur l’impossibilité d’apprendre une nouvelle d’Espagne « de ce matin »,
encore moins de connaître le sexe de l’enfant avant la naissance, et
fustige la précipitation à s’entretenir de tout avant même de contrôler
la vraisemblance d’une nouvelle. .
J’ai connu un nouvelliste, continua-t-il, qui pendant trente ans ne manqua pas
un seul jour de venir au Palais et, lorsque la vieillesse eut commencé à
l’incommoder, il y envoyait tous les jours son fils pour savoir ce qui s’y était
dit de nouveau. Étant devenu malade à l’extrémité et ayant perdu la parole,
elle lui revint en voyant un de ses amis Outre la
plaisanterie évidente, la résurrection miraculeuse du nouvelliste évoque
avec humour la vogue ininterrompue des histoires extraordinaires
(résurrections miraculeuses, apparition du démon…) circulant depuis
l’invention de l’imprimerie sous forme d’occasionnels. qui
était un des plus grands nouvellistes de Paris. Il se fit raconter tout ce qui
s’était raconté pendant sa maladie et toutes les nouvelles présentes, et puis
mourut lorsque cet ami n’eut plus rien à lui 280280 dire, comme s’il eût
attendu, pour mourir, afin de porter de fraîches nouvelles aux nouvellistes de
ses amis qui étaient morts avant lui.
Outre la
plaisanterie évidente, la résurrection miraculeuse du nouvelliste évoque
avec humour la vogue ininterrompue des histoires extraordinaires
(résurrections miraculeuses, apparition du démon…) circulant depuis
l’invention de l’imprimerie sous forme d’occasionnels. qui
était un des plus grands nouvellistes de Paris. Il se fit raconter tout ce qui
s’était raconté pendant sa maladie et toutes les nouvelles présentes, et puis
mourut lorsque cet ami n’eut plus rien à lui 280280 dire, comme s’il eût
attendu, pour mourir, afin de porter de fraîches nouvelles aux nouvellistes de
ses amis qui étaient morts avant lui.
— Comme j’avais ouï parler de ces nouvellistes, lui dis-je à mon tour, je vins
il y a quelque temps au Palais, où je feignis de venir du lever d’un
prince En démontrant combien il est aisé de falsifier
sa source, Donneau délégitime tout le processus de vérification des
faits dans une perspective de contrôle de l’information., et je fis accroire que je lui avais ouï dire
une nouvelle, que je débitai. Je fus toute la matinée environné de nouvellistes
et il n’y en eut pas un qui ne me vînt prier de répéter cette nouvelle. Il y en
eut qui me vinrent dire quelque temps après : « Monsieur, votre nouvelle est
confirmée, deux ou trois personnes me la viennent de dire et, puisque ces
gens-là la débitent, il faut qu’elle soit véritable ; car ils en savent des plus
secrètes et ne disent jamais rien de 281281 faux ». Cependant ces
personnes-là ne l’avaient apprise que de moi. Ainsi cette menterie fut crue et
confirmée presque en même temps.
En démontrant combien il est aisé de falsifier
sa source, Donneau délégitime tout le processus de vérification des
faits dans une perspective de contrôle de l’information., et je fis accroire que je lui avais ouï dire
une nouvelle, que je débitai. Je fus toute la matinée environné de nouvellistes
et il n’y en eut pas un qui ne me vînt prier de répéter cette nouvelle. Il y en
eut qui me vinrent dire quelque temps après : « Monsieur, votre nouvelle est
confirmée, deux ou trois personnes me la viennent de dire et, puisque ces
gens-là la débitent, il faut qu’elle soit véritable ; car ils en savent des plus
secrètes et ne disent jamais rien de 281281 faux ». Cependant ces
personnes-là ne l’avaient apprise que de moi. Ainsi cette menterie fut crue et
confirmée presque en même temps.
— Ce que vous venez de dire, me repartit-il, me fait souvenir d’un tour que je
fis il y a quelques jours à un nouvelliste, qui me vint demander des nouvelles
pour écrire à la campagne L’entretien d’une
correspondance ne se justifie souvent qu’en fonction des informations
que l’on peut obtenir de celle-ci (voir N. Schapira, Un
professionnel des lettres au XVIIe siècle, Seyssel, Champ
Vallon, 2003, p. 265-268). . Je lui dis que j’en savais
beaucoup et, comme il craignait d’en oublier une partie, il me pria de les lui
venir dicter dans une boutique du Palais. J’avais pour lors sur moi des
Mémoires de Sully
L’entretien d’une
correspondance ne se justifie souvent qu’en fonction des informations
que l’on peut obtenir de celle-ci (voir N. Schapira, Un
professionnel des lettres au XVIIe siècle, Seyssel, Champ
Vallon, 2003, p. 265-268). . Je lui dis que j’en savais
beaucoup et, comme il craignait d’en oublier une partie, il me pria de les lui
venir dicter dans une boutique du Palais. J’avais pour lors sur moi des
Mémoires de Sully Les deux derniers tomes (III et IV)
des Mémoires de Sully avaient parus quelques mois plus
tôt, en 1662, chez un conglomérat de libraires (notamment Billaine,
Jolly, Courbé). , que j’ouvris en faisant semblant de
tourner les feuillets en badinant ; et en l’ouvrant et en le refermant, je lui
en dictai trois pages, auxquelles je ne fis que changer quelques noms
propres
Les deux derniers tomes (III et IV)
des Mémoires de Sully avaient parus quelques mois plus
tôt, en 1662, chez un conglomérat de libraires (notamment Billaine,
Jolly, Courbé). , que j’ouvris en faisant semblant de
tourner les feuillets en badinant ; et en l’ouvrant et en le refermant, je lui
en dictai trois pages, auxquelles je ne fis que changer quelques noms
propres L’anecdote s’apparente aux méthodes employées
pour recycler des nouvelles extraordinaires et les faire paraître
inédites, ainsi que le notait Pierre de l’Estoile au début du siècle : «
on criait la conversion d’une courtisane vénitienne, qui était une
fadaise regrattée, car on en fait tous les ans trois ou quatre »
(Mémoires-journaux, t. IX, 1607-1609, p. 89).
. Mon nouvelliste me fit mille remer-282282ciements et
me quitta le plus satisfait du monde.
L’anecdote s’apparente aux méthodes employées
pour recycler des nouvelles extraordinaires et les faire paraître
inédites, ainsi que le notait Pierre de l’Estoile au début du siècle : «
on criait la conversion d’une courtisane vénitienne, qui était une
fadaise regrattée, car on en fait tous les ans trois ou quatre »
(Mémoires-journaux, t. IX, 1607-1609, p. 89).
. Mon nouvelliste me fit mille remer-282282ciements et
me quitta le plus satisfait du monde.
Il y a toutefois, continua-t-il, plus d’honnêtes gens au Palais que l’on ne
croit, qui se mêlent de débiter des nouvelles. Il y a divers bureaux de
nouvellistes Analogie probable avec le « bureau
d’adresses ». Donneau imagine ainsi un « bureau de l’information »,
peut-être inspiré du « Staple of news » de Ben Jonson. et
l’on en dit quelquefois de bonnes dans le plus considérable de ces bureaux, où
préside un homme de justice, qui a autant de mérite que de naissance et qui
reçoit
Analogie probable avec le « bureau
d’adresses ». Donneau imagine ainsi un « bureau de l’information »,
peut-être inspiré du « Staple of news » de Ben Jonson. et
l’on en dit quelquefois de bonnes dans le plus considérable de ces bureaux, où
préside un homme de justice, qui a autant de mérite que de naissance et qui
reçoit L'allusion n'est pas évidente. Il ne s'agit
probablement pas d'un gazetier professionnel (p. ex. Robinet) mais
plutôt d'une figure autour de laquelle s'assemble un groupe. Il pourrait
ainsi s'agir de Joachim de Lionne, cousin du ministre d'État Hugues de
Lionne., tous les ordinaires, des lettres de Rome et d’autres pays
étrangers. On peut dire que celui-là est passé docteur en nouvelles et qu’il y a
bien des années qu’il régente au
Palais, et qu’il est le doyen des nouvellistes de France, encore qu’il ne soit
pas le plus vieux. Ce que je trouve de plus plaisant, c’est que ces bureaux se raillent les uns
des autres
L'allusion n'est pas évidente. Il ne s'agit
probablement pas d'un gazetier professionnel (p. ex. Robinet) mais
plutôt d'une figure autour de laquelle s'assemble un groupe. Il pourrait
ainsi s'agir de Joachim de Lionne, cousin du ministre d'État Hugues de
Lionne., tous les ordinaires, des lettres de Rome et d’autres pays
étrangers. On peut dire que celui-là est passé docteur en nouvelles et qu’il y a
bien des années qu’il régente au
Palais, et qu’il est le doyen des nouvellistes de France, encore qu’il ne soit
pas le plus vieux. Ce que je trouve de plus plaisant, c’est que ces bureaux se raillent les uns
des autres La satire recouvre une réalité, celle de la
concurrence entre les différents réseaux d’information publics et
privés, et entre les différentes gazettes et lettres en vers.
, et que chaque nou-283283velliste y montre au doigt ses
compagnons et dit que ce sont les plus grands fous du monde de
s’amuser comme
ils font à débiter et à demander sans cesse des nouvelles.
La satire recouvre une réalité, celle de la
concurrence entre les différents réseaux d’information publics et
privés, et entre les différentes gazettes et lettres en vers.
, et que chaque nou-283283velliste y montre au doigt ses
compagnons et dit que ce sont les plus grands fous du monde de
s’amuser comme
ils font à débiter et à demander sans cesse des nouvelles.
— Je m’étonne, lui dis-je, que l’on ne fait quelques pasquinades Le terme de pasquinade provient de la statue de Pasquin, à
Rome, sur laquelle sont accrochés des libelles anonymes.
pour mettre aux lieux où ils s’assemblent le plus ordinairement.
Le terme de pasquinade provient de la statue de Pasquin, à
Rome, sur laquelle sont accrochés des libelles anonymes.
pour mettre aux lieux où ils s’assemblent le plus ordinairement.
— Vous me faites ressouvenir, me repartit-il, en parlant de pasquinade, de
l’affaire de Rome Il s’agit de l’affaire dite de la
garde corse qui connut son climax le 20 août 1662, lorsque les gardes du
pape ouvrirent le feu sur le carrosse de l'ambassadeur français,
blessant son page. L’affaire eut un retentissement diplomatique
considérable, Louis XIV saisissant l’affront comme l’occasion
d’illustrer son autorité sur la scène internationale. :
qu’elle leur a donné d’occupation ! qu’elle a fait exciter entre eux de
querelles ! qu’elle leur a fait perdre de paroles ! qu’elle leur a fait dire de
menteries ! qu’elle leur a fait raconter de pasquinades ! qu’elle leur a fait
lever de soldats et leur donner de rendez-vous ! et qu’elle leur a fait enfin
faire bonne chère de nouvelles ! 284284 Elle a fait grossir le nombre des
nouvellistes du Palais, et plusieurs, qui n’y venaient pas si ponctuellement
depuis la paix
Il s’agit de l’affaire dite de la
garde corse qui connut son climax le 20 août 1662, lorsque les gardes du
pape ouvrirent le feu sur le carrosse de l'ambassadeur français,
blessant son page. L’affaire eut un retentissement diplomatique
considérable, Louis XIV saisissant l’affront comme l’occasion
d’illustrer son autorité sur la scène internationale. :
qu’elle leur a donné d’occupation ! qu’elle a fait exciter entre eux de
querelles ! qu’elle leur a fait perdre de paroles ! qu’elle leur a fait dire de
menteries ! qu’elle leur a fait raconter de pasquinades ! qu’elle leur a fait
lever de soldats et leur donner de rendez-vous ! et qu’elle leur a fait enfin
faire bonne chère de nouvelles ! 284284 Elle a fait grossir le nombre des
nouvellistes du Palais, et plusieurs, qui n’y venaient pas si ponctuellement
depuis la paix La Paix des Pyrénées (7 novembre 1659).
Dans cette représentation, la paix engendre une diminution du goût pour
l'information (plus de mouvements de troupes à suivre, p. ex.). La
phrase fustige au passage le goût du sensationnalisme., ne
manquent pas un jour d’y venir, pour apprendre ce que l’on en y dit
La Paix des Pyrénées (7 novembre 1659).
Dans cette représentation, la paix engendre une diminution du goût pour
l'information (plus de mouvements de troupes à suivre, p. ex.). La
phrase fustige au passage le goût du sensationnalisme., ne
manquent pas un jour d’y venir, pour apprendre ce que l’on en y dit L’affaire fit également le profit des libraires : des pièces
sur l’affaire furent publiées dans des recueils pirates, tels que le
Recueil de quelques pièces nouvelles et galantes,
p. 167sq.. . Et, si nous avions guerre, peut-être que le
nombre en serait encore plus considérable, car j’y en ai compté jusqu’à trois
cents pendant nos derniers troubles
L’affaire fit également le profit des libraires : des pièces
sur l’affaire furent publiées dans des recueils pirates, tels que le
Recueil de quelques pièces nouvelles et galantes,
p. 167sq.. . Et, si nous avions guerre, peut-être que le
nombre en serait encore plus considérable, car j’y en ai compté jusqu’à trois
cents pendant nos derniers troubles La
Fronde..
La
Fronde..
— Je crois, lui répondis-je, qu’ils incommodent bien les plaideurs et les marchands.
— Ils leur sont insupportables, me répliqua-t-il, et si quelques avocats et
autres gens de justice encore plus considérables n’étaient du nombre, peut-être
qu’ils auraient déjà cherché les moyens de les en chasser. Ce n’est pas qu’à
dire vrai la chose ne fût fort difficile, car, bien qu’ils 285285 soient
sur de fort beaux carreaux de
marbre, on peut dire qu’ils sont sur le pavé du Roi Le bon
mot mêle une référence concrète au dallage du Palais (« de beaux
carreaux ») et une expression consacrée, « être sur le pavé du Roi »,
qui signifie qu’ils sont dans l’espace public et donc, que personne ne
peut les en déloger..
Le bon
mot mêle une référence concrète au dallage du Palais (« de beaux
carreaux ») et une expression consacrée, « être sur le pavé du Roi »,
qui signifie qu’ils sont dans l’espace public et donc, que personne ne
peut les en déloger..
— L’on devrait donc, répondis-je, leur faire payer le louage de leur place, de
même qu’aux marchands. Il faut, continuai-je, bien que la chose vous semble
difficile, faire défendre à ces perpétuels et fainéants hôtes du Palais d’y plus
venir débiter de nouvelles, et nous ferons accommoder après cela quelques belles
salles pour les mettre et nous demanderons après permission de prendre de
l’argent de ceux qui voudront y entrer Le développement
d’une information publique, phénomène paneuropéen depuis le début du
XVIIe siècle, s’accompagne d’une monétisation de celle-ci. Cette
évolution suscite des satires dans toute l’Europe, notamment dans la
célèbre comédie The Staple of News (1625) du dramaturge
anglais Ben Jonson. Le projet évoqué dans les Nouvelles
Nouvelles trouvera une traduction graphique en 1697 avec
l’almanach intitulé « Bureau d’adresses pour les curieux ». .
Le développement
d’une information publique, phénomène paneuropéen depuis le début du
XVIIe siècle, s’accompagne d’une monétisation de celle-ci. Cette
évolution suscite des satires dans toute l’Europe, notamment dans la
célèbre comédie The Staple of News (1625) du dramaturge
anglais Ben Jonson. Le projet évoqué dans les Nouvelles
Nouvelles trouvera une traduction graphique en 1697 avec
l’almanach intitulé « Bureau d’adresses pour les curieux ». .
Cette plaisanterie le fit rire quelque temps, après laquelle il me dit :
— Savez-vous bien que, lorsque ces messieurs les nouvellistes manquent de nouvelles, qu’ils se jettent sur les pendus et sur les roués, et 286286 qu’ils s’entretiennent de ce qu’ils ont fait avant que d’être pris, de ce qu’ils ont répondu lorsque l’on les a interrogés, de ce qu’ils ont dit en mourant et de la manière dont ils sont morts ? Enfin, continua-t-il, ils sont si stupides, lorsqu’ils sont avec des gens qui ne s’entretiennent pas de nouvelles, qu’ils les quittent aussitôt.
C’était au Palais, me dit-il, en m’entretenant toujours de nouvellistes, que
venaient autrefois chercher des nouvelles les auteurs de la gazette secrète, ou,
si vous voulez, de la gazette à la main Les gazettes à la
main échappant au contrôle exercé sur l’imprimé, elles constituaient un
support de diffusion d’informations clandestines. L’usage du
singulier est ici métonymique. . Mais comme ils ont vu que
l’on les y venait quérir, afin de les mener à la Bastille pour apprendre comme
l’on y vit, ils n’y sont plus revenus. J’y en remarquai une fois deux et
j’entendis que l’un 287287 disait à l’autre : « Allez écouter tout ce que
l’on dit à tous les pelotons ou bureaux des nouvellistes du bout d’en bas,
j’écouterai tout ce qui se dit de ce côté-ci ». J’y en ai encore vu bien d’autres
qui n’avaient point de part à la gazette à la main, qui faisaient les mêmes
folies.
Les gazettes à la
main échappant au contrôle exercé sur l’imprimé, elles constituaient un
support de diffusion d’informations clandestines. L’usage du
singulier est ici métonymique. . Mais comme ils ont vu que
l’on les y venait quérir, afin de les mener à la Bastille pour apprendre comme
l’on y vit, ils n’y sont plus revenus. J’y en remarquai une fois deux et
j’entendis que l’un 287287 disait à l’autre : « Allez écouter tout ce que
l’on dit à tous les pelotons ou bureaux des nouvellistes du bout d’en bas,
j’écouterai tout ce qui se dit de ce côté-ci ». J’y en ai encore vu bien d’autres
qui n’avaient point de part à la gazette à la main, qui faisaient les mêmes
folies.
Ne croyez pas, continua le même, qui était un grand parleur, que les nouvelles
que l’on débite au Palais ne fassent point d’effet : soit qu’elles soient
vraies, ou soit qu’elles soient fausses, elles peuvent causer des désordres
considérables et, comme elles s’épandent en sortant de là parmi tout le peuple,
elles lui peuvent faire croire des choses qu’il est après bien difficile d’ôter
de son imagination ; et pour éviter de semblables accidents, j’ai su de
personnes 288288 dignes de foi que feu S.E. y envoyait quelquefois des
gens qui débitaient quantité de choses de la manière qu’il voulait qu’on
les crût En dévoilant les manipulations de l’information,
Donneau invite les lecteurs à ne pas croire les informations qu’ils
entendent, dans une perspective de contrôle de l’information. Feu S. E. (Son Eminence) fait ici référence à Mazarin.
.
En dévoilant les manipulations de l’information,
Donneau invite les lecteurs à ne pas croire les informations qu’ils
entendent, dans une perspective de contrôle de l’information. Feu S. E. (Son Eminence) fait ici référence à Mazarin.
.
Tout ce qui se fait au Palais, me dit-il encore, se fait à l’Arsenal Henri IV avait fait aménager une grande promenade plantée
sur les quais de l’Arsenal, en face de l’île Louviers. :
l’on y voit tous les jours quantité de nouvellistes et je connais des personnes
qui ont plus de soixante ans, qui ne laissent passer aucun jour sans y aller.
Henri IV avait fait aménager une grande promenade plantée
sur les quais de l’Arsenal, en face de l’île Louviers. :
l’on y voit tous les jours quantité de nouvellistes et je connais des personnes
qui ont plus de soixante ans, qui ne laissent passer aucun jour sans y aller.
Ces assemblées, poursuivit-il, ne sont pas si célèbres que celles que nous voyons chez les plus
fameuses et les plus spirituelles personnes de notre siècle, comme chez les
Chapelain et chez les Ménage Chapelain et Ménage comptent
parmi les figures majeures et les plus influentes du monde littéraire et
culturel, assemblant régulièrement autour d’eux une société d’affaires.
On connaît notamment les mercuriales de Ménage, qui se tenaient le
mercredi. Dans ces cercles comme ailleurs, l’échange de nouvelles est
une activité courante de la vie mondaine. La figure
du nouvelliste en fustige les excès, et non l’activité elle-même.
. Chez les Ménage et les Chapelain, afin que personne ne se
plaigne, après avoir parlé de science, on se délasse quelquefois en faisant le
tour du monde et en s’en-289289tretenant de nouvelles ; et comme il y
vient souvent quantité de gens de mérite et de qualité, il est sûr que l’on dit
quelquefois des choses et bien secrètes et bien véritables. Et quoique ce lieu
soit destiné pour s’entretenir de choses plus relevées, les nouvelles en font
souvent le principal entretien : l’on y parle de masques pendant le carnaval
aussi bien qu’autre part, et l’on s’entretient même plus longtemps de ces
bagatelles et de cent autres choses de cette nature que d’autres discours plus
solides.
Chapelain et Ménage comptent
parmi les figures majeures et les plus influentes du monde littéraire et
culturel, assemblant régulièrement autour d’eux une société d’affaires.
On connaît notamment les mercuriales de Ménage, qui se tenaient le
mercredi. Dans ces cercles comme ailleurs, l’échange de nouvelles est
une activité courante de la vie mondaine. La figure
du nouvelliste en fustige les excès, et non l’activité elle-même.
. Chez les Ménage et les Chapelain, afin que personne ne se
plaigne, après avoir parlé de science, on se délasse quelquefois en faisant le
tour du monde et en s’en-289289tretenant de nouvelles ; et comme il y
vient souvent quantité de gens de mérite et de qualité, il est sûr que l’on dit
quelquefois des choses et bien secrètes et bien véritables. Et quoique ce lieu
soit destiné pour s’entretenir de choses plus relevées, les nouvelles en font
souvent le principal entretien : l’on y parle de masques pendant le carnaval
aussi bien qu’autre part, et l’on s’entretient même plus longtemps de ces
bagatelles et de cent autres choses de cette nature que d’autres discours plus
solides.
Après l’avoir écouté longtemps, voyant qu’il était plus d’une heure et qu’il ne
restait au Palais que quelques plaideurs et quelques nouvellistes, je le quittai
et m’en retournai en mon logis, en riant 290290 en moi-même de tout
ce qu’il m’avait dit Cette mention incongrue ne correspond
aucunement à la situation cadre des tomes II et III : qui doit rentrer
chez lui ? Qui était sorti ? Il s’agit manifestement d’une trace des
précédentes strates des
Nouvelles Nouvelles (voir aussi notes p. 200 et 204).
.
Cette mention incongrue ne correspond
aucunement à la situation cadre des tomes II et III : qui doit rentrer
chez lui ? Qui était sorti ? Il s’agit manifestement d’une trace des
précédentes strates des
Nouvelles Nouvelles (voir aussi notes p. 200 et 204).
.
Quand Straton eut cessé de parler, nous nous entretînmes de ce qu’il nous avait raconté. Mais, comme il n’était pas homme à demeurer longtemps sans rien dire, il reprit la parole un moment après et dit :
— Je suis sûr que le livre que je fais imprimer réussira. Le sujet en est
admirable et nouveau tout ensemble. Je n’ai point travaillé sur les ouvrages des
autres pour tâcher d’obscurcir leur gloire Allusion
probable à Corneille qui vient de donner à la scène sa
Sophonisbe, qui entre en concurrence avec celle de
Mairet. . C’est une vanité dont je ne suis pas capable et,
à moins que d’être assuré de les étouffer entièrement, cela ne se doit point
entreprendre, et l’on a quelquefois vu qu’Apollon, pour abaisser l’orgueil de
ces auteurs et pour les punir de leur présomption, leur a fait faire des cho-291291ses qui ne servaient qu’à abaisser leur gloire, au lieu de ceux
qu’ils voulaient étouffer. Je n’ai point non plus raccommodé mes propres ouvrages et, pour les
mieux déguiser, je ne les ai point débaptisés : cela ne sert qu’à faire
connaître que l’on a mal fait autrefois.
Allusion
probable à Corneille qui vient de donner à la scène sa
Sophonisbe, qui entre en concurrence avec celle de
Mairet. . C’est une vanité dont je ne suis pas capable et,
à moins que d’être assuré de les étouffer entièrement, cela ne se doit point
entreprendre, et l’on a quelquefois vu qu’Apollon, pour abaisser l’orgueil de
ces auteurs et pour les punir de leur présomption, leur a fait faire des cho-291291ses qui ne servaient qu’à abaisser leur gloire, au lieu de ceux
qu’ils voulaient étouffer. Je n’ai point non plus raccommodé mes propres ouvrages et, pour les
mieux déguiser, je ne les ai point débaptisés : cela ne sert qu’à faire
connaître que l’on a mal fait autrefois.
Quoique je ne craigne rien de toutes ces choses, j’appréhende néanmoins les
auteurs Les travers des auteurs, au premier rang
desquels la propension à la rivalité, sont également dénoncés dans
La Critique de L’Ecole des femmes : « vous savez
qu’entre nous autres auteurs, nous devons parler des ouvrages les uns
des autres, avec beaucoup de circonspection. » (sc. VI). « Si l’on joue
quelques marquis, je trouve qu’il y a bien plus de quoi jouer les
auteurs, et que ce serait une chose plaisante à mettre sur le théâtre
que [...] leur friandise de louanges ; leurs ménagements de pensées ;
leur trafic de réputation ; et leurs ligues offensives et défensives ;
aussi bien que leurs guerres d’esprit, et leurs combats de prose, et de
vers. » (ibid.). Comme mon livre doit
aisément passer pour beau, leur jalousie me fera tort. Ils feront tout ce qu’ils
pourront pour me détruire, ils le décrieront sous main. Ce sont de rusés
ennemis, ils sont tous jaloux les uns des autres, toutes leurs louanges sont
empoisonnées, il n’y en a jamais eu un qui ait dit du bien d’un autre avec
sincérité, ni même qui ait cru qu’il y en eût à dire. 292292 J’espère
toutefois que mon livre réussira, en dépit de tous ces obstacles, que sa beauté
les rendra vains, qu’il mettra l’Envie en état de ne lui pouvoir nuire et que
les auteurs n’en pourront dire du mal sans paraître ridicules.
Les travers des auteurs, au premier rang
desquels la propension à la rivalité, sont également dénoncés dans
La Critique de L’Ecole des femmes : « vous savez
qu’entre nous autres auteurs, nous devons parler des ouvrages les uns
des autres, avec beaucoup de circonspection. » (sc. VI). « Si l’on joue
quelques marquis, je trouve qu’il y a bien plus de quoi jouer les
auteurs, et que ce serait une chose plaisante à mettre sur le théâtre
que [...] leur friandise de louanges ; leurs ménagements de pensées ;
leur trafic de réputation ; et leurs ligues offensives et défensives ;
aussi bien que leurs guerres d’esprit, et leurs combats de prose, et de
vers. » (ibid.). Comme mon livre doit
aisément passer pour beau, leur jalousie me fera tort. Ils feront tout ce qu’ils
pourront pour me détruire, ils le décrieront sous main. Ce sont de rusés
ennemis, ils sont tous jaloux les uns des autres, toutes leurs louanges sont
empoisonnées, il n’y en a jamais eu un qui ait dit du bien d’un autre avec
sincérité, ni même qui ait cru qu’il y en eût à dire. 292292 J’espère
toutefois que mon livre réussira, en dépit de tous ces obstacles, que sa beauté
les rendra vains, qu’il mettra l’Envie en état de ne lui pouvoir nuire et que
les auteurs n’en pourront dire du mal sans paraître ridicules.
Après avoir parlé si longtemps, nous avoir dit tant de fois qu’il avait
affaire et qu’il allait sortir Cette remarque fait
référence aux propos tenus par Straton aux p. 174-178. Elle provient
d’un état antérieur des Nouvelles Nouvelles et
indique la modularité de leur composition. On peut en effet supposer un
tout original formé des propos p. 174-178 et p. 291-292, séparés par les
insertions et recompositions multiples qu’a connues le tome III.
, et fait le panégyrique de son livre, et le sien par
conséquent, il choisit ce temps pour s’en aller, croyant que l’on le
continuerait après qu’il serait sorti.
Cette remarque fait
référence aux propos tenus par Straton aux p. 174-178. Elle provient
d’un état antérieur des Nouvelles Nouvelles et
indique la modularité de leur composition. On peut en effet supposer un
tout original formé des propos p. 174-178 et p. 291-292, séparés par les
insertions et recompositions multiples qu’a connues le tome III.
, et fait le panégyrique de son livre, et le sien par
conséquent, il choisit ce temps pour s’en aller, croyant que l’on le
continuerait après qu’il serait sorti.
L’on ne doit pas s’étonner si nous parlâmes peu, Arimant et moi, pendant l’entretien de ces nouvellistes : nous y prenions trop de plaisir pour les interrompre et nous ne voulions être que spectateurs d’une si di-293293vertissante comédie. Pour ce qui est de Lisimon, que leur entretien ne divertissait point et qui ne se plaisait pas à entendre ces sortes de nouvelles, il sommeilla presque toujours pendant tout le temps qu’ils parlèrent.
Straton ne fut pas plus tôt sorti qu’Ariste prit la parole et qu’il acheva de la sorte son panégyrique :
— Celui que vous venez de voir et qui vient de sortir d’ici est un auteur qui a
fait profession de ne dire jamais de bien d’aucuns ouvrages, si ce n’est des
siens. C’est de plus un de ces fols de nouvellistes dont nous parlions tantôt.
Cependant le pauvre aveuglé ne se connaît point Les
discours sur la satire et la comédie relèvent souvent que ceux qui sont raillés
sont toujours les derniers à le remarquer. On trouve un exemple de
fâcheux qui s’emporte précisément contre les fâcheux avec le
personnage d’Ormin à la sc. III, 4 de la comédie éponyme de Molière. . Il ne fait
point de réflexion sur l’avidité avec laquelle il demande des nouvelles ni sur
la précipitation avec laquelle il en dit. 294294
Les
discours sur la satire et la comédie relèvent souvent que ceux qui sont raillés
sont toujours les derniers à le remarquer. On trouve un exemple de
fâcheux qui s’emporte précisément contre les fâcheux avec le
personnage d’Ormin à la sc. III, 4 de la comédie éponyme de Molière. . Il ne fait
point de réflexion sur l’avidité avec laquelle il demande des nouvelles ni sur
la précipitation avec laquelle il en dit. 294294
— Je m’étonne, lui dis-je, comment vous dites si librement votre pensée, après
avoir déclaré qu’il était votre ami La définition de la
véritable amitié est un motif topique. Il fera notamment le sujet du Favori de
Marie-Catherine Desjardins (1665) et du Misanthrope de
Molière (1666). .
La définition de la
véritable amitié est un motif topique. Il fera notamment le sujet du Favori de
Marie-Catherine Desjardins (1665) et du Misanthrope de
Molière (1666). .
— Quoi ! me repartit-il, ignorez-vous que dans ce siècle on n’est ni ami ni serviteur de tous ceux à qui l’on le dit ? Ce n’est pas, ajouta-t-il, que je sois son ennemi. Mais l’indifférence que j’ai pour lui me fait dire si librement qu’il ne se connaît pas.
— Il y en a bien d’autres, lui dis-je, qui ne se connaissent pas et qui, bien qu’ils soient aussi grands nouvellistes et aussi fols que lui, ne laissent pas que de le railler.
— Vous avez raison, me dit-il, et il faut avouer que c’est une étrange chose que le monde. Pour moi, je hais beaucoup ces sortes de railleries, et, bien que sur ce sujet je ne doive point appréhender que l’on 295295 me le rende, je ne veux néanmoins railler personne.
Jugez si nous pouvions nous empêcher de rire, d’entendre tenir sérieusement un semblable discours au plus grand et au plus fol des nouvellistes.
Comme devant, pendant et après le
dîner ils s’étaient
tous montré quelque chose les uns aux autres, ils se le demandèrent pour en
faire des copies La copie des pièces compte parmi les
principaux modes de circulation des pièces et des informations., mais chacun trouva sa réponse pour ne pas
laisser emporter ce qu’il avait. Lisimon dit que, pour lui, il ne voulait que
les nouvelles qui étaient au commencement de la lettre de Madrid
La copie des pièces compte parmi les
principaux modes de circulation des pièces et des informations., mais chacun trouva sa réponse pour ne pas
laisser emporter ce qu’il avait. Lisimon dit que, pour lui, il ne voulait que
les nouvelles qui étaient au commencement de la lettre de Madrid Il s’agit de la lettre reçue au tome II, p.
281sq.. , quoiqu’il y eût peu de chose et
que, si Arimant lui voulait faire prêter de l’encre et du papier, il les
décrirait
sur-le-champ. Les autres dirent que, si l’on leur voulait faire la 296296
même grâce, ils décriraient aussi
quelques-unes des pièces que l’on avait montrées. Arimant répondit qu’il le
ferait avec plaisir et, leur ayant fait apporter des plumes, du papier et de
l’encre, il prit congé d’eux et dit qu’il avait quelques affaires à la ville
avec moi, où il croyait pouvoir aller sans incivilité, parce qu’ils avaient de
quoi s’occuper tout le reste de l’après-dînée. Il leur dit encore qu’il leur disait adieu,
parce qu’il croyait ne revenir que bien tard.
Il s’agit de la lettre reçue au tome II, p.
281sq.. , quoiqu’il y eût peu de chose et
que, si Arimant lui voulait faire prêter de l’encre et du papier, il les
décrirait
sur-le-champ. Les autres dirent que, si l’on leur voulait faire la 296296
même grâce, ils décriraient aussi
quelques-unes des pièces que l’on avait montrées. Arimant répondit qu’il le
ferait avec plaisir et, leur ayant fait apporter des plumes, du papier et de
l’encre, il prit congé d’eux et dit qu’il avait quelques affaires à la ville
avec moi, où il croyait pouvoir aller sans incivilité, parce qu’ils avaient de
quoi s’occuper tout le reste de l’après-dînée. Il leur dit encore qu’il leur disait adieu,
parce qu’il croyait ne revenir que bien tard.
Quoique je n’eusse aucune affaire avec Arimant, je ne laissai pas que de le
suivre pour voir ce qu’il voulait de moi. Quand nous fûmes hors de la chambre,
il tira la porte après lui et en ouvrit doucement une qui joignait celle d’où
nous sortions. Il me fit entrer avec lui et, m’ayant 297297 prié de
parler bas, il me fit approcher contre la muraille et, ayant levé la tapisserie
qui était devant et ôté deux ou trois ais, j’y aperçus un trou en forme de petite fenêtre
qui n’était plus bouché que par la tapisserie de la chambre de nos
nouvellistes La pièce décrite est visible sur la
gravure du tome III, p. 304., qui était fort claire et au
travers de laquelle l’on les voyait et l’on les entendait facilement. Il me
donna ensuite un siège et en prit un pour lui ; et après que nous fûmes assis,
il me dit qu’il voulait avoir le plaisir de savoir ce que ces trois messieurs
diraient et feraient en leur particulier. Il me dit
encore que la lettre que je lui avais vu recevoir
La pièce décrite est visible sur la
gravure du tome III, p. 304., qui était fort claire et au
travers de laquelle l’on les voyait et l’on les entendait facilement. Il me
donna ensuite un siège et en prit un pour lui ; et après que nous fûmes assis,
il me dit qu’il voulait avoir le plaisir de savoir ce que ces trois messieurs
diraient et feraient en leur particulier. Il me dit
encore que la lettre que je lui avais vu recevoir Voir t.
II, p. 216-218. était une lettre supposée qu’il s’était fait apporter à
dessein par un de ses gens et qu’il l’avait laissée exprès sur leur table, avec
le papier qu’ils avaient 298298 tant souhaité de lire, pour voir s’ils
contenteraient leur curiosité.
Voir t.
II, p. 216-218. était une lettre supposée qu’il s’était fait apporter à
dessein par un de ses gens et qu’il l’avait laissée exprès sur leur table, avec
le papier qu’ils avaient 298298 tant souhaité de lire, pour voir s’ils
contenteraient leur curiosité.
À peine chacun eut-il choisi ce qu’il avait envie de décrire et mis la plume à la main pour cet effet que Lisimon s’aperçut que la lettre d’Arimant était demeurée sur la table et s’écria :
— C’est aujourd’hui que nous connaîtrons si nous sommes capables de résister
aux gênantes
tentations de la curiosité La curiosité est l’un des
thèmes centraux de la satire des nouvellistes..
Vous voyez sur cette table la lettre d’Arimant que nous avions tantôt si grande
envie de voir et que nous croyons si pleine de nouvelles.
La curiosité est l’un des
thèmes centraux de la satire des nouvellistes..
Vous voyez sur cette table la lettre d’Arimant que nous avions tantôt si grande
envie de voir et que nous croyons si pleine de nouvelles.
Ariste répondit que l’on la pouvait voir sans scrupule et qu’il était assuré, par ce qu’il en avait vu, qu’elle ne contenait que des nouvelles. Clorante ajouta que l’on la pouvait lire sans crainte d’être surpris, parce qu’Arimant n’était 299299 pas près de revenir. Arimant me dit alors tout bas :
— Eh bien ! n’étais-je pas sûr qu’ils ne pourraient résister à la violence de leur curiosité ?
— Écoutons, lui repartis-je, voyant que Lisimon allait commencer de lire ; car je vous jure que j’ai présentement plus d’envie qu’eux d’apprendre des nouvelles de cette lettre.
Je n’eus pas fini ces paroles que Lisimon commença.
À Rouen, ce… de février.
MONSIEUR,
Pour satisfaire à votre curiosité et pour répondre tout ensemble à
votre dernière lettre, je vous dirai que la manière dont vous parlez des trois
nouvellistes avec lesquels vous me 300300
mandez que vous dînâtes il
y a quelques jours, fait voir que vous ne les connaissez pas encore. Ce sont les
trois plus grands parleurs du royaume, aussi bien que les plus grands menteurs,
et leurs extravagances les ont fait connaître de tout le monde. Lisimon est un
fol sérieux qui veut faire le politique et qui divertit merveilleusement ceux
qui le mettent sur le chapitre des affaires d’État. Ariste est hardi, médisant,
brouillon et
ignorant. Il parle de tout, mais le plus souvent mal à propos et, bien qu’à
l’entendre dire il sache toutes choses, il ne sait néanmoins rien de vrai.
Clorante passe pour le plus raisonnable. L’on dit qu’il a de l’esprit et du feu,
mais que par l’habitude qu’il a prise de chercher et de débiter tout ce qui
se fait de nouveau L’obsession de la nouveauté et de
toujours « savoir des premiers » une information est une autre
caractéristique des nouvellistes. , il s’est rendu aussi
ridicule que les deux autres.
L’obsession de la nouveauté et de
toujours « savoir des premiers » une information est une autre
caractéristique des nouvellistes. , il s’est rendu aussi
ridicule que les deux autres.
Je vous envoie Le Portrait des 301301 nouvellistes : c’est
une pièce nouvelle que vous n’avez peut-être pas encore vue. Quoique ce portrait
ait été fait sur tous les nouvellistes en général, les trois dont je vous viens
de parler en sont néanmoins les principaux originaux Conformément à un usage fréquent dans la littérature mondaine, le
portrait s’applique aux nouvellistes, sans toutefois
qu’ils en soient les seuls référents possibles. Est ainsi mise en
oeuvre, au sein de la fiction, une procédure de lecture à clefs (Voir M.
Bombart, Le Savoir des clefs. Écritures et lectures à clef en
France au XVIIe siècle,à paraître, ainsi que A.
Arzoumanov, Pour lire les clés d’Ancien Régime,
Classiques Garnier, 2013). .
Conformément à un usage fréquent dans la littérature mondaine, le
portrait s’applique aux nouvellistes, sans toutefois
qu’ils en soient les seuls référents possibles. Est ainsi mise en
oeuvre, au sein de la fiction, une procédure de lecture à clefs (Voir M.
Bombart, Le Savoir des clefs. Écritures et lectures à clef en
France au XVIIe siècle,à paraître, ainsi que A.
Arzoumanov, Pour lire les clés d’Ancien Régime,
Classiques Garnier, 2013). .
Je vous prie de faire mes baisemains à messieurs de
Corneille, qui demeurent présentement à Paris De notoriété
publique, les frères Corneille résident effectivement à cette époque à
Paris. L'objectif de cette remarque n'est pas clair : s'agit-il, en les
mettant en correspondance étroite avec Cléodate, et en les chargeant de
la mission de lui « mander des nouvelles », d'en faire ironiquement des
nouvellistes ? Ou s'agit-il pour Donneau de s'afficher dans leur
familiarité ?, afin de n’être plus si éloignés du théâtre
et de mieux examiner ce qui s’y passe, et de me mander des nouvelles. Je suis,
De notoriété
publique, les frères Corneille résident effectivement à cette époque à
Paris. L'objectif de cette remarque n'est pas clair : s'agit-il, en les
mettant en correspondance étroite avec Cléodate, et en les chargeant de
la mission de lui « mander des nouvelles », d'en faire ironiquement des
nouvellistes ? Ou s'agit-il pour Donneau de s'afficher dans leur
familiarité ?, afin de n’être plus si éloignés du théâtre
et de mieux examiner ce qui s’y passe, et de me mander des nouvelles. Je suis,
Votre très humble serviteur,
CLEODATE La mention précise de Rouen et des frères
Corneille invite à lier ce nom à une personne réelle, selon un protocole
de lecture à clefs. Toutefois le pseudonyme de Cléodate n’apparaît pas
dans le Dictionnaire des précieuses. Il est certes
attribué au duc de Guise dans L’Amour échappé, mais il ne
s’agit plus alors d’Henri II de Guise, protecteur des Corneille, mais de
son neveu Louis Joseph de Guise. .
La mention précise de Rouen et des frères
Corneille invite à lier ce nom à une personne réelle, selon un protocole
de lecture à clefs. Toutefois le pseudonyme de Cléodate n’apparaît pas
dans le Dictionnaire des précieuses. Il est certes
attribué au duc de Guise dans L’Amour échappé, mais il ne
s’agit plus alors d’Henri II de Guise, protecteur des Corneille, mais de
son neveu Louis Joseph de Guise. .
Si la crainte d’être découvert et de ne pouvoir par ce moyen entendre lire le
Portrait des nouvellistes ne m’eût retenu, je me fusse sans doute éclaté de rire
pendant la lecture de cette lettre La lecture se fait
donc à voix haute.. 302302 Mais je m’en empêchai
pour avoir le plaisir de voir quelle mine feraient et que diraient ces trois
curieux punis. Lisimon laissa tomber la lettre sur la table, après l’avoir lue,
comme si le dépit lui
eût ôté toutes ses forces, et il n’eut pas l’assurance de proférer une seule
parole. Clorante baissa les yeux et jeta quelques languissantes
œillades sur la même
lettre et sur Lisimon. Pour Ariste, après avoir été quelque temps sans parler et
sans savoir quelle contenance tenir, il se leva et fit trois ou quatre tours
dans la chambre, en frappant du pied et en murmurant entre ses dents.
La lecture se fait
donc à voix haute.. 302302 Mais je m’en empêchai
pour avoir le plaisir de voir quelle mine feraient et que diraient ces trois
curieux punis. Lisimon laissa tomber la lettre sur la table, après l’avoir lue,
comme si le dépit lui
eût ôté toutes ses forces, et il n’eut pas l’assurance de proférer une seule
parole. Clorante baissa les yeux et jeta quelques languissantes
œillades sur la même
lettre et sur Lisimon. Pour Ariste, après avoir été quelque temps sans parler et
sans savoir quelle contenance tenir, il se leva et fit trois ou quatre tours
dans la chambre, en frappant du pied et en murmurant entre ses dents.
Enfin, après avoir tous été quelque temps à se regarder l’un l’autre sans se parler, Clorante prit la parole et dit :
— Nous n’avons pas tant de sujet d’être fâchés 303303 que nous faisons
voir de tristesse. C’est un
homme comme nous qui nous veut railler, et quiconque raille son semblable
se raille soi-même Adaptation de Proverbes
17:5 : « Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a
fait; Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. »,
parfois lu comme « Celui qui raille et méprise le pauvre doit se
souvenir qu’il se fait injure à soi-même, puisque c’est son frère et son
semblable qu’il méprise ». . Chacun a son
sentiment
Adaptation de Proverbes
17:5 : « Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a
fait; Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. »,
parfois lu comme « Celui qui raille et méprise le pauvre doit se
souvenir qu’il se fait injure à soi-même, puisque c’est son frère et son
semblable qu’il méprise ». . Chacun a son
sentiment La diversité des opinions est un motif évoqué
dans L’Ecole des femmes de Molière. qui lui est particulier, et l’on
peut passer pour ridicule aux yeux des uns et pour sage aux yeux des autres.
Nous voyons tous les jours de pareils exemples et ce qui doit enfin nous servir
de consolation, c’est que l’on ne peut empêcher le monde de médire et que, quoi
que l’on dise et que l’on écrive contre une personne, il ne s’ensuit pas pour
cela que ce que l’on dit et que ce que l’on écrit soit véritable. Lisons
attentivement ce portrait et, si nous n’y trouvons rien qui nous touche, n’en
paraissons ni fâchés ni offensés. Si, au contraire, nous y découvrons nos 304304 défauts, qu’il nous serve à nous en corriger
La diversité des opinions est un motif évoqué
dans L’Ecole des femmes de Molière. qui lui est particulier, et l’on
peut passer pour ridicule aux yeux des uns et pour sage aux yeux des autres.
Nous voyons tous les jours de pareils exemples et ce qui doit enfin nous servir
de consolation, c’est que l’on ne peut empêcher le monde de médire et que, quoi
que l’on dise et que l’on écrive contre une personne, il ne s’ensuit pas pour
cela que ce que l’on dit et que ce que l’on écrit soit véritable. Lisons
attentivement ce portrait et, si nous n’y trouvons rien qui nous touche, n’en
paraissons ni fâchés ni offensés. Si, au contraire, nous y découvrons nos 304304 défauts, qu’il nous serve à nous en corriger Cléante fait ici preuve de bon sens et reprend le projet formulé dans
la préface des Nouvelles Nouvelles : « Ceux qui prendront
« Les Nouvellistes » pour une satire ne s'en doivent point fâcher, à moins
qu'ils ne veuillent faire voir qu'ils sont du nombre. Pour moi, j'avoue
que j'en suis, avec beaucoup d'autres qui ne croient pas en être, mais
j'ai cet avantage par-dessus eux que je connais mes défauts et que je
tâche à m'en corriger en leur montrant les leurs » (p. XXII). .
Cléante fait ici preuve de bon sens et reprend le projet formulé dans
la préface des Nouvelles Nouvelles : « Ceux qui prendront
« Les Nouvellistes » pour une satire ne s'en doivent point fâcher, à moins
qu'ils ne veuillent faire voir qu'ils sont du nombre. Pour moi, j'avoue
que j'en suis, avec beaucoup d'autres qui ne croient pas en être, mais
j'ai cet avantage par-dessus eux que je connais mes défauts et que je
tâche à m'en corriger en leur montrant les leurs » (p. XXII). .
— Vous faites bien voir par ce discours que celui qui a écrit cette piquante lettre était bien instruit que vous aviez de l’esprit, lui répondit Ariste, puisque vous témoignez si peu de dépit d’un affront si sensible.
Après cela, il prit Le Portrait, qu’il lut, ne pouvant plus retenir sa
curiosité. En voici une copie, qu’Arimant, qui en est l’auteur, me donna le
lendemain pour s’acquitter de ce qu’il m’avait promis Arimant avait promis au narrateur qu’il verrait le contenu de la lettre
à la p. 218 du tome II..
Arimant avait promis au narrateur qu’il verrait le contenu de la lettre
à la p. 218 du tome II..
Détail de la seconde gravure du tome III (p. 304). © BNF

305305
PORTRAIT DES NOUVELLISTES Ici débute le
« Portrait des nouvellistes »,
dernière pièce insérée des Nouvelles Nouvelles.
Ici débute le
« Portrait des nouvellistes »,
dernière pièce insérée des Nouvelles Nouvelles.
L’expérience nous fait voir tous les jours bien des choses qui sont tellement
dépendantes les unes des autres ou, pour mieux dire, tellement enchaînées
ensemble, que l’on n’en saurait avoir une sans avoir en même temps celle qui lui
touche de plus près et qui en est, pour ainsi dire, comme inséparable. C’est ce
que nous voyons dans la personne de ceux dont j’entreprends de vous faire 306306 le portrait, qui ne peuvent être nouvellistes sans être curieux,
parce qu’il faut savoir les nouvelles avant que de les raconter Idée qui se retrouve notamment chez Pascal : « Curiosité
n’est que vanité le plus souvent. On ne veut savoir que pour en
parler. » (Pensées, Fragment
112). et que, pour les savoir, il faut être curieux, parce que
c’est la curiosité qui oblige à demander tout ce qui se passe dans le
monde
Idée qui se retrouve notamment chez Pascal : « Curiosité
n’est que vanité le plus souvent. On ne veut savoir que pour en
parler. » (Pensées, Fragment
112). et que, pour les savoir, il faut être curieux, parce que
c’est la curiosité qui oblige à demander tout ce qui se passe dans le
monde Les vertus d’une curiosité nécessaire ont été
débattus et soulignés en 1661 dans le prologue de
Célinte.. Et cette sorte de curiosité étant
mise aujourd’hui entre les maladies de l’âme, il est difficile, ou plutôt
impossible, d’être curieux et raisonnable tout ensemble, ce qui fait voir
l’impossibilité qu’il y a d’être nouvelliste sans être
impertinent
Les vertus d’une curiosité nécessaire ont été
débattus et soulignés en 1661 dans le prologue de
Célinte.. Et cette sorte de curiosité étant
mise aujourd’hui entre les maladies de l’âme, il est difficile, ou plutôt
impossible, d’être curieux et raisonnable tout ensemble, ce qui fait voir
l’impossibilité qu’il y a d’être nouvelliste sans être
impertinent La curiosité excessive est l’un des traits
caractéristiques du caractère de
nouvelliste., parce qu’il y a des nouvelles que l’on ne
peut débiter sans avoir auparavant fait voir sa curiosité en les demandant.
La curiosité excessive est l’un des traits
caractéristiques du caractère de
nouvelliste., parce qu’il y a des nouvelles que l’on ne
peut débiter sans avoir auparavant fait voir sa curiosité en les demandant.
Commençons donc par là le portrait des nouvellistes et disons d’abord qu’elle
les rend insupportables à ceux qui ont as-307307sez de malheur pour se
rencontrer en conversation avec eux, puisque leur avidité d’apprendre tout ce
qui se passe est telle que, pour peu qu’ils connaissent une personne, ils
ne l’abordent jamais qu’en lui disant En tant que fâcheux,
les nouvellistes dérogent
constamment aux normes de la civilité. Donneau reprend ici un motif
topique déjà présent dans le huitième caractère de Théophraste, et dont
on trouve une expression très similaire dans la « Pantagrueline
pronostication » de Rabelais (rééditée en 1659 à Amsterdam) : « Ce que
nous voyons encore de jour en jour par la France, où le premier propos
qu’on tient à gens fraîchement arrivés sont : Quelles nouvelles ?
Savez-vous rien de nouveau ? Que dit-on ? Quel bruit-on par le monde ? »
(p. 359) ainsi que dans la satire du poète burlesque Mattio Franzesi, l’une des sources
de Donneau : «
Doppo la prima, o seconda parole, / T’affrontan con un certo, che si
dice ? » (sur cette satire voir M. Infelise, Prima dei
Giornali, Roma, Laterza, 2002, notamment p. 141).
: « Qu’y a-t-il de nouveau aujourd’hui ? » ou bien : « Que dit-on
? que m’apprendrez-vous de bon ? quelle nouvelle savez-vous ? » et, après que
l’on leur a dit ce que l’on sait, ils demandent encore si l’on ne sait rien
de nouveau
En tant que fâcheux,
les nouvellistes dérogent
constamment aux normes de la civilité. Donneau reprend ici un motif
topique déjà présent dans le huitième caractère de Théophraste, et dont
on trouve une expression très similaire dans la « Pantagrueline
pronostication » de Rabelais (rééditée en 1659 à Amsterdam) : « Ce que
nous voyons encore de jour en jour par la France, où le premier propos
qu’on tient à gens fraîchement arrivés sont : Quelles nouvelles ?
Savez-vous rien de nouveau ? Que dit-on ? Quel bruit-on par le monde ? »
(p. 359) ainsi que dans la satire du poète burlesque Mattio Franzesi, l’une des sources
de Donneau : «
Doppo la prima, o seconda parole, / T’affrontan con un certo, che si
dice ? » (sur cette satire voir M. Infelise, Prima dei
Giornali, Roma, Laterza, 2002, notamment p. 141).
: « Qu’y a-t-il de nouveau aujourd’hui ? » ou bien : « Que dit-on
? que m’apprendrez-vous de bon ? quelle nouvelle savez-vous ? » et, après que
l’on leur a dit ce que l’on sait, ils demandent encore si l’on ne sait rien
de nouveau Cf. Théophraste : « Mais avant que l'autre
réponde "ça va", il reprend : "tu demandes si on ne raconte rien de neuf
? Eh ! bien, oui, on en raconte de bonnes !". Et sans laisser venir la
réponse, il poursuit : "qu'en dis-tu ? tu n'as rien entendu ? je crois
bien que je vais te les faire déguster, les dernières nouvelles" »
(traduction de Marie-Paule Loicq-Berger,
2002), de même que si l’on ne leur avait rien dit; et s’il
arrive que quelqu’un survienne, ils font encore la même demande.
Cf. Théophraste : « Mais avant que l'autre
réponde "ça va", il reprend : "tu demandes si on ne raconte rien de neuf
? Eh ! bien, oui, on en raconte de bonnes !". Et sans laisser venir la
réponse, il poursuit : "qu'en dis-tu ? tu n'as rien entendu ? je crois
bien que je vais te les faire déguster, les dernières nouvelles" »
(traduction de Marie-Paule Loicq-Berger,
2002), de même que si l’on ne leur avait rien dit; et s’il
arrive que quelqu’un survienne, ils font encore la même demande.
Ils pressent bien souvent les gens par une curiosité insupportable de leur dire ce que l’on doit tenir secret, ce qu’ils voient bien que l’on ne leur veut pas découvrir, ou ce que l’on ne sait pas même quelque-308308fois ; et quand ils voient que l’on n’a plus rien à leur dire, parce qu’ils ne savent plus que demander, ils interrogent ceux avec qui ils sont sur leurs actions et sur leurs pensées.
Ensuite ils tirent des conjectures sur les choses présentes La satire de Mattio Franzesi évoquait elle aussi les
conjectures des nouvellistes : « Lasciamo astrologare à chi indovina /
Per vie di conjetture e di discorsi » En présentant les nouvellistes
comme incapables de comprendre ce qu’ils lisent et en ridiculisant les
interprétations douteuses qu’ils formulent, Donneau de Visé invite
les lecteurs à se méfier des rumeurs et conjectures qu’ils pourraient
entendre. , afin de parler des nouvelles futures et,
lorsque l’on ne tombe pas de leur sentiment, ils se mettent en colère.
Ils ne rencontrent point de valets qu’ils ne leur demandent ce que font leurs
maîtres
La satire de Mattio Franzesi évoquait elle aussi les
conjectures des nouvellistes : « Lasciamo astrologare à chi indovina /
Per vie di conjetture e di discorsi » En présentant les nouvellistes
comme incapables de comprendre ce qu’ils lisent et en ridiculisant les
interprétations douteuses qu’ils formulent, Donneau de Visé invite
les lecteurs à se méfier des rumeurs et conjectures qu’ils pourraient
entendre. , afin de parler des nouvelles futures et,
lorsque l’on ne tombe pas de leur sentiment, ils se mettent en colère.
Ils ne rencontrent point de valets qu’ils ne leur demandent ce que font leurs
maîtres Possiblement inspiré du huitième caractère de
Théophraste : « Sa source, c'est un soldat ou un petit esclave d'Asteios
le joueur de flûte » (trad. M.-P. Loicq-Berger,
2002), et les leurs ne viennent jamais de dehors
qu’ils ne leur
demandent ce que l’on fait et ce que l’on dit à la ville. Si quelque paysan
vient chez eux, ils lui demandent ce que l’on dit à son village et à la campagne
; si c’est un bourgeois, ce que l’on dit à son quartier ; et si c’est un
provincial, ce que l’on dit à sa 309309 ville et dans sa province. Dès
que l’on les voit entrer dans quelque maison, l’on dit aussitôt : « Voici tels et
tels ! sans doute qu’ils nous diront quelque chose de nouveau, car ils savent
toujours tout ce qui se passe ».
Possiblement inspiré du huitième caractère de
Théophraste : « Sa source, c'est un soldat ou un petit esclave d'Asteios
le joueur de flûte » (trad. M.-P. Loicq-Berger,
2002), et les leurs ne viennent jamais de dehors
qu’ils ne leur
demandent ce que l’on fait et ce que l’on dit à la ville. Si quelque paysan
vient chez eux, ils lui demandent ce que l’on dit à son village et à la campagne
; si c’est un bourgeois, ce que l’on dit à son quartier ; et si c’est un
provincial, ce que l’on dit à sa 309309 ville et dans sa province. Dès
que l’on les voit entrer dans quelque maison, l’on dit aussitôt : « Voici tels et
tels ! sans doute qu’ils nous diront quelque chose de nouveau, car ils savent
toujours tout ce qui se passe ».
S’il se fait quelque affaire d’importance et qu’il arrive quelque nouveau
changement dans l’État, ils disent aussitôt qu’ils l’avaient prédit Cette critique reprend celle faite à l’astrologie, telle qu’on la trouve formulée dans
Célinte de Madeleine de Scudéry. . Comme ils
raisonnent généralement sur toutes choses et qu’ils se mêlent de tout savoir,
ils sont tous rois, ministres, juges, capitaines et soldats, ce qui fait que
l’on voit bien des rois sans royaume, des ministres sans affaires, des juges
sans juridiction, des capitaines sans soldats et des soldats sans emploi.
Cette critique reprend celle faite à l’astrologie, telle qu’on la trouve formulée dans
Célinte de Madeleine de Scudéry. . Comme ils
raisonnent généralement sur toutes choses et qu’ils se mêlent de tout savoir,
ils sont tous rois, ministres, juges, capitaines et soldats, ce qui fait que
l’on voit bien des rois sans royaume, des ministres sans affaires, des juges
sans juridiction, des capitaines sans soldats et des soldats sans emploi.
Si l’on leur montre quelques lettres qui 310310 soient pleines de
nouvelles, ou quelques vers nouveaux, et qu’il arrive que par hasard, ou plutôt
par miracle, ils ne les aient pas encore vus (car à les ouïr parler, on ne
saurait leur rien faire voir de nouveau et ils ont toujours tout vu ce que
l’on leur montre Motif apparu au tome II, p. 14, dans la
bouche de Cléante : « il ne se fait rien de nouveau dans Paris que je
n’aie des premiers ». ), ils prient aussitôt que l’on les
leur prête pour en faire des copies à des duchesses et à des princesses qui les
ont priés de leur donner tout ce qui se fait de nouveau.
Motif apparu au tome II, p. 14, dans la
bouche de Cléante : « il ne se fait rien de nouveau dans Paris que je
n’aie des premiers ». ), ils prient aussitôt que l’on les
leur prête pour en faire des copies à des duchesses et à des princesses qui les
ont priés de leur donner tout ce qui se fait de nouveau.
Dès qu’ils entrent dans une compagnie, ils demandent des nouvelles, ou ils en
débitent, et rompent souvent par là une conversation plus utile et plus agréable
que ce qu’ils disent. Leurs discours sont interrompus, et ils passent souvent
d’une chose à une autre. Quand on leur a promis quelque chose 311311 de
nouveau, si l’on manque à leur donner, ils tourmentent ceux qui leur ont promis
et leur demandent partout où ils les rencontrent L'opiniâtreté est inconvenante. On trouve
toutefois cette insistance dans les correspondances contemporaines
réelles, telles que celle entre l’abbé Bernou et Eusèbe
Renaudot, alors directeur de la Gazette.
.
L'opiniâtreté est inconvenante. On trouve
toutefois cette insistance dans les correspondances contemporaines
réelles, telles que celle entre l’abbé Bernou et Eusèbe
Renaudot, alors directeur de la Gazette.
.
Ils sont hardis et entrent en des lieux où ils ne devraient pas. S’ils voient trois ou quatre personnes ensemble qui s’entretiennent, ils se mettent derrière elles pour les écouter et, quand ils connaissent qu’elles s’entretiennent de choses qui leur plaisent, ils se mêlent hardiment avec elles, bien qu’ils ne les connaissent pas.
Une des plus illustres et des plus savantes filles de ce siècle Donneau de Visé se réfère à un portrait que Madeleine de
Scudéry dresse à la cinquième partie de sa
Clélie. Il s’agit d’un homme dont la principale caractéristique
est d’être un menteur et qui ne se rencontre « guère qu’aux places
publiques, où l’on s’entretient des affaires générales » et qui débite de
fausses nouvelles. les a nommés, dans un de ses ouvrages,
« des imposteurs universels
Donneau de Visé se réfère à un portrait que Madeleine de
Scudéry dresse à la cinquième partie de sa
Clélie. Il s’agit d’un homme dont la principale caractéristique
est d’être un menteur et qui ne se rencontre « guère qu’aux places
publiques, où l’on s’entretient des affaires générales » et qui débite de
fausses nouvelles. les a nommés, dans un de ses ouvrages,
« des imposteurs universels Note de l'auteur en marge
de cette expression : "L'Illustre Sapho dans la Clélie » et
Scarron, dans son Épître chagrine des Fâcheux
Note de l'auteur en marge
de cette expression : "L'Illustre Sapho dans la Clélie » et
Scarron, dans son Épître chagrine des Fâcheux Célèbre
satire, imprimée en 1659, qui inspira Les Fâcheux de Molière et que
Donneau citait également en ouverture du tome II. , pour
montrer qu’ils sont du nombre, dit que 312312
Célèbre
satire, imprimée en 1659, qui inspira Les Fâcheux de Molière et que
Donneau citait également en ouverture du tome II. , pour
montrer qu’ils sont du nombre, dit que 312312
Ceux qui toujours débitent des nouvelles,
Sans qu’on les ait priés d’en
débiter,
sont tout à fait fâcheux. Mais il ne faut pas s’étonner s’ils le sont aux
autres, puisqu’ils le sont à eux-mêmes, ou du moins qu’ils le devraient être, lorsqu’ils se
donnent la peine d’écrire sur des tablettes La tablette
est un support d’écriture courant et souvent mentionné dans la fiction
des années 1660 (R. Chartier, Inscrire et effacer, Paris,
Gallimard, 2005, p. 13 et p. 46-48, et C. Hogg, « Pour une esthétique
des tablettes : Clélie et les tablettes à écrire au XVIIe siècle. »
Seventeenth-Century French Studies, no 28, 2006, p.
117-133). toutes les nouvelles que l’on leur dit et de le
faire même dans la rue, quand ils s’y rencontrent.
La tablette
est un support d’écriture courant et souvent mentionné dans la fiction
des années 1660 (R. Chartier, Inscrire et effacer, Paris,
Gallimard, 2005, p. 13 et p. 46-48, et C. Hogg, « Pour une esthétique
des tablettes : Clélie et les tablettes à écrire au XVIIe siècle. »
Seventeenth-Century French Studies, no 28, 2006, p.
117-133). toutes les nouvelles que l’on leur dit et de le
faire même dans la rue, quand ils s’y rencontrent.
S’il arrive que l’on leur dise quelques nouvelles qu’ils sachent déjà, ils
prennent aussitôt la parole et poursuivent ce que l’on a déjà commencé de leur
dire, sans donner le temps d’achever à celui qui parle et sans considérer 313313 qu’il ne faut qu’une circonstance pour rendre les mêmes
nouvelles différentes Idée déjà exprimée dans la seconde
partie des Nouvelles Nouvelles, p. 263 : « Elles [les
nouvelles] ne sont jamais en même état ; c’est une pâte que l’on pétrit
et repétrit sans cesse, et à quoi l’on donne cent formes différentes,
sans la laisser un moment dans la même. » .
Idée déjà exprimée dans la seconde
partie des Nouvelles Nouvelles, p. 263 : « Elles [les
nouvelles] ne sont jamais en même état ; c’est une pâte que l’on pétrit
et repétrit sans cesse, et à quoi l’on donne cent formes différentes,
sans la laisser un moment dans la même. » .
Les nouvellistes d’État, pour donner crédit à leurs nouvelles Déclarer ses sources est une pratique recommandée par tous
les historiens, un équivalent de nos protocoles de fact
checking. En démontrant la facilité avec laquelle cette
opération peut être contrefaite, Donneau de Visé sape la crédibilité des
informations qui circulent, même lorsqu’elles sont appuyées par des
sources. Cette invitation au scepticisme constitue une technique de
contrôle de l’information. Molière fera de même au début de La Comtesse
d’Escarbagnas,
en dépeignant un nouvelliste qui lui présente « deux feuilles de papier,
pleines jusques aux bords d’un grand fatras de balivernes, qui viennent,
m’a-t-il dit, de l’endroit le plus sûr du monde. » , disent
le plus souvent qu’ils les ont ouï dire à quelque grand seigneur, et ceux de Parnasse aux auteurs qui sont le plus en
réputation. Les uns et les autres sont le plus souvent chargés de papiers : ils
font eux-mêmes des nouvelles plutôt que d’en manquer, et cela leur arrive bien
souvent, parce qu’ils y prennent plaisir.
Déclarer ses sources est une pratique recommandée par tous
les historiens, un équivalent de nos protocoles de fact
checking. En démontrant la facilité avec laquelle cette
opération peut être contrefaite, Donneau de Visé sape la crédibilité des
informations qui circulent, même lorsqu’elles sont appuyées par des
sources. Cette invitation au scepticisme constitue une technique de
contrôle de l’information. Molière fera de même au début de La Comtesse
d’Escarbagnas,
en dépeignant un nouvelliste qui lui présente « deux feuilles de papier,
pleines jusques aux bords d’un grand fatras de balivernes, qui viennent,
m’a-t-il dit, de l’endroit le plus sûr du monde. » , disent
le plus souvent qu’ils les ont ouï dire à quelque grand seigneur, et ceux de Parnasse aux auteurs qui sont le plus en
réputation. Les uns et les autres sont le plus souvent chargés de papiers : ils
font eux-mêmes des nouvelles plutôt que d’en manquer, et cela leur arrive bien
souvent, parce qu’ils y prennent plaisir.
Lorsque l’on parle d’une chose, ils disent toujours qu’ils en savent le
secret Parmi les caractéristiques des nouvellistes, une
fascination pour le secret qui les rend ridicules. Le huitième caractère
de Théophraste met également en évidence cette caractéristique : « Il
dit avoir entendu chuchoter qu'un individu au courant de tous les faits
se trouve caché auprès d'eux dans une maison depuis son arrivée de
Macédoine, voici quatre jours. » (trad. M.-P. Loicq-Berger,
2002) L’on retrouve la même caractéristique dans la source
anglaise de la
satire, The New Cry de Ben Jonson : « And talk reserv'd,
lock'd up, and full of fear; / Nay, ask you how the day goes, in your
ear. / Keep a Star-chamber sentence close twelve days: / And whisper
what a Proclamation says. ». et, après l’avoir répété deux
ou trois fois pour se faire prier de le dire sans qu’on leur demande, ils le
disent ensuite sans qu’on les en prie, et s’ils n’avaient fait serment de ne 314314 rien garder sur leur cœur et de ne rien avoir de
particulier,
ils n’en diraient rien ; mais, d’un autre côté, pour punir ces gens-là de leur
peu de curiosité, ils parlent si longtemps qu’ils ennuient furieusement par
leurs longs discours ceux qui les écoutent : l’on ne saurait dire un mot d’une
affaire, qu’ils ne disent
qu’ils la savent à fond.
Parmi les caractéristiques des nouvellistes, une
fascination pour le secret qui les rend ridicules. Le huitième caractère
de Théophraste met également en évidence cette caractéristique : « Il
dit avoir entendu chuchoter qu'un individu au courant de tous les faits
se trouve caché auprès d'eux dans une maison depuis son arrivée de
Macédoine, voici quatre jours. » (trad. M.-P. Loicq-Berger,
2002) L’on retrouve la même caractéristique dans la source
anglaise de la
satire, The New Cry de Ben Jonson : « And talk reserv'd,
lock'd up, and full of fear; / Nay, ask you how the day goes, in your
ear. / Keep a Star-chamber sentence close twelve days: / And whisper
what a Proclamation says. ». et, après l’avoir répété deux
ou trois fois pour se faire prier de le dire sans qu’on leur demande, ils le
disent ensuite sans qu’on les en prie, et s’ils n’avaient fait serment de ne 314314 rien garder sur leur cœur et de ne rien avoir de
particulier,
ils n’en diraient rien ; mais, d’un autre côté, pour punir ces gens-là de leur
peu de curiosité, ils parlent si longtemps qu’ils ennuient furieusement par
leurs longs discours ceux qui les écoutent : l’on ne saurait dire un mot d’une
affaire, qu’ils ne disent
qu’ils la savent à fond.
Il y a des nouvellistes qui remplissent ordinairement trois ou quatre boutiques
de libraires qui sont sur le quai des Augustins Situé dans
le prolongement du Pont-Neuf, le quai des Augustins est
un lieu de circulation de l’information. En 1681, un
almanach gravé mettra en scène des nouvellistes dans ce lieu.
. Ils y passent des journées entières à lire les vieilles
gazettes d’Angleterre, de Hollande, de Bruxelles et autres gazettes
étrangères
Situé dans
le prolongement du Pont-Neuf, le quai des Augustins est
un lieu de circulation de l’information. En 1681, un
almanach gravé mettra en scène des nouvellistes dans ce lieu.
. Ils y passent des journées entières à lire les vieilles
gazettes d’Angleterre, de Hollande, de Bruxelles et autres gazettes
étrangères Face à la Gazette officielle
de France, les gazettes étrangères, dont la diffusion sur le territoire
français est plus ou moins toléré selon les périodes, sont réputées
offrir des informations concurrentes (voir G. Feyel, L’Annonce et
la nouvelle, Oxford, Voltaire Foundation, 2000).
, où ils trouvent quantité de menteries et de nouvelles qui
sont souvent âgées de plus de six mois, qu’ils débitent comme quelque chose de
315315 nouveau. Ils connaissent les plus habiles de chaque art. Ceux
d’entre eux qui ne veulent savoir les nouvelles que pour les redire peuvent être
nommés regrattiers de
nouvelles
Face à la Gazette officielle
de France, les gazettes étrangères, dont la diffusion sur le territoire
français est plus ou moins toléré selon les périodes, sont réputées
offrir des informations concurrentes (voir G. Feyel, L’Annonce et
la nouvelle, Oxford, Voltaire Foundation, 2000).
, où ils trouvent quantité de menteries et de nouvelles qui
sont souvent âgées de plus de six mois, qu’ils débitent comme quelque chose de
315315 nouveau. Ils connaissent les plus habiles de chaque art. Ceux
d’entre eux qui ne veulent savoir les nouvelles que pour les redire peuvent être
nommés regrattiers de
nouvelles Un regrattier est un négociant, qui achète en
gros et revend au détail, donc qui ne propose rien de nouveau, rien de
son cru. La critique de la mercantilisation de l'information constituait
l'un des principaux dans le Staple of News de Ben Jonson,
l'une des sources possibles de
Donneau., parce qu’ils les vont prendre avant qu’elles
arrivent pour les débiter avant qu’elles soient sues de tout le monde.
Un regrattier est un négociant, qui achète en
gros et revend au détail, donc qui ne propose rien de nouveau, rien de
son cru. La critique de la mercantilisation de l'information constituait
l'un des principaux dans le Staple of News de Ben Jonson,
l'une des sources possibles de
Donneau., parce qu’ils les vont prendre avant qu’elles
arrivent pour les débiter avant qu’elles soient sues de tout le monde.
Ils savent tous, tous les festins, les bals, les comédies, les assemblées et généralement tout ce que font les personnes de qualité. Ils savent tous les grands procès et plaident souvent au milieu d’une troupe de leurs semblables la cause de l’une des parties et donnent ensuite un arrêt, qu’ils soutiennent devoir être tel à moins qu’il y ait de l’injustice.
Ils donneraient tout ce que l’on voudrait pour avoir une nou-316316velle
que personne ne sût encore, parce que ceux qui ont des premiers des nouvelles
secrètes sont estimés entre les nouvellistes L’intérêt
d’une nouvelle dépendant évidemment de sa fraîcheur, la valeur d’un
correspondant se mesure à la capacité de faire parvenir des nouvelles
inédites (voir N. Schapira, Un professionnel des lettres,
Seyssel, Champ Vallon, 2003, p. 265-268). , à cause que
l’on s’imagine qu’ils connaissent grand monde et qu’ils ont entrée chez beaucoup
de gens de qualité, ce qui fait que l’on leur ajoute plus de foi qu’aux autres.
L’intérêt
d’une nouvelle dépendant évidemment de sa fraîcheur, la valeur d’un
correspondant se mesure à la capacité de faire parvenir des nouvelles
inédites (voir N. Schapira, Un professionnel des lettres,
Seyssel, Champ Vallon, 2003, p. 265-268). , à cause que
l’on s’imagine qu’ils connaissent grand monde et qu’ils ont entrée chez beaucoup
de gens de qualité, ce qui fait que l’on leur ajoute plus de foi qu’aux autres.
Quand il se doit faire quelque cérémonie, ils ordonnent des rangs Lors d’une fête ou d’une cérémonie, le rang de chaque
individu revêt un enjeu stratégique (voir Fanny Cosandey, Le
Rang, Gallimard, 2016). La publication de ce rang (orale ou
écrite) revêt alors un enjeu majeur, puisqu’il indique le statut social
du participant et établit un précédent. Dans sa satire, Donneau dépeint
donc les nouvellistes comme une menace pour l’ordre social.
et disposent de tout à leur fantaisie. Quand la cérémonie est
passée, ils disent tout ce que l’on y a fait de bien et de mal, et ils ne
manquent jamais, le lendemain d’une bataille, d’une prise de ville, d’une fête
publique, ou de la première représentation d’une comédie nouvelle, d’aller à
tous les lieux de leurs assemblées pour en dire des particu-317317larités
Lors d’une fête ou d’une cérémonie, le rang de chaque
individu revêt un enjeu stratégique (voir Fanny Cosandey, Le
Rang, Gallimard, 2016). La publication de ce rang (orale ou
écrite) revêt alors un enjeu majeur, puisqu’il indique le statut social
du participant et établit un précédent. Dans sa satire, Donneau dépeint
donc les nouvellistes comme une menace pour l’ordre social.
et disposent de tout à leur fantaisie. Quand la cérémonie est
passée, ils disent tout ce que l’on y a fait de bien et de mal, et ils ne
manquent jamais, le lendemain d’une bataille, d’une prise de ville, d’une fête
publique, ou de la première représentation d’une comédie nouvelle, d’aller à
tous les lieux de leurs assemblées pour en dire des particu-317317larités La description renvoie également aux
pratiques de l'historiographie et du marché de l’information. Rien n’a
plus de valeur en effet que de connaître les « particularités »,
c’est-à-dire, des compléments d’information, des détails ou des causes
secrètes. Expliquer la cause des événements rend « l’histoire curieuse »
selon René Rapin. On remercie un correspondant d’avoir fourni des
particularités ; les Extraordinaires en annoncent
régulièrement dans leur titres ; le Mercure galant se différencie de la
Gazette en soulignant les particularités qu’il peut
fournir, car « s’il fallait qu’elle [la Gazette] dît
toutes les particularités de toutes choses, il faudrait souvent qu’elle
fît trois volumes au lieu de trois cahiers. » (vol. 3, 1673). et pour en apprendre.
La description renvoie également aux
pratiques de l'historiographie et du marché de l’information. Rien n’a
plus de valeur en effet que de connaître les « particularités »,
c’est-à-dire, des compléments d’information, des détails ou des causes
secrètes. Expliquer la cause des événements rend « l’histoire curieuse »
selon René Rapin. On remercie un correspondant d’avoir fourni des
particularités ; les Extraordinaires en annoncent
régulièrement dans leur titres ; le Mercure galant se différencie de la
Gazette en soulignant les particularités qu’il peut
fournir, car « s’il fallait qu’elle [la Gazette] dît
toutes les particularités de toutes choses, il faudrait souvent qu’elle
fît trois volumes au lieu de trois cahiers. » (vol. 3, 1673). et pour en apprendre.
Tout le monde les connaît et les remarque en passant, et ils sont estimés des uns comme des oracles, et des autres comme de grands et hardis menteurs. Ainsi ils sont estimés des fols et raillés des gens d’esprit.
Quand ils tiennent un homme entre eux qui ne fait qu’arriver d’un pays étranger, ou qui vient de quelque spectacle qu’ils n’aient pas encore vu, il est si accablé de leurs questions qu’il ne sait auquel répondre.
Ils ont des recueils de tout ce qui s’est fait sur toutes les choses
mémorables La pratique consistant à recueillir et
relier des informations et des documents manuscrits et imprimés est
courante. Certains recueils sont d’ailleurs imprimés, tels que les
multiples ouvrage intitulés « Recueils de pièces curieuses… ». Les
périodiques préparaient d’ailleurs cet usage, à l’image de la
Gazette dont la pagination continue des fascicules
invitait les lecteurs à relier ceux-ci en volume. qui se
sont passées de leur temps, comme sur la reine de Suède, lorsqu’elle quitta son
royaume, sur la Paix, sur le mariage et sur la naissance de Monseigneur le
Dauphin
La pratique consistant à recueillir et
relier des informations et des documents manuscrits et imprimés est
courante. Certains recueils sont d’ailleurs imprimés, tels que les
multiples ouvrage intitulés « Recueils de pièces curieuses… ». Les
périodiques préparaient d’ailleurs cet usage, à l’image de la
Gazette dont la pagination continue des fascicules
invitait les lecteurs à relier ceux-ci en volume. qui se
sont passées de leur temps, comme sur la reine de Suède, lorsqu’elle quitta son
royaume, sur la Paix, sur le mariage et sur la naissance de Monseigneur le
Dauphin Les événements mentionnés comptent parmi les
nouvelles spectaculaires des dernières années et concernent tous la
France. La reine Christine abdique en 1654 et quitte ensuite son
royaume. Elle fait un séjour mouvementé en France entre 1656 et 1658. La
paix avec l’Espagne, dite « Paix des Pyrénées » est signée le 7 novembre
1659 et met fin à un affrontement commencé en 1635. Elle se traduit par
le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d’Espagne le 9 juin 1660.
Celle-ci accouche du Dauphin le 1er novembre 1661.. Les
nouvellistes 318318 d’État, qui ne se plaisent pas tant à ces sortes de
choses, ont des recueils de tout ce qui se fait de pièces politiques en faveur
du gouvernement ou contre l’État, et surtout de celles que l’on n’ose montrer
sans se mettre en péril ; car elles sont entre eux beaucoup plus estimées que
les autres, quand même elles ne vaudraient rien.
Les événements mentionnés comptent parmi les
nouvelles spectaculaires des dernières années et concernent tous la
France. La reine Christine abdique en 1654 et quitte ensuite son
royaume. Elle fait un séjour mouvementé en France entre 1656 et 1658. La
paix avec l’Espagne, dite « Paix des Pyrénées » est signée le 7 novembre
1659 et met fin à un affrontement commencé en 1635. Elle se traduit par
le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d’Espagne le 9 juin 1660.
Celle-ci accouche du Dauphin le 1er novembre 1661.. Les
nouvellistes 318318 d’État, qui ne se plaisent pas tant à ces sortes de
choses, ont des recueils de tout ce qui se fait de pièces politiques en faveur
du gouvernement ou contre l’État, et surtout de celles que l’on n’ose montrer
sans se mettre en péril ; car elles sont entre eux beaucoup plus estimées que
les autres, quand même elles ne vaudraient rien.
Ils disent de ceux qui ne les veulent pas écouter lorsqu’ils débitent leurs nouvelles, que ce sont des stupides et des gens qui ne savent ce que c’est que le monde.
Quand ils disent une nouvelle, ils assurent toujours qu’elle est véritable et qu’ils la savent d’original, qu’elle n’est encore sue de personne, parce que ceux de qui ils la tiennent n’en ont encore fait part qu’à eux. 319319 Mais ils ne songent pas, en vous apprenant cette nouvelle secrète, que vous êtes peut-être le centième de la journée à qui ils ont dit la même chose et que, ces cent l’ayant publiée partout, cette nouvelle est commune alors qu’ils vous la disent.
L’affaire d’État qui est en règne est toujours le principal sujet de leurs
conversations, et ils s’en disent tous les jours des nouvelles les uns aux
autres. Leurs rendez-vous ordinaires sont au Palais, aux Tuileries, à la
Comédie, sous le cloître des Grands Augustins, à l’Arsenal, au Luxembourg et
généralement en tous les lieux où ils savent qu’il se doit rencontrer grand
monde La liste est effectivement celle de lieux
fortement fréquentés, qu’ils soient clos (Palais de justice, théâtres,
cloître du couvent des Grands-Augustins) ou ouverts (jardins des
Tuileries et du Luxembourg, promenade de l’Arsenal). On aurait pu y
ajouter le Pont-Neuf, mentionné à plusieurs reprises ailleurs dans les
Nouvelles Nouvelles. Ces mêmes lieux sont
régulièrement évoqués dans les satires postérieures des
nouvellistes.
. Vous les y voyez présider au milieu de quantité d’auditeurs,
parler d’action et se 320320 faire écouter. Là, ils marient les rois et les princes, font
la paix, déclarent la guerre
La liste est effectivement celle de lieux
fortement fréquentés, qu’ils soient clos (Palais de justice, théâtres,
cloître du couvent des Grands-Augustins) ou ouverts (jardins des
Tuileries et du Luxembourg, promenade de l’Arsenal). On aurait pu y
ajouter le Pont-Neuf, mentionné à plusieurs reprises ailleurs dans les
Nouvelles Nouvelles. Ces mêmes lieux sont
régulièrement évoqués dans les satires postérieures des
nouvellistes.
. Vous les y voyez présider au milieu de quantité d’auditeurs,
parler d’action et se 320320 faire écouter. Là, ils marient les rois et les princes, font
la paix, déclarent la guerre Le motif, repris des
sources anglaises et italiennes,
apparaît également dans la satire III de Boileau [ca. 1665] : « Chacun a
débité ses maximes frivoles, / Réglé les intérêts de chaque potentat, /
Corrigé la police, et réformé l'État, / Puis, de là s'embarquant dans la
nouvelle guerre, / A vaincu la Hollande, ou battu l'Angleterre
».. Ils sont quasi prêts à se battre contre ceux qui ne sont
pas de leur sentiment et c’est le plus grand plaisir du monde que de
les obstiner
Le motif, repris des
sources anglaises et italiennes,
apparaît également dans la satire III de Boileau [ca. 1665] : « Chacun a
débité ses maximes frivoles, / Réglé les intérêts de chaque potentat, /
Corrigé la police, et réformé l'État, / Puis, de là s'embarquant dans la
nouvelle guerre, / A vaincu la Hollande, ou battu l'Angleterre
».. Ils sont quasi prêts à se battre contre ceux qui ne sont
pas de leur sentiment et c’est le plus grand plaisir du monde que de
les obstiner Le comportement litigieux et
opiniâtre, incompatible avec les normes de la civilité au moins depuis
L’Honnête homme de Faret, constitue un autre trait caractéristique des
nouvellistes. Donneau l’a déjà exploité au tome II, dans la scène de la
lettre (p. 283sq.). . Le bon et mauvais
succès des affaires d’État paraissent sur leur visage, leur
corps ne saurait demeurer en place, non plus que leur esprit ; ils quittent sans
parler ceux avec qui ils sont pour aller joindre d’autres qu’ils aperçoivent,
puis ils les quittent encore après pour d’autres et reviennent ensuite à leur
première compagnie.
Le comportement litigieux et
opiniâtre, incompatible avec les normes de la civilité au moins depuis
L’Honnête homme de Faret, constitue un autre trait caractéristique des
nouvellistes. Donneau l’a déjà exploité au tome II, dans la scène de la
lettre (p. 283sq.). . Le bon et mauvais
succès des affaires d’État paraissent sur leur visage, leur
corps ne saurait demeurer en place, non plus que leur esprit ; ils quittent sans
parler ceux avec qui ils sont pour aller joindre d’autres qu’ils aperçoivent,
puis ils les quittent encore après pour d’autres et reviennent ensuite à leur
première compagnie.
Comme, parmi la quantité de nouvelles qu’ils disent, il ne se peut qu’il n’y en
ait du moins autant de fausses que de véritables, il s’en trouve qui disent
quelquefois des cho-321321ses autrement qu’elles ne sont aux personnes
mêmes à qui elles sont arrivées, sans les connaître et sans savoir eux-mêmes que ce qu’ils disent
n’est pas vrai. Il y en a d’autres qui savent bien qu’ils mentent, mais qui le
font si hardiment que l’on croit que tout ce qui vient d’eux est
véritable De même qu’à la p. 313 (« pour donner du
crédit à leur nouvelles »), Donneau de Visé invite le lecteur à faire
preuve de scepticisme dans une perspective de contrôle de
l’information. : ils ne cherchent point ce qu’ils veulent
dire, ils circonstancient bien toutes choses et il semble que leur visage soit
le témoin de ce qu’ils disent, tant il paraît sincère. Ceux-là trompent
souvent les plus habiles
et les moins crédules
De même qu’à la p. 313 (« pour donner du
crédit à leur nouvelles »), Donneau de Visé invite le lecteur à faire
preuve de scepticisme dans une perspective de contrôle de
l’information. : ils ne cherchent point ce qu’ils veulent
dire, ils circonstancient bien toutes choses et il semble que leur visage soit
le témoin de ce qu’ils disent, tant il paraît sincère. Ceux-là trompent
souvent les plus habiles
et les moins crédules Reprise de la description de
l’ »imposteur universel » de Clélie (cinquième partie,
1660) : « sa conversation est insupportable, car quelque soin qu’on y
prenne, et quelque résolution qu’on ait faite de ne le croire point, on
y est toujours attrapé, et il dit les choses d’un air si franc et si
ingénieux, qu’il peut tromper toute sa vie. » (éd. C. Morlet-Chantalat,
Champion, Ve partie, 2005, p. 52)..
Reprise de la description de
l’ »imposteur universel » de Clélie (cinquième partie,
1660) : « sa conversation est insupportable, car quelque soin qu’on y
prenne, et quelque résolution qu’on ait faite de ne le croire point, on
y est toujours attrapé, et il dit les choses d’un air si franc et si
ingénieux, qu’il peut tromper toute sa vie. » (éd. C. Morlet-Chantalat,
Champion, Ve partie, 2005, p. 52)..
Quand ils sont deux ou trois ensemble, ils ont bientôt fait le tour du monde en
s’interrogeant de toutes les affaires des princes étrangers. Quoiqu’ils se
haïssent et qu’ils disent en arrière du mal 322322 les uns des autres, comme
font tous les gens qui sont d’une même profession, ils cherchent néanmoins à se
voir, pour se communiquer et se faire part de leurs nouvelles, et quand ils se
rencontrent deux ou trois dans une chambre, ils se prêtent l’un l’autre
leurs nouvelles d’État et de Parnasse pour les décrire Cette scène
est représentée sur la gravure placée à l’orée du « portrait des nouvellistes » (p. 304). L’un s’arrête tout d’un
coup en décrivant, pour
faire remarquer un bel endroit
Cette scène
est représentée sur la gravure placée à l’orée du « portrait des nouvellistes » (p. 304). L’un s’arrête tout d’un
coup en décrivant, pour
faire remarquer un bel endroit Le passage qui suit est
probablement l’embryon à partir duquel Donneau de Visé a
conçu l’ensemble de la nouvelle des « nouvellistes ». ; un
autre en fait de même pour l’admirer ; un autre pour soutenir qu’il n’est pas
beau. Ainsi ils font des pauses à diverses reprises, ils disputent, se questionnent, examinent,
admirent, condamnent, et s’échauffent quelquefois tellement, en parlant tous
ensemble, qu’il y en a qui sont obligés de retenir à parler pour pou-323323voir faire entendre leur sentiment. Je vous laisse à penser quel
plaisir c’est que d’écouter ce qu’ils disent et de voir les postures qu’ils
font, lorsqu’ils parlent avec tant d’action. Ils se donnent souvent des démentis dans leurs
disputes, et de là naissent des querelles qui ne causent jamais de grands
désordres.
Le passage qui suit est
probablement l’embryon à partir duquel Donneau de Visé a
conçu l’ensemble de la nouvelle des « nouvellistes ». ; un
autre en fait de même pour l’admirer ; un autre pour soutenir qu’il n’est pas
beau. Ainsi ils font des pauses à diverses reprises, ils disputent, se questionnent, examinent,
admirent, condamnent, et s’échauffent quelquefois tellement, en parlant tous
ensemble, qu’il y en a qui sont obligés de retenir à parler pour pou-323323voir faire entendre leur sentiment. Je vous laisse à penser quel
plaisir c’est que d’écouter ce qu’ils disent et de voir les postures qu’ils
font, lorsqu’ils parlent avec tant d’action. Ils se donnent souvent des démentis dans leurs
disputes, et de là naissent des querelles qui ne causent jamais de grands
désordres.
Quand ils sont tous en un peloton, au Palais ou dans quelque jardin ou place publique, ils ne regardent point ceux qui les saluent, et ne saluent presque jamais personne, tant ils sont attentifs à écouter tout ce qui se dit en leur compagnie. Ceux de leurs amis qui sont nouvellistes se viennent mêler parmi eux sans les saluer, sans dire bonjour et sans parler du tout, et c’est une coutume qu’ils observent afin de 324324 ne pas interrompre celui qui parle.
Ils prennent tous grand intérêt aux Bâtiments du roi et à l’embellissement de Paris. Ils sont tous Contrôleurs des grands Édifices et ne manquent jamais de temps en temps de les aller voir. Après les avoir bien considérés et avoir bien contrôlé dessus, ils débitent leurs nouvelles en y regardant travailler, et l’on voit souvent quantité de personnes qui s’y arrêtent plutôt pour les écouter que pour regarder les bâtiments.
Quelque résolution que l’on fasse de ne les pas croire, l’on y est souvent
trompé, tant ils savent adroitement débiter ce qu’ils veulent persuader. Ils ne
souhaitent pas seulement de savoir des nouvelles pour satisfaire leur curiosité,
mais encore 325325
pour avoir le plaisir de les débiter La citation de Pascal
déjà mentionnée dans la note p. 306 s’applique également ici :
« Curiosité n’est que vanité le plus souvent. On ne veut savoir
que pour en parler. » (Pensées, Fragment 112).
, et c’est de là d’où vient que la passion qu’ils ont d’en
apprendre est si forte et qu’ils sont les gens du monde les moins capables de
garder un secret. Si quelqu’un, sans y penser, dit qu’il sait quelques
nouvelles, ils ne le laissent jamais en repos qu’il ne les leur ait fait savoir et si, par malheur
pour eux, il survient quelque personne dans la compagnie qui oblige pour quelque
temps de tenir d’autres discours, lorsqu’ils sont cessés et qu’ils trouvent l’occasion de
parler, ils le pressent tellement de dire ce qu’il sait qu’il est contraint,
s’il se veut délivrer d’eux, de leur dire quelques nouvelles, fausses ou
véritables, car sans cela ils ne pourraient se résoudre à le quitter.
La citation de Pascal
déjà mentionnée dans la note p. 306 s’applique également ici :
« Curiosité n’est que vanité le plus souvent. On ne veut savoir
que pour en parler. » (Pensées, Fragment 112).
, et c’est de là d’où vient que la passion qu’ils ont d’en
apprendre est si forte et qu’ils sont les gens du monde les moins capables de
garder un secret. Si quelqu’un, sans y penser, dit qu’il sait quelques
nouvelles, ils ne le laissent jamais en repos qu’il ne les leur ait fait savoir et si, par malheur
pour eux, il survient quelque personne dans la compagnie qui oblige pour quelque
temps de tenir d’autres discours, lorsqu’ils sont cessés et qu’ils trouvent l’occasion de
parler, ils le pressent tellement de dire ce qu’il sait qu’il est contraint,
s’il se veut délivrer d’eux, de leur dire quelques nouvelles, fausses ou
véritables, car sans cela ils ne pourraient se résoudre à le quitter.
Ils quêtent 326326 toute la journée des nouvelles pour redire le soir aux lieux où ils vont passer leur après-souper.
Les nouvellistes de Parnasse qui se trouvent sans tablettes et à qui l’on dit quelque sonnet au Palais, ou quelque épigramme qu’ils veulent retenir, vont de boutique en boutique demander de l’encre et du papier, et les décrivent sur les boutiques mêmes.
Il y en a que l’on appelle les coureurs de chansons A
l’instar des informations, la musique est une matière de circulation et
d’échange, ce dont témoigne l’intégration de deux airs mensuels
(parfois composé par les lecteurs) dans le Mercure galant à partir de 1678.
, et qui ne font que demander et que donner le petit air
nouveau.
A
l’instar des informations, la musique est une matière de circulation et
d’échange, ce dont témoigne l’intégration de deux airs mensuels
(parfois composé par les lecteurs) dans le Mercure galant à partir de 1678.
, et qui ne font que demander et que donner le petit air
nouveau.
Lorsqu’ils rencontrent, l’après-dînée, quelques gens qui leur ont appris le matin quelque chose de nouveau, ils lui racontent la même chose, sans se ressouvenir qu’ils la tiennent d’eux.
Il y en a dont la curiosité est quelquefois bien punie et qui, vou-327327lant tout voir et tout savoir, trouvent souvent ce qu’ils ne cherchent
pas ou ce qu’ils ne voudraient pas trouver Adaptation d’une
idée formulée dans Célinte : « Les amants trop sujets à la curiosité trouvent bien
souvent plus qu'ils ne veulent », reprise par Molière dans
L'École des femmes..
Adaptation d’une
idée formulée dans Célinte : « Les amants trop sujets à la curiosité trouvent bien
souvent plus qu'ils ne veulent », reprise par Molière dans
L'École des femmes..
De tous ceux qui débitent des nouvelles, les enjoués sont les plus supportables, parce que la manière dont ils les disent fait que tous ceux qui les écoutent s’y divertissent. Ainsi leurs nouvelles, fausses ou véritables, plaisent à tout le monde, parce que leur personne plaît.
Le nombre des nouvellistes étant plus grand qu’il n’a jamais été, ou, pour mieux
dire, tout le monde étant de ce nombre depuis que les femmes s’en
mêlent La Fronde avait diversifié les sources
d’information, à l’exemple
de la Lettre en vers de Loret adressé à Mademoiselle de
Longueville. Versifiée, digérée et réduite en termes simples, elle
faisait la part belle aux contenus galants, adressant désormais
l’information aussi bien aux femmes qu’aux hommes., l’on
demandera bientôt, si cela continue, « quelle nouvelle ? » et « ne savez-vous rien
de nouveau ? » au lieu de « comment vous portez-vous ? » et ces trois ou quatre
mots seront 328328 dorénavant les introducteurs de la conversation. Au
moins y a-t-il quantité de gens qui le souhaitent, parce qu’en inventant des
nouvelles, s’ils n’en ont pas, cela leur donnera le moyen de fournir aux
conversations et de les faire durer jusqu’à ce qu’un autre survienne, ou du
moins jusqu’à ce qu’il leur vienne quelque chose à dire. D’autres, après avoir
dit « comment vous portez-vous ? », sont souvent bien empêchés par où ils commenceront pour
entrer en conversation, ce qui sera cause que, si « ne savez-vous rien de nouveau
? » n’est bientôt à la place de « comment vous portez-vous ? », il le suivra de si
près qu’ils n’iront plus l’un sans l’autre.
La Fronde avait diversifié les sources
d’information, à l’exemple
de la Lettre en vers de Loret adressé à Mademoiselle de
Longueville. Versifiée, digérée et réduite en termes simples, elle
faisait la part belle aux contenus galants, adressant désormais
l’information aussi bien aux femmes qu’aux hommes., l’on
demandera bientôt, si cela continue, « quelle nouvelle ? » et « ne savez-vous rien
de nouveau ? » au lieu de « comment vous portez-vous ? » et ces trois ou quatre
mots seront 328328 dorénavant les introducteurs de la conversation. Au
moins y a-t-il quantité de gens qui le souhaitent, parce qu’en inventant des
nouvelles, s’ils n’en ont pas, cela leur donnera le moyen de fournir aux
conversations et de les faire durer jusqu’à ce qu’un autre survienne, ou du
moins jusqu’à ce qu’il leur vienne quelque chose à dire. D’autres, après avoir
dit « comment vous portez-vous ? », sont souvent bien empêchés par où ils commenceront pour
entrer en conversation, ce qui sera cause que, si « ne savez-vous rien de nouveau
? » n’est bientôt à la place de « comment vous portez-vous ? », il le suivra de si
près qu’ils n’iront plus l’un sans l’autre.
On peut ajouter à tout cela qu’il y a bien des gens de qualité qui sont 329329
nouvellistes Le passage rappelle une fois encore que le
terme de « nouvelliste » n’est pas une profession, mais un trait de
caractère. et
que, si l’on ne leur voit pas faire tout ce que font les autres, ils ne laissent
pas que de faire plus que leur qualité ne leur permet, et ne paraissent pas
moins ridicules à leurs semblables que les bourgeois aux bourgeois.
Le passage rappelle une fois encore que le
terme de « nouvelliste » n’est pas une profession, mais un trait de
caractère. et
que, si l’on ne leur voit pas faire tout ce que font les autres, ils ne laissent
pas que de faire plus que leur qualité ne leur permet, et ne paraissent pas
moins ridicules à leurs semblables que les bourgeois aux bourgeois.
Voilà le portrait des nouvellistes et les effets que les nouvelles ont déjà
commencé de produire, et l’on pourrait dire que la quantité de choses mémorables
qui sont arrivées dans notre siècle et le nombre de beaux esprits que nous y
avons présentement sont cause qu’il est plus rempli de ces sortes de gens que
n’ont été les siècles passés. Si César Note de l'auteur en
marge : "L. 4 De bello gallico" ne nous faisait voir que
la France en a été de tout temps remplie
Note de l'auteur en
marge : "L. 4 De bello gallico" ne nous faisait voir que
la France en a été de tout temps remplie Jules-César,
Guerre des gaules, IV, 5 : « C'est en Gaule un usage
de forcer les voyageurs à s'arrêter malgré eux ; et de les interroger
sur ce que chacun d'eux sait ou a entendu dire. Dans les villes, le
peuple entoure les marchands, et les oblige de déclarer de quel pays ils
viennent, et les choses qu'ils y ont apprises ». Dans sa «
Pantagrueline pronostication », rééditée en 1659, Rabelais citait déjà ce chapitre de
César pour parler du goût immodéré des nouvelles., en
accusant toute notre nation d’arrêter les passants sur les grands 330330
chemins et les marchands forains en plein marché pour leur faire dire par force
des nouvelles, peut-être que l’on ne croirait pas ce que je viens de dire des
nouvellistes ; ce qui prouve que je n’ai rien dit que de véritable et, quelque
ridicules que j’aie dépeint ceux qui font leur principale occupation d’apprendre
et de débiter des nouvelles, je n’en ai pas encore assez dit.
Jules-César,
Guerre des gaules, IV, 5 : « C'est en Gaule un usage
de forcer les voyageurs à s'arrêter malgré eux ; et de les interroger
sur ce que chacun d'eux sait ou a entendu dire. Dans les villes, le
peuple entoure les marchands, et les oblige de déclarer de quel pays ils
viennent, et les choses qu'ils y ont apprises ». Dans sa «
Pantagrueline pronostication », rééditée en 1659, Rabelais citait déjà ce chapitre de
César pour parler du goût immodéré des nouvelles., en
accusant toute notre nation d’arrêter les passants sur les grands 330330
chemins et les marchands forains en plein marché pour leur faire dire par force
des nouvelles, peut-être que l’on ne croirait pas ce que je viens de dire des
nouvellistes ; ce qui prouve que je n’ai rien dit que de véritable et, quelque
ridicules que j’aie dépeint ceux qui font leur principale occupation d’apprendre
et de débiter des nouvelles, je n’en ai pas encore assez dit.

J’ai voulu faire voir ce portrait tout au long, sans m’arrêter aux pauses que firent nos nouvellistes, de peur d’en interrompre le sens. Mais vous vous imaginez bien qu’ils en firent beaucoup et vous pouvez même avoir remarqué les endroits où ils s’arrêtèrent.
Après qu’ils l’eurent lu et qu’ils eurent témoi331331gné leur
dépit et l’obligation
qu’ils avaient à Arimant de ne le leur pas avoir voulu montrer, ils se
résolurent tous de le décrire,
au lieu de ce qu’ils avaient entrepris, disant qu’Arimant n’étant pas près de
venir, ils auraient du temps plus qu’ils ne leur en faudrait. Comme ils
commençaient à en faire des copies, Arimant me dit que, pour leur jouer
la pièce jusqu’au
bout Conclusion de « la pièce que je leur ai préparée », annoncée par Arimant au début du tome II, p. 4.
, il était temps de les surprendre. Il se leva de sa place en
disant ces paroles et nous allâmes de là dans leur chambre. Et, comme il en
avait la clef, ils nous virent plus tôt qu’ils ne nous entendirent, ce qui fut
cause qu’ils ne purent replier la lettre qu’ils avaient lue, ni Le Portrait.
Conclusion de « la pièce que je leur ai préparée », annoncée par Arimant au début du tome II, p. 4.
, il était temps de les surprendre. Il se leva de sa place en
disant ces paroles et nous allâmes de là dans leur chambre. Et, comme il en
avait la clef, ils nous virent plus tôt qu’ils ne nous entendirent, ce qui fut
cause qu’ils ne purent replier la lettre qu’ils avaient lue, ni Le Portrait.
Arimant leur dit en entrant qu’il avait fait ses affaires plus tôt qu’il ne s’était 332332 imaginé et prit aussitôt la lettre, qu’il trouva ouverte sur la table. Ils furent si surpris de nous voir que le dépit leur fit baisser les yeux et leur empêcha de nous parler.
— Je vois bien, continua Arimant, en regardant sa lettre et Le Portrait des nouvellistes, que depuis que je suis parti, votre curiosité a rendu véritable tout ce que ce portrait contient. Elle est indiscrète et incivile tout ensemble, mais, comme je ne veux pas insulter aux malheureux et qu’elle est assez punie par ce qu’elle a trouvé dans cette lettre et dans ce portrait, je ne veux pas en témoigner de ressentiment.
Quand il eut cessé de parler, ils lui firent des excuses d’avoir pris sa lettre
et lui dirent que le désir d’apprendre des nouvelles, dont ils savaient 333333 bien, par ce qu’ils en avaient vu, que le paquet était plein, les
y avait engagés ; et, de fait, Arimant, afin d’exciter leur curiosité et de les
engager à l’ouvrir, leur en avait adroitement laissé voir quelque
chose Mise en récit d’un passage de
Célinte (1661) : « Mais que direz-vous de ces curieux
qui ouvrent des lettres qui ne leur appartiennent pas ? - Pour moi, dit
Artelice, je dirais que quelquefois on leur doit pardonner, car il y a
certaines lettres qu’on a tant envie de voir, qu’il est bien difficile
de s’en empêcher […] mais aussi pour l’ordinaire arrive-t-il que les
curieux de cette espèce sont punis de leur curiosité et qu’ils
apprennent quelquefois ce qu’ils n’eussent jamais voulu savoir. »
(p. 50sq.) où ils avaient pu remarquer le mot de
« nouvelles ». Ensuite, par une envie démesurée d’avoir tout ce qui se fait de
nouveau et de le montrer, quand même il serait contre eux, ils le prièrent de
leur laisser achever les copies qu’ils en avaient commencées, ce qu’il leur
permit.
Mise en récit d’un passage de
Célinte (1661) : « Mais que direz-vous de ces curieux
qui ouvrent des lettres qui ne leur appartiennent pas ? - Pour moi, dit
Artelice, je dirais que quelquefois on leur doit pardonner, car il y a
certaines lettres qu’on a tant envie de voir, qu’il est bien difficile
de s’en empêcher […] mais aussi pour l’ordinaire arrive-t-il que les
curieux de cette espèce sont punis de leur curiosité et qu’ils
apprennent quelquefois ce qu’ils n’eussent jamais voulu savoir. »
(p. 50sq.) où ils avaient pu remarquer le mot de
« nouvelles ». Ensuite, par une envie démesurée d’avoir tout ce qui se fait de
nouveau et de le montrer, quand même il serait contre eux, ils le prièrent de
leur laisser achever les copies qu’ils en avaient commencées, ce qu’il leur
permit.
Je les quittai quelque temps après, parce qu’il commençait à se faire tard et, m’étant encore trouvé le lendemain chez Arimant, parce qu’il m’en avait prié, je lui vis recevoir de la part de Clorante la lettre qui suit. 334334
CLORANTE A ARIMANT L’amende honorable de Clorante
conclut le projet annoncé dans la préface (« je connais mes
défauts et que je tâche à m'en corriger » p. XXII). Après Célinte, les Nouvelles Nouvelles proposent
une éthique de la curiosité, et, en particulier, de la
consommation de l’information. Que l’on ne s’y trompe pas,
toutefois : ce n’est pas le comportement des nouvellistes qui
est justifié, mais le fait qu’il est nécessaire de disposer
d’une certaine quantité d’informations pour évoluer dans le
monde. A la fin des Nouvelles Nouvelles, le mot «
nouvelliste » apparaît plus que jamais comme le terme satirique
destiné à fustiger tout comportement malsain vis-à-vis de
l’information et contrôler ainsi sa diffusion. Le fait que ce Clorante se révèle le plus
raisonnable des nouvellistes est significatif à ce titre : ceux
qui se mêlent de nouvelles d’Etat, comme Lisimon, sont des fous.
Que l’on se mêle de littérature et de nouvelles littéraires, si
l’on doit se mêler de quelque chose.
L’amende honorable de Clorante
conclut le projet annoncé dans la préface (« je connais mes
défauts et que je tâche à m'en corriger » p. XXII). Après Célinte, les Nouvelles Nouvelles proposent
une éthique de la curiosité, et, en particulier, de la
consommation de l’information. Que l’on ne s’y trompe pas,
toutefois : ce n’est pas le comportement des nouvellistes qui
est justifié, mais le fait qu’il est nécessaire de disposer
d’une certaine quantité d’informations pour évoluer dans le
monde. A la fin des Nouvelles Nouvelles, le mot «
nouvelliste » apparaît plus que jamais comme le terme satirique
destiné à fustiger tout comportement malsain vis-à-vis de
l’information et contrôler ainsi sa diffusion. Le fait que ce Clorante se révèle le plus
raisonnable des nouvellistes est significatif à ce titre : ceux
qui se mêlent de nouvelles d’Etat, comme Lisimon, sont des fous.
Que l’on se mêle de littérature et de nouvelles littéraires, si
l’on doit se mêler de quelque chose.
C’est une vérité dont je ne puis douter que ceux qui nous font
connaître nos défauts, de quelque manière qu’ils le fassent, sont nos
véritables amis Déclaration conforme au discours sur la
satire tel qu’élaboré dans les années 1660. Elle reprend le propos de la
préface : « je connais mes défauts et [...] je tâche à m'en corriger en
leur montrant les leurs, et ce sont ces vérités qui rendront cette
satire utile, comme le sont d'ordinaire toutes celles qui sont
universelles et qui ne désignent personne en particulier. ». Ce discours
sera tourné en dérision dans la scène du Misanthrope, où
Arsinoé déverse son fiel sur Célimène au nom de l’amitié qu’elle déclare
lui porter (III, 4, v. 878-912). et que ceux qui, par une
complaisance blâmable, nous flattent et trouvent toutes nos actions bien faites,
font l’office de nos ennemis.
Déclaration conforme au discours sur la
satire tel qu’élaboré dans les années 1660. Elle reprend le propos de la
préface : « je connais mes défauts et [...] je tâche à m'en corriger en
leur montrant les leurs, et ce sont ces vérités qui rendront cette
satire utile, comme le sont d'ordinaire toutes celles qui sont
universelles et qui ne désignent personne en particulier. ». Ce discours
sera tourné en dérision dans la scène du Misanthrope, où
Arsinoé déverse son fiel sur Célimène au nom de l’amitié qu’elle déclare
lui porter (III, 4, v. 878-912). et que ceux qui, par une
complaisance blâmable, nous flattent et trouvent toutes nos actions bien faites,
font l’office de nos ennemis.
Le Portrait des nouvellistes que je décrivis hier chez vous m’a donné tant de
mépris de moi-même et m’a fait prendre une si forte résolution de me rendre
à l’avenir maître de ma curiosité Les effets de la
satire des nouvellistes ici explicités rejoignent le projet annoncé dans la préface
des Nouvelles Nouvelles : « je connais mes défauts et que
je tâche à m'en corriger en leur montrant les leurs, et ce sont ces
vérités qui rendront cette satire utile » (p. XXII-XXIII). , que je ne puis m’empêcher de vous
remercier, après m’avoir procuré un si grand bien, et de vous demander en mê-335335me temps votre sentiment de ce que je m’imagine sur ce sujet. Car
je me persuade que ce n’est pas un vice que de savoir des nouvelles et que
l’avidité avec laquelle les nouvellistes en demandent, jointe à la
profession qu’ils font de savoir tout ce qui se passe et d’en faire part aux
autres, les rend seule condamnables. Car enfin il se fait tous les jours des
choses dans le monde que l’on ne peut ignorer, quand même on le voudrait, et
dont l’on ne peut se défendre de parler quand elles tombent en conversation et
que l’on oblige tous ceux qui s’y rencontrent d’en dire leur sentiment.
Les effets de la
satire des nouvellistes ici explicités rejoignent le projet annoncé dans la préface
des Nouvelles Nouvelles : « je connais mes défauts et que
je tâche à m'en corriger en leur montrant les leurs, et ce sont ces
vérités qui rendront cette satire utile » (p. XXII-XXIII). , que je ne puis m’empêcher de vous
remercier, après m’avoir procuré un si grand bien, et de vous demander en mê-335335me temps votre sentiment de ce que je m’imagine sur ce sujet. Car
je me persuade que ce n’est pas un vice que de savoir des nouvelles et que
l’avidité avec laquelle les nouvellistes en demandent, jointe à la
profession qu’ils font de savoir tout ce qui se passe et d’en faire part aux
autres, les rend seule condamnables. Car enfin il se fait tous les jours des
choses dans le monde que l’on ne peut ignorer, quand même on le voudrait, et
dont l’on ne peut se défendre de parler quand elles tombent en conversation et
que l’on oblige tous ceux qui s’y rencontrent d’en dire leur sentiment.
Pour ce qui regarde les vers, c’est une nécessité dans ce
temps d’en savoir faire Parmi les compétences galantes,
figure au premier rang celle de savoir faire des vers. Dans la
Clélie des Scudéry, on décrit ainsi « le talent de la
poésie comme un agréable présent de la nature, qu'il ne [faut] pas
négliger, et qui sert à [nous] rendre plus aimable et plus accompli »
(Dossier Molière21).L’expression « dans ce temps », quant à
elle, renvoie à l’évolution du statut de la poésie depuis les années
1650, qui passe de celui de langage des dieux à celui d’un brillant
loisir mondain. En témoigne le succès phénoménal des recueils de poésie
au début des années 1660 (voir M. Speyer, Briller par la
diversité : les recueils collectifs de poésies au XVIIe
siècle, thèse soutenue le 10 avril 2019 à l’Université de
Caen et C. Schuwey, « Aux enseignes de papier : les recueils comme
plateformes de publication »). Dans Le Parnasse réformé (1669), Guéret
consacrera un long développement à cette
évolution., quand ce ne serait que pour connaître les bons,
parce qu’il est impossible d’en bien juger, à moins que l’on n’en
fasse
Parmi les compétences galantes,
figure au premier rang celle de savoir faire des vers. Dans la
Clélie des Scudéry, on décrit ainsi « le talent de la
poésie comme un agréable présent de la nature, qu'il ne [faut] pas
négliger, et qui sert à [nous] rendre plus aimable et plus accompli »
(Dossier Molière21).L’expression « dans ce temps », quant à
elle, renvoie à l’évolution du statut de la poésie depuis les années
1650, qui passe de celui de langage des dieux à celui d’un brillant
loisir mondain. En témoigne le succès phénoménal des recueils de poésie
au début des années 1660 (voir M. Speyer, Briller par la
diversité : les recueils collectifs de poésies au XVIIe
siècle, thèse soutenue le 10 avril 2019 à l’Université de
Caen et C. Schuwey, « Aux enseignes de papier : les recueils comme
plateformes de publication »). Dans Le Parnasse réformé (1669), Guéret
consacrera un long développement à cette
évolution., quand ce ne serait que pour connaître les bons,
parce qu’il est impossible d’en bien juger, à moins que l’on n’en
fasse La proposition s’inscrit dans le débat plus
général dans les années 1660 entre théorie et pratique, qu’illustre la
« naissance de la critique dramatique ». Dans sa Défense de Sophonisbe (1663),
Donneau attaque d’Aubignac en lui reprochant de n’avoir jamais su faire
une pièce de théâtre à succès, ce à quoi d’Aubignac répondra : « [les
spectateurs] ne sont pas tous capables de faire un habit, un soulier ni
un chapeau et néanmoins ils en jugent tous les jours quand les artisans
leur en apportent » (p. 28). . Ce travail est 336336 présentement
glorieux et nous sommes dans un siècle où non seulement tous les gens de qualité
les estiment aussi bien que tous les princes de la terre, mais où la plupart des
grands en font. Ce langage, qui n’était autrefois que celui des dieux, est aussi
présentement celui des déesses, puisque les femmes en font encore mieux que les
hommes ; et, cela étant, dites-moi, je vous prie, si un homme qui recevrait un
billet en vers d’une femme et qui n’en saurait point faire, ne se trouverait pas
bien embarrassé s’il était obligé d’y répondre en
prose.
La proposition s’inscrit dans le débat plus
général dans les années 1660 entre théorie et pratique, qu’illustre la
« naissance de la critique dramatique ». Dans sa Défense de Sophonisbe (1663),
Donneau attaque d’Aubignac en lui reprochant de n’avoir jamais su faire
une pièce de théâtre à succès, ce à quoi d’Aubignac répondra : « [les
spectateurs] ne sont pas tous capables de faire un habit, un soulier ni
un chapeau et néanmoins ils en jugent tous les jours quand les artisans
leur en apportent » (p. 28). . Ce travail est 336336 présentement
glorieux et nous sommes dans un siècle où non seulement tous les gens de qualité
les estiment aussi bien que tous les princes de la terre, mais où la plupart des
grands en font. Ce langage, qui n’était autrefois que celui des dieux, est aussi
présentement celui des déesses, puisque les femmes en font encore mieux que les
hommes ; et, cela étant, dites-moi, je vous prie, si un homme qui recevrait un
billet en vers d’une femme et qui n’en saurait point faire, ne se trouverait pas
bien embarrassé s’il était obligé d’y répondre en
prose.
Je me persuade, de plus, qu’un homme qui fait profession de voir le monde, peut encore garder et demander, non pas tous les ouvrages qui se font, mais du moins tout ce qui se fait de plus beau ; et comme les belles pièces sont rares, il ne sera jamais trop 337337 chargé de papiers, comme on dépeint les nouvellistes dans leur portrait. Je crois cette chose d’autant plus raisonnable que l’on ne doit pas condamner ce qui regarde l’esprit.
Voilà ce que je prétends garder de mon humeur et ce dont je prétends me corriger, et je vous prie de joindre, à l’obligation que je vous ai, celle de me dire si je ferai bien en agissant de la sorte.
Clorante.
Quand nous eûmes lu cette lettre, nous nous ressouvînmes que Clorante nous avait
paru le plus spirituel des trois nouvellistes. C’est pourquoi ce soudain
changement ne nous surprit point et nous avouâmes qu’il y avait bien des choses
que l’excès seul rendait condam-338338nables Cette
morale conclusive correspond à l’idéal de la mediocritas
qu’exposent par exemple certaines scènes des comédies de Molière. Elle
se relie également à la gravure du portrait des nouvellistes (p. 304) où
l’on trouve écrit à l’arrière-plan : « Chacun a sa
folie »., et que nous vivions dans un siècle où il était nécessaire
d’être un peu ridicule, si l’on ne le voulait pas paraître beaucoup.
Cette
morale conclusive correspond à l’idéal de la mediocritas
qu’exposent par exemple certaines scènes des comédies de Molière. Elle
se relie également à la gravure du portrait des nouvellistes (p. 304) où
l’on trouve écrit à l’arrière-plan : « Chacun a sa
folie »., et que nous vivions dans un siècle où il était nécessaire
d’être un peu ridicule, si l’on ne le voulait pas paraître beaucoup.
FIN
339339AU LECTEUR
Les libraires ont souhaité que je t’avertisse que tu auras
dans peu un livre intitulé Le Bien et le mal de ce l’on craint. Histoire
plus comique que sérieuse, utile à toutes les personnes mariées et à toutes
celles qui ont dessein de se marier Cette annonce, séparée du reste de l’ouvrage par un
bandeau, est typique des pratiques publicitaire du libraire Jean
Ribou (voir A. Riffaud, « Jean Ribou, le libraire éditeur de
Molière », Histoire et civilisation du livre, t. X,
2014, p. 315-363). On en trouve un autre exemple dans certains
exemplaires du Cocu imaginaire et de La
Cocue imaginaire. Cet ouvrage n’a jamais paru. Son contenu semble
s’orienter vers ce qui sera celui du Mariage forcé
(« je veux savoir de vous, si je ferai
bien de me marier », sc. I), le risque de cocuage étant envisagé
comme un paramètre décisif de la décision.. Je ne t’en dirai pas davantage, de
crainte que l’on ne m’accuse de me louer moi-même et de tomber dans le vice
que je viens de reprendre.
Cette annonce, séparée du reste de l’ouvrage par un
bandeau, est typique des pratiques publicitaire du libraire Jean
Ribou (voir A. Riffaud, « Jean Ribou, le libraire éditeur de
Molière », Histoire et civilisation du livre, t. X,
2014, p. 315-363). On en trouve un autre exemple dans certains
exemplaires du Cocu imaginaire et de La
Cocue imaginaire. Cet ouvrage n’a jamais paru. Son contenu semble
s’orienter vers ce qui sera celui du Mariage forcé
(« je veux savoir de vous, si je ferai
bien de me marier », sc. I), le risque de cocuage étant envisagé
comme un paramètre décisif de la décision.. Je ne t’en dirai pas davantage, de
crainte que l’on ne m’accuse de me louer moi-même et de tomber dans le vice
que je viens de reprendre.